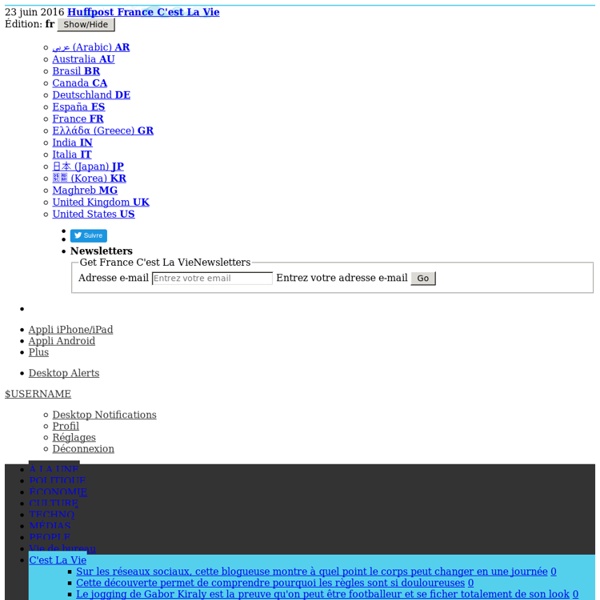Scandale en Europe : 4 millions de SDF et 11 millions de logements vides - CitizenPost
Une enquête menée par le journal britannique Guardian montre que l’Europe serait dotée de 11 millions de logements vacants tout en comptant plus de 4,1 millions de sans-abris. Moins de la moitié de ces logements pourraient donc permettre à chacun de vivre sous un toit. Voici le drame de la spéculation immobilière.. Des millions de personnes dorment dans la rue pendant que tout près, plus du double de logements reste inoccupé. Ce n’est pas la première fois que ce décalage fait les gros titres, mais les chiffres montrent cette fois-ci une réalité à l’échelle européenne. C’est en Espagne que l’on dénombre le plus grand nombre de logements vides.
La pédagogie 3.0 expliquée simplement.
Le parcours de Stéphane Côté en est un où une certaine effervescence l’entoure concernant la pédagogie. Si vous l’avez déjà rencontré en personne, vous avez tout de suite remarqué son emballement quasi enfantin lorsqu’il parle de l’enseignement. En effet, il cherche, découvre, évalue, mesure l’impact de ses idées qui se tissent autour d’une approche non conventionnelle qu’il décide d’intituler la pédagogie 3.0. En 2012 il quitte son poste de conseiller pédagogique en TIC qu’il occupait depuis plus de quatre ans pour aller lui-même mettre à l’épreuve cette vision de la pédagogie actualisée afin de voir, si oui ou non, il y a matière à partager et à déployer…
Equipement de la salle de classe 2.0
18 juin Mes usages du numérique me mènent à un constat, j’utilise plus les fonctionnalités hors ma classe que dans ma classe. J’essaye d’en analyser les causes. Dans le cas présent la raison me paraît évidente. Je travaille sur la base d’un dispositif de type web 2.0 qui est mobile, ubiquitaire, souple que l’on souhaite instrumenter à la demande.
Attentat à Charlie Hebdo : Cabu, Charb, Tignous, Wolinski et Maris tués
G.L. avec A.Ca. | 07 Janv. 2015, 13h27 | MAJ : 07 Janv. 2015, 21h13 Jean Cabut (Cabu), 76 ans, et Georges Wolinski, 80 ans, avaient été dessinateurs dans l'emblématique magazine Hara-Kiri, ancêtre de Charlie Hebdo, avant de participer à la création de ce dernier, en 1970. Né à Tunis en 1934, Wolinski arrive en France en 1945 et publie ses premiers dessins dans Rustica en 1958.
Complimentez, il en restera toujours quelque chose (1)
Alors que l’on entrevoit toute l’importance que l’évaluation va continuer de prendre à la rentrée, Alain Lieury, chercheur en psychologie cognitive, nous rappelle quelques grands épisodes de la recherche autour de la place de la note, notamment dans la motivation. Il nous livre également les résultats d’une de ses expériences, menée dans un collège. En cette période estivale, voici donc la saga des notes, feuilleton en quatre épisodes, à suivre à la rentrée. Un « marronnier » pour un journaliste est un thème qui revient périodiquement, comme le thème de la mémoire pour les révisions à l’approche des examens. L’évaluation en est un aussi puisque j’en ai toujours entendu parler au cours de ma carrière, notamment après Mai 68 où tout ce qui passait pour une contrainte était banni.
Enseignement supérieur : la grande révolution de la pédagogie
À l’ère des Moocs, du numérique, quand les jeunes générations veulent travailler autrement et les entreprises recruter des profils plus innovants, tous s’interrogent sur ce que doit devenir la pédagogie dans l’enseignement supérieur. C’est dans cet esprit que Grenoble EM vient par exemple d’éditer un Livre blanc intitulé « Portraits de l’École du Futur ». Son constat : « Nous sommes arrivés aujourd’hui à la conjonction de progrès technologiques de différentes natures qui vont radicalement bouleverser des notions fondamentales dans l’enseignement tel que nous le connaissons aujourd’hui : le savoir, la pédagogie, la distance, la relation avec le professeur, l’évaluation, et la notion même de ce qu’est un cours ». Pour favoriser l’innovation pédagogique, Grenoble EM crée dans ses locaux une salle de conception de jeux de plateau, ce qu’on appelle les « serious games » (Photo Bertrand-Maclet) Repenser les modes d’acquisition du savoir
Attentat terroriste contre Charlie Hebdo : rassemblement à 18 heures place du Capitole à Toulouse | Médias d'ici
07 jan Après l’attentat meurtrier qui a fait au moins 12 morts (suivre ici la situation en direct) dans les locaux de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris, un rassemblement est organisé dès ce mercredi 7 janvier à 18 heures place du Capitole à Toulouse. Un rassemblement silencieux pour défendre la liberté de la presse et rendre hommage à nos confrères décédés ou blessés lors de cet attentat.
Des obstacles aux apprentissages comme appuis pour les surmonter
28 février 2010 Henri Boudreault Apprendre, Didactique professionnelle, Environnement didactique, L'apprenant, Le contexte, Objet d'apprentissage, Pratique pédagogique Figure 1 : Éléments à considérer pour surmonter les obstacles aux apprentissages. Le rôle d’un enseignant est de faire apprendre. Cela semble facile à dire, mais beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre.
Visite d’une salle pour la pédagogie active
Pédagogie active, pédagogie par projets, sont des pédagogies que nous pratiquons depuis de nombreuses années dans mon institution. Pourtant, il est toujours intéressant de voir comment s’organisent d’autres institutions. La vidéo en anglais ci-dessous, nous permet de faire le tour d’une salle spécifiquement organisée pour ce genre d’activités à l’Université du Minnesota. Voyons ensemble quelques caractéristiques intéressantes de leur salle de classe pour la pédagogie active. Le terme qui ressort le plus souvent de la vidéo, c’est apprentissage en profondeur.