

Thème 5 en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) en classe de première. 03 février 2021. En quoi cet article s’inscrit-il dans le programme ?

L’étude des relations entre les États et les religions est au cœur du thème 5 en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) en classe de première. Il existe une grande diversité de situations dans les relations entre les États et les religions. Ainsi, si certains États appliquent le principe de laïcité, d’autres, comme l’Iran, sont au contraire de véritables théocraties dans lesquelles le religieux joue un rôle politique majeur. D’autres, enfin, n’hésitent pas à restreindre les libertés religieuses.
Ce sont souvent des régimes communistes et autoritaires comme la Corée du Nord et la Chine. C’est dans cette perspective que l’on peut, par exemple, étudier le cas des populations ouïgoures persécutées par le gouvernement chinois. Lavage de cerveau Le peuple ouïgour est une minorité musulmane qui vit dans l’ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. Un génocide ? L’acculturation à marche forcée. Sciences Po L'Enjeu mondial. L’Observatoire international du fait religieux (OIR) est un projet de recherche financé par le Ministère des armées, dont le pilotage scientifique est assuré conjointement par le Centre de recherches internationales (CERI) et le Groupe sociétés, religions, laïcités (EPHE).
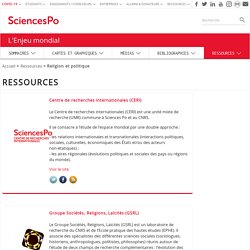
Jusqu’aux années 2000, l’analyse des faits sociaux a eu tendance à occulter le fait religieux dont on croyait, à tort, que la pertinence s’était essoufflée dans nos sociétés sécularisées. Les dynamiques sociales et politiques à l’œuvre depuis ont montré que ce jugement était tout aussi hâtif qu’erroné. Forts de ce constat, les travaux menés dans le cadre de l’OIR ont à cœur de redonner à l’analyse de la dynamique religieuse sa juste valeur.
Les bulletins mensuels réalisés dans le cadre de cet Observatoire, et désormais mis à disposition du public, rassemblent les contributions de chercheurs venus d’aires géographiques ou de disciplines différentes. Lire les bulletins mensuels. Observatoire géopolitique du religieux. Sous la direction de Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe, et de François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique des religions, cet observatoire a pour objectif de bâtir l’édifice nécessaire pour une compréhension saine et exacte des enjeux s’imposant au monde contemporain à travers les questions du Sacré. Ses prérogatives sont : identification et explicitation des points crisogènes contemporains ; suggestions pour éviter à ces derniers de prendre des dimensions incontrôlables ; retours sur des exemples historiques permettant de mieux comprendre les logiques du moment.
L'Observatoire est co-animé avec le Centre international de recherche et d'aide à la décision (CIRAD-FIUC). POURQUOI UN OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX ? Par Nicolas Kazarian, chercheur associé à l’IRIS - février 2014. Religion et politique. Aubrée Marion et Laplantine François, La Table, le livre et les esprits, Paris, Jean-Claude Lattès, 1990.

Berger Peter, O dossel sagrado : elementos para uma teoria sociológica da religião, São Paulo, Paulus, 1985. Birman Patrícia, « Cultos de possessão e pentecostalismo no Brasil : passagens », Religião e sociedade, 17 (1-2), 1996, p. 90-109. Birman Patrícia, « Modos periféricos de crença », dans Pierre Sanchis (dir.), Catolicismo : unidade religiosa e pluralismo cultural, São Paulo, Loyola, 1992, p. 167-196. Thème 5 du programme, “L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire”. Dans La Lettre de l’éduc de la semaine dernière, intitulée “Rivalités et convoitises en mer de Chine”, nous vous proposions de travailler sur l’article suivant : Covid-19 : le climat sera-t-il au cœur de la relance économique ?

Il s’agissait de répondre à la question : la crise du coronavirus permettra-t-elle de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique ? Newsletter educ from 17 juin 2020. Dans la Lettre de l’éduc de la semaine dernière, intitulée “La crise du coronavirus va-t-elle aider à lutter contre le réchauffement climatique ?”

, nous vous proposions de travailler sur l’article suivant : Il s’agissait de répondre à la question : quelles relations le président Trump entretient-il avec la religion ? En quoi cet article s’inscrit-il dans le programme ? Cet exercice s’adresse particulièrement aux élèves de première en spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP). La question s’inscrit en effet dans le dernier thème du programme et en particulier dans l’axe 2, “Une inégale sécularisation”. Le document fourni pour cette étude n’est pas un article en soi, mais une revue de presse qui s’appuie sur trois sources : The Atlantic, The Guardian et The New York Times.
Quel sens donner à ce geste ? Un contexte explosif Il faut tout d’abord recontextualiser cet événement pour en comprendre la portée. Un geste polémique Préparer le rattrapage • Analyse.