

Roland Lehoucq : « De Galilée à Einstein, l’imagination a joué un rôle-clé en science » La science, avec sa rigueur, sa rationalité, sa recherche de « vérité » pourrait sembler bien loin de l’imagination, souvent associée au rêve, à l’illusion et la fantaisie.

Il n’en est rien, bien au contraire. Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique à Saclay (Essonne) et président d’Utopiales, un festival international de science-fiction à Nantes (Loire-Atlantique), explique pourquoi les scientifiques ont sans cesse recours à l’imagination. Diriez-vous, en tant que scientifique, que sciences et imagination s’opposent ? Absolument pas ! L’imagination est indispensable au scientifique, que ce soit en physique, en chimie, en biologie ou même en mathématiques, qui peuvent pourtant être très abstraites. Arthur I. Miller. History professor Arthur I.
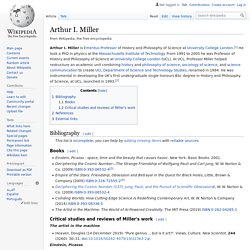
Miller is Emeritus Professor of History and Philosophy of Science at University College London.[1] He took a PhD in physics at the Massachusetts Institute of Technology. From 1991 to 2005 he was Professor of History and Philosophy of Science at University College London (UCL). At UCL, Professor Miller helped restructure an academic unit combining history and philosophy of science, sociology of science, and science communication to create UCL Department of Science and Technology Studies, renamed in 1994.
He was instrumental in developing the UK's first undergraduate single honours BSc degree in History and Philosophy of Science, at UCL, launched in 1993.[2] A philosopher places creativity in evolutionary context. The Evolution of Imagination, by philosopher Stephen Asma, is an ambitious and exciting book about creativity, rich with eclectic disciplinary references and enlivened with personal anecdotes.

Charting new territory, Asma emphasizes the biological bases of imagination—sensory perception, emotions and affective systems, neurology, biochemistry, brain size and differentiation, and capabilities for motion and action—and casts these elements in evolutionary perspective. One of Asma’s most striking claims is that imagination preceded human language. His main evidence for this assertion is that most biological requisites for imagination—including a limbic system to process affective states such as fear and attachment and sensory capability to recognize particular individuals—evolved in most social mammals, not only in primates. Stephen T. Asma. Stephen Asma in 2008 (photo by Brian Wingert) Stephen T.
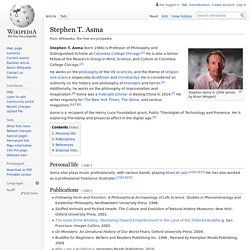
Asma (born 1966) is Professor of Philosophy and Distinguished Scholar at Columbia College Chicago.[1] He is also a Senior Fellow of the Research Group in Mind, Science, and Culture at Columbia College Chicago.[2] Asma is a recipient of the Henry Luce Foundation grant, Public Theologies of Technology and Presence. He is exploring friendship and prosocial affect in the digital age.[9]
Imagination as a dialogue. The hippocampus constructs scene imagery to facilitate recollected or imagined mental representations.

However, input from the ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) is also needed for scene construction. How do these regions interact when we imagine a scene? Barry et al. addressed this question using magnetoencephalography. Participants imagined novel scenes or single objects after being given a cue. The direction of information flow during scene imagination mirrored that observed during episodic memory retrieval, in which vmPFC drives hippocampal activity. L’imagination en art et en science. Communication au Colloque « Créer et découvrir ». Bicentenaire de l’Institut de France. L’imagination en art et en science « Rien n’est beau que le vrai », affirme Nicolas Boileau dans une épître. « Il n’y a de vrai que le beau », confirme Anatole France dans La Vie littéraire.

Et John Keats, dans son Ode à un vase grec, surenchérit : « Le beau c’est le vrai, le vrai c’est le beau. » S’il y a de la beauté dans ces aphorismes, on peut s’interroger sur leur vérité. Les sciences cherchent à construire une représentation cohérente du monde aussi proche que possible de ce qu’on appelle la réalité. C’est une entreprise collective dans le temps et l’espace. François Jacob. François Jacob (né le 17 juin 1920 à Nancy et mort le 20 avril 2013[1],[2] à Paris[3]) est un biologiste et médecin français.
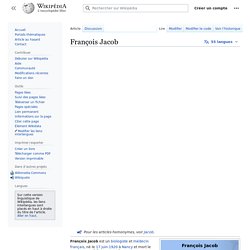
En 1965, il est récompensé du prix Nobel de physiologie ou médecine[4]. Compagnon de la Libération par décret du 17 novembre 1945, il est Chancelier de l'ordre d'octobre 2007 à octobre 2011. Biographie[modifier | modifier le code] Jeunesse et famille[modifier | modifier le code] Engagement durant la Seconde Guerre mondiale[modifier | modifier le code] Jacob imagination 1995. Roland Lehoucq : « De Galilée à Einstein, l’imagination a joué un rôle-clé en science » La science, avec sa rigueur, sa rationalité, sa recherche de « vérité » pourrait sembler bien loin de l’imagination, souvent associée au rêve, à l’illusion et la fantaisie.

Il n’en est rien, bien au contraire. Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique à Saclay (Essonne) et président d’Utopiales, un festival international de science-fiction à Nantes (Loire-Atlantique), explique pourquoi les scientifiques ont sans cesse recours à l’imagination. Diriez-vous, en tant que scientifique, que sciences et imagination s’opposent ?
5 Ways To Inspire Innovative Thinking. The perception that innovation means big ideas occurring on a macro level is only partly true. Smaller, incremental changes are the other half of the story and can even lead to a new innovation altogether. “I think it’s a really big problem that innovation is perceived as the next big thing. It inhibits the way that people can contribute to innovation,” said Dr. The Creativity Formula: 50 Scientifically-Proven Creativity Boosters for Work and for Life - Imber, Dr Amantha. Roland Lehoucq. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
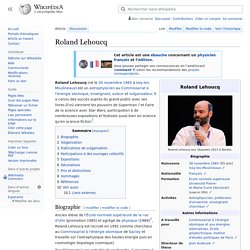
Roland Lehoucq aux Utopiales 2013 à Nantes. Roland Lehoucq (né le 30 novembre 1965 à Issy-les-Moulineaux) est un astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique, enseignant, auteur et vulgarisateur. Il a connu des succès auprès du grand public avec ses livres D'où viennent les pouvoirs de Superman ? Et Faire de la science avec Star Wars, participation à de nombreuses expositions et festivals aussi bien en science qu'en science-fiction[1]. Biographie[modifier | modifier le code] Comment naissent les idees nouvelles ? Mensuel N° 238 - Juin 2012 Où, quand et comment naissent les bonnes idées ?

À peu près de la même façon que les mauvaises. L’image d’Épinal représente la découverte sous la forme d’un soudain eurêka : une brusque illumination qui vient éclairer l’esprit d’Archimède dans son bain ou de Newton recevant une pomme sur la tête. Jean-François Dortier. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Jean-François Dortier est un sociologue français né le 5 octobre 1956[1]. Biographie[modifier | modifier le code] TaP AKUE ADOTEVI NUNYA 2014. Claudine Tiercelin, l'imagination comme barrière entre science et art ?
Souvent, on présente l'imagination comme étant un risque relativement à ce que pourrait être la scientificité rigoureuse de la démarche scientifique, mais je crois qu'il y a là plusieurs malentendus qu'il faut dissiper. D'abord, ce qui explique qu'on y voit un risque, c'est que très souvent l'imagination est entendue comme quelque chose qui a trait à la passivité de l'esprit et comme étant lié à la présence d'images, de copies, de ressemblances avec la réalité et donc entaché par ce biais même d'erreurs. Or une image, c'est nécessairement quelque chose qui est en deçà de la réalité. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans la tradition philosophique classique, l'imagination, liée à la présence d'images était pensée sur le modèle de la copie et de la ressemblance, mais aussi ayant un lien avec la perception, notamment dans la tradition empiriste, ce qui ne permettrait pas d’accéder à la quintessence de la pensée.