


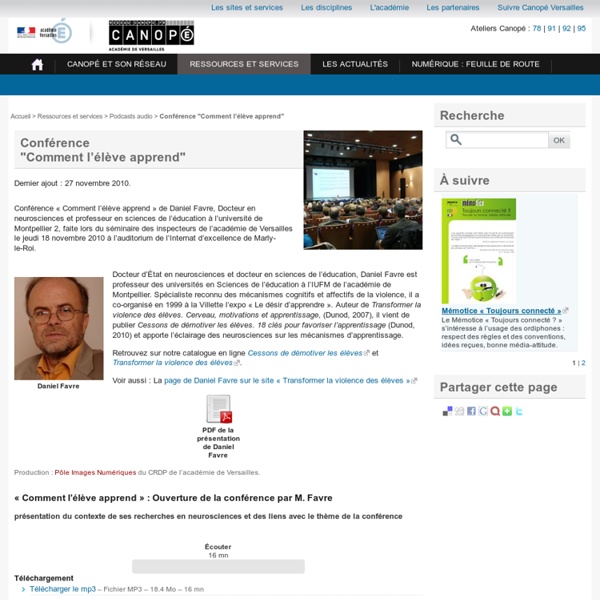
Apprendre de façon visuelle/spatiale “Apprendre, pour ceux qui le font de façon visuelle-spatiale, est quelque chose de soudain et se fait à partir de regroupements de données saisis de manière intuitive plutôt que dans le regroupement progressif d’éléments isolés, de petites étapes ou d’habitudes acquises par la pratique. Par exemple, ils peuvent apprendre toutes les multiplications comme un ensemble sur une table de multiplications beaucoup plus facilement et rapidement que s’ils avaient mémorisé chaque donnée séparément. Organiser: La perspective visuelle/spatiale est le principe d’organisation.Le perfectionnisme pour ceux qui apprennent de façon visuelle/spatiale correspond à un espace bien ordonné et élaboré dans lequel chaque objet est à sa place et de façon harmonieuse.Ils ne sont pas à l’aise et peuvent même être agités lorsqu’ils sont face à des situations incomplètes ou instables. Observer/Expérimenter: Les stratégies pour apprendre Prendre des habitudes en étudiant Utilisez la technologie: Pendant les cours Voir aussi
Les neuromythes constituent un obstacle au changement dans le domaine de l’éducation Qu’est-ce qui fait obstacle au changement et à l’amélioration de l’éducation? Je crois qu’un des obstacles est lié au fait que les enseignants possèdent souvent de fausses conceptions sur le fonctionnement du cerveau de leurs élèves. Ces idées fausses (souvent appelées des neuromythes) représentent un obstacle au changement et à l’amélioration de l’éducation, parce que, lorsqu’un changement s’oppose à une conception bien établie, il y a toujours une tendance naturelle et compréhensible à résister à ce changement. Je crois également qu’une des façons de surmonter cet obstacle est d’intégrer, dans la formation des enseignants, un cours de neuroéducation, un domaine en émergence dont le but est d’améliorer l’enseignement en comprenant mieux le fonctionnement du cerveau des élèves. Un des obstacles au changement : les neuromythes Parlons d’abord des neuromythes. Comme vous l’avez peut-être deviné, toutes ces affirmations ne sont en réalité que des neuromythes.
Pour une réforme de l'éducation ET de la connaissance L'éducation (voir E Morin La Voie, pages 151-161) Il est devenu nécessaire de réformer, non seulement l'éducation, mais son socle: la connaissance. On réduit trop souvent le problème de l'éducation en France à des termes quantitatifs: "davantage de crédits"; "davantage d'enseignants"; "davantage d'informatique". Mais on masque ainsi le vrai souci: jamais on ne réformera l'éducation (L'a-t-elle seulement été? L'idée même de réforme, à condition d'en proposer une véritable, pourrait mobiliser les esprits, rassembler les volontés aujourd'hui dispersées, réanimer les personnels résignés et susciter des propositions. L'étude de la littérature, des mathématiques, des sciences, de l'histoire contribuent évidemment à l'insertion dans la vie sociale. Un nouveau système d'éducation fondée sur les "disciplines reliées" (la reliance): - enseignerait les diverses formes de rationnalité (théorique, critique, autocritique)
Typologie du plaisir motivationnel Ce qui fait le plus défaut dans les écoles aujourd’hui, là où le bat blesse jour après jour, ce n’est pas tant la méthode pédagogique comme l’absence de passion, d’émerveillement, et de plaisir. La génération d’élèves à qui nous avons affaire baigne dans la stimulation intellectuelle et le jeu depuis la naissance, du premier hochet et mobile multisensoriels aux jeux vidéo. Dans ce contexte, l’école s’avère un choc culturel et affectif qui a toute l’âcreté d’un mauvais rêve. Pas étonnant que l’école ne branche plus les élèves. Il ne s’agit pas de transformer l’école en terrain de jeu. L’apprentissage ne gagne nullement à rester cérébral. Par ricochet : De l’importance de la beauté Motivation : coopération ou compétition ? Motivation, plaisir et gratification Ronald Canuel à l’AQUOPS (Mario tout de go)
Aider un enfant à bien mémoriser Beaucoup d’enfants sont persuadés qu’ils ont « appris » leur leçon alors qu’ils se sont contentés de la lire. Comment les aider à mieux faire travailler leur mémoire ? On retient généralement 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend, 50 % de ce qu'on voit et entend en même temps, et enfin, 80 % de ce qu’on est capable d’expliquer à un tiers et 90 % de ce qu’on écrit, dessine ou fabrique soi-même ! Des résultats qu’il est utile d’avoir en tête quand il s’agit d’aider un enfant à mieux « apprendre », mieux mémoriser. Un peu de méthode… Votre enfant a une leçon d’histoire ou un poème à apprendre ? Se faire des fiches avec des résumés, illustrer une leçon, multiplier les exercices « pratiques » lorsque le sujet s’y prête, « chantonner » ce que l’on doit apprendre par coeur sont d’autres moyens simples pour bien mémoriser. Et une bonne hygiène de vie ! Mémoire visuelle, mémoire auditive Chaque enfant a une forme « privilégiée » de mémoire. (photo © Lee Morris / Shutterstock.com)
Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage Liste et definitions Les activités dirigées de lecture et de réflexion : Une activité dirigée de lecture et de réflexion est un processus qui permet aux élèves d'établir des objectifs et de faire des prévisions à propos des textes qu'ils lisent. L'apprentissage coopératif : L'apprentissage en petits groupes est une façon d'organiser les expériences du programme d'études afin d'assurer la participation des élèves et l'interdépendance des tâches d'apprentissage. L'apprentissage expérientiel : Il est centré sur l'élève. Exemples: - excursions - expériences - jeux - constructions - jeux de rôles - sondages - observations sur le champ - simulation - maquettes - visualisation Le calcul mental : Le calcul mental est un processus ou une activité qui permet aux élèves d'effecteur mentalement une série d'opérations. La cartographie : Une cartographie est une représentation de données physiques, démographiques ou numériques sous forme visuelle.
Neurosciences et apprentissages Les neurosciences constituent l'une des branches de la recherche médicale qui intéresse le plus le grand public. Nous fondons d'énormes espoirs dans la recherche sur le fonctionnement du cerveau, qui bénéficie de financements importants. Mais il n'est pas plus raisonnable de fonder l'espoir d'une société idéale ayant vaincu la maladie et, pourquoi pas, la mort, sur les neurosciences que sur les technologies numériques. Mais peut-on vivre et avancer sans cet espoir ? Sans doute pas. Et chaque découverte sur le fonctionnement de notre cerveau est bonne à prendre. Il ne faudrait pourtant pas confier toute sa destinée d'apprenant et, plus largement, d'être humain, à la puissance de l'esprit. Ces caractéristiques semblent aujourd'hui pouvoir se déployer dans un espace numérique moins normé que l'espace physique, qui devient le terrain de jeu sans limites de notre esprit. Illustration : Lightspring, Shutterstock.com Exige-t-on trop des neurosciences? 5 mai 2013 L'appel du ventre 6 mai 2013
Appropriation des connaissances par le jeu Samedi 2 avril 2011 6 02 /04 /Avr /2011 11:06 Un problème important de l’utilisation des jeux dans l’apprentissage est celui du compromis entre réalisme, cohérence et apprentissage ; on parle du niveau d’authenticité. L'authenticité dans les situations d'apprentissage fait l'objet de débat, notamment dans les enseignements scientifiques, mais pas seulement. L'article intitulé "authenticity in learning game: how it is designed and perceived", qui présente les résultats sur ce sujet, a reçu un prix de la conférence européenne EC-TEL (Technology Enhanced Learning) à Barcelone en septembre 2010. Les auteurs de cet article appartiennent à des équipes du pôle Grenoble Cognition: Celso Gonçalvès (doctorant), Muriel Ney et Nicolas Balacheff (MeTAH - LIG) et Marie-Caroline Croset et Jean-Luc Bosson (ThEMAS - TIMC). (…) Cet article traite de question de l'authenticité dans un jeu pour l’apprentissage, à la fois du point de vue du jeu et de celui de l'apprenant. Partager l'article ! inShare
Appui-Motivation - Accueil Une mise à jour complète du site « appui-motivation » a été effectuée en 2012. De nouvelles activités de formation, de nouveaux textes et de nouvelles vidéos ont été mis en ligne et d'autres ressources s'ajouteront au cours des prochains mois. Dans la section « Activités de formation », vous retrouverez les nouvelles activités de formation sur le modèle CLASSE et ses six dimensions. Dans la section « Médiathèque », vous retrouverez des vidéos qui illustrent des interventions pédagogiques pouvant soutenir l'engagement et la persévérance scolaires chez les élèves. Pour accéder au site, vous devez disposer d'un compte. Nous vous invitons à nous visiter fréquemment afin de prendre connaissance de nos nouveautés ! Bonne visite !
Neuf exercices pour améliorer sa concentration au travail La concentration consiste à mobiliser ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou sur une action. Or notre cerveau est sollicité par de multiples informations et il ne peut en traiter qu'une seule à la fois de façon optimale. Il s'agit donc de le monopoliser, en se libérant des émotions parasites et en s'entrainant à agir, en activant ses cinq sens. Par cette pratique, vous gagnerez aussi en performance. Voici neuf exercices à effectuer avant et pendant ce travail. 1. Le chercheur Robert Nideffer, féru de psychologie du sport, a observé que l'attention de l'athlète se caractérise par deux dimensions : l'étendue, large ou étroite selon qu'elle est focalisée sur une seule ou plusieurs informations ; la direction, interne ou externe selon qu'elle est centrée sur les pensées et sensations ou sur un événement ou un objet extérieur. 2. 3. 4. Comme précédemment, regardez un seul objet mais sans vous y attarder. 5. Pour les auditifs, c'est une aide intéressante. 6. 7. 8. 9.
Styles d'apprentissage Peut-on concevoir une façon idéale d'aborder et de résoudre un problème ? Certainement pas. Tout dépend de la nature du problème, des circonstances et, surtout, des spécificités individuelles. En fait, confrontés à une même situation, la plupart des sujets observés présentent des réactions diversifiées, parfois très contrastées. Comment pouvons-nous interpréter, respecter et valoriser ces différences ? Qu'est-ce qu'un style d'apprentissage ? Comme nous l'avons vu plus haut, le style, c'est la " manière personnelle d'agir et de se comporter... " (ROBERT). a. b. c. d. Il n'existe donc pas une bonne façon d'apprendre ou de résoudre un problème. Etat des recherches Il y a bien d'autres styles cognitifs que ceux évoqués dans le tableau ci-dessous. Sur le plan pédagogique, que peut-on tirer de tout cela ? J.P. Sur la base de ces travaux émergerait l'idée de pouvoir dresser le " profil " de chaque élève, ce qui garantirait une meilleure efficacité pour nos actions. Comment faire ?
Neurosciences et pédagogie Dans le monde de l'éducation, c'est une innovation : améliorer l'enseignement et l'apprentissage par ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau. Et cela s'appelle la neuropédagogie. Domaine de recherche relativement nouveau qui fait la jonction entre les neurosciences et les sciences de l'éducation, il s'intéresse aux processus biologiques en jeu dans l'apprentissage ainsi que les expériences sociales et émotionnelles. La gymnastique du cerveau D'une manière pratique, les applications de la neuropédagogie mènent vers des évolutions dans la manière d'enseigner et d'apprendre et vise in fine à "stimuler de nouvelles zones du cerveau, à créer de nouvelles connexions pour faciliter les apprentissages". Dans un reportage de la chaîne Euronews sur le sujet, on se rend bien compte que cela n'a rien de sorcier. Mais la neuropédagogie ne s'arrête pas là. On sait par exemple que le cerveau retient sept fois plus d'informations si on les catégorise. En toile de fond, l'apprentissage Références
L'arbre des compétences Qu’est-ce que l’arbre des compétences ? Les arbres de compétences (également nommés "arbres de connaissances") ont été imaginés dans les années 1990. Cette méthodologie pédagogique a été rapidement utilisée dans les écoles Freinet essentiellement. Je dois bien vous avouer n’avoir pas lu intégralement le livre fondateur de ces "arbres de connaissances", mais je n’en ai pas -à priori- besoin car j’ai trouvé ici ce que je souhaite faire avec mes élèves afin de corriger les problèmes rencontrés. Un outil de mutualisation des compétences et de dynamisation du groupe classe Après quelques semaines de cours, les points suivants ont été mis en évidence : Mise en application pédagogique Ce schéma est projeté et expliqué aux élèves : De quoi avons-nous besoin ? Vous aurez besoin de : Les documents Fiche de brevet Modèle de fiche de brevet fiche utilisée pour décrire les brevets (compétence, évaluation...) Fiche de couleur modèle pour les fiches couleurs (6 fiches par feuille A4) Classeur de suivi