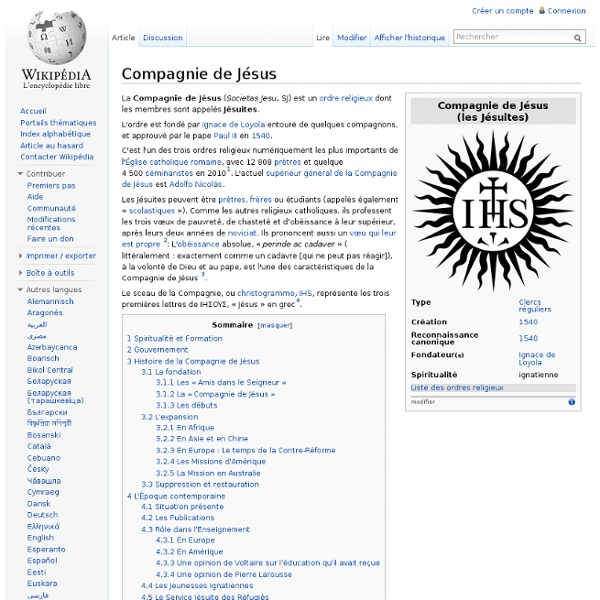Compagnie de Jésus
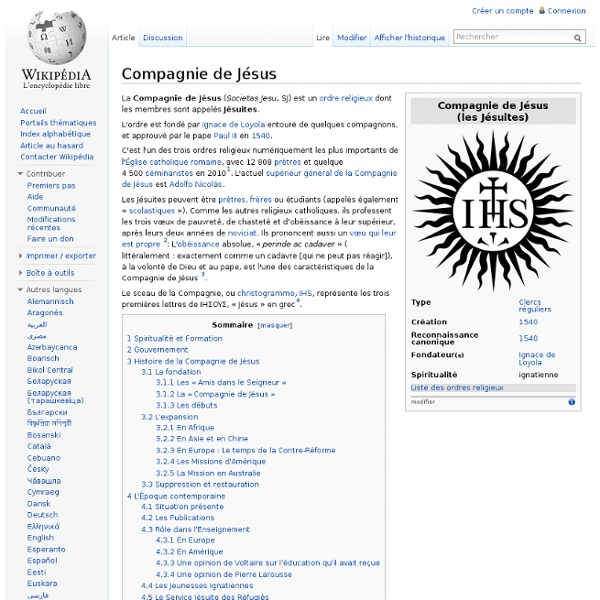
27 septembre 1540 - Fondation de la Compagnie de Jésus
Le 27 septembre 1540, le pape Paul III signe la bulle (dico) qui porte fondation de la Compagnie de Jésus. Cet ordre, consacré à l'évangélisation et à l'éducation, est issu de la rencontre en 1529, à l'Université de Paris, d'un étudiant savoyard, Pierre Favre, d'un jeune noble navarrais, François de Jassu y Xavier (François-Xavier), et d'un vieux routier basque de 37 ans, boiteux de surcroît, Íñigo de Loyola (Ignace de Loyola). Ils partagent la même chambre au Collège de Navarre. Avec quelques autres étudiants désireux comme eux de vouer leur vie au Christ, ils entraînent leur corps et leur esprit par quelques exercices spirituels mis au point par Ignace de Loyola. Fabienne Manière Une obéissance aveugle au pape Le 15 août 1534, les jeunes gens assistent à la chapelle de Montmartre à une messe de leur ami Pierre Favre, récemment ordonné prêtre. Mais à Venise, empêchés de se rendre à Jérusalem, ils tournent leurs pas vers Rome et proposent leurs services au pape. Fatales jalousies
Activité 5
Activité 4
Activité 6
Activité 1
Activité 2
Activité 3
Martin Luther (Wikipedia)
Scandalisé par le commerce des indulgences instauré par les papes Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie le 31 octobre 1517 les 95 thèses. Sommé le 15 juin 1520 par Léon X de se rétracter, il est excommunié, le 3 janvier 1521, par la bulle pontificale Decet romanum pontificem. L'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi des Espagnes, Charles Quint, convoque Martin Luther en 1521 devant la Diète de Worms. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque. Devant la Diète de Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. Il est accueilli par son ami le prince-électeur de Saxe Frédéric III le Sage au château de la Wartbourg, où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés. Biographie[modifier | modifier le code]
Related: