


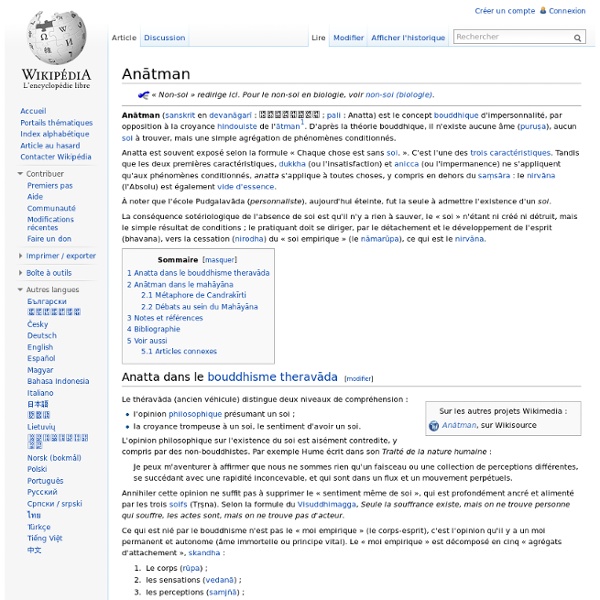
Saṃsāra : cycle des existences conditionnées Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Cette page contient des caractères spéciaux. Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode. Peinture tibétaine traditionnelle ou tanka montrant la roue de vie et les rayons de la saṃsāra Le saṃsāra (संसार terme sanskrit signifiant « ensemble de ce qui circule », d'où « transmigration » ; en tibétain khor ba, ou Khorwa འཁོར་བ། ) signifie « transition » mais aussi « transmigration », « courant des renaissances successives »[1]. Dans le bouddhisme, il s'agit du cycle des existences conditionnées, c'est-à-dire les états de l'existence sous l'emprise de la souffrance, de l'attachement et de l'ignorance. D'une manière moins juste mais plus simple, le saṃsāra est donc le cycle des vies, de renaissance en renaissance. Le saṃsāra dans l'hindouisme[modifier | modifier le code] Dans l'hindouisme, saṃsāra signifie : Cycles[modifier | modifier le code] Voir Loka.
Anattā Buddhist doctrine of "non-self" Etymology and nomenclature [edit] Anattā is a composite Pali word consisting of an (not) and attā (self-existent essence).[8] The term refers to the central Buddhist concept that there is no phenomenon that has "self" or essence. It is one of the three characteristics of all existence, together with dukkha (suffering, dissatisfaction) and anicca (impermanence).[8] Anattā is synonymous with Anātman (an + ātman) in Sanskrit Buddhist texts.[9] In some Pali texts, ātman of Vedic texts is also referred to with the term Attan, with the sense of "soul".[8] An alternate use of Attan or Atta is "self, oneself, essence of a person", driven by the Vedic-era Brahmanical belief that atman is the permanent, unchangeable essence of a living being, or the true self.[8][9] In early Buddhist texts The concept of Anattā appears in numerous Sutras of the ancient Buddhist Nikāya texts (Pali canon). According to Collins, the Suttas present the doctrine in three forms.
Quatre nobles vérités Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La première noble vérité : Dukkha[modifier | modifier le code] La première noble vérité est que l'existence conditionnée, l'existence que nous connaissons, est imbue de souffrances : la naissance est une souffrance, la vieillesse est une souffrance, la maladie est une souffrance, la mort est une souffrance, être uni à ce que l'on n'aime pas est une souffrance, être séparé de ce que l'on aime est une souffrance - et, finalement, les cinq agrégats (skandhas) d'attachement (à savoir la forme, la sensation, la perception, la volonté et la conscience) sont aussi des souffrances. Ce terme de souffrance est aussi traduit par l'insatisfaction, puisque ce qu'il désigne est bien au-delà de la douleur physique. Le mot « dukkha » (duḥkha en sanskrit) est souvent traduit par « souffrance » ou « douleur »[3], ce qui est réducteur. La deuxième noble vérité : Samudaya[modifier | modifier le code] La quatrième noble vérité : Magga[modifier | modifier le code]
Nirvāna : état d'eveil Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Cette page contient des caractères spéciaux ou non latins. Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation…), consultez la page d’aide Unicode. Pour les articles homonymes, voir Nirvana. Dans son acception bouddhique, qui est la plus commune aujourd'hui, ce terme désigne la finalité de la pratique bouddhique, l'Éveil (bodhi). Des termes proches sont : éveil, extinction, libération, illumination, délivrance, vacuité absolue, paix suprême, réalité ultime. Pour le bouddhisme hīnayāna, le nirvāṇa est « l'autre rive », qui « existe » par opposition au cycle du devenir, le saṃsāra, alors que pour le bouddhisme mahāyāna nirvāṇa et saṃsāra sont ultimement identiques, de par la non-dualité de la nature des choses. On distingue au moins deux types de nirvāṇa : L'école Cittamātra du Mahāyāna rajoute deux autres types : Voir aussi parinivana, Satori.
Understanding Tibetan Buddhism - Bon - A Heterodox System | Dreams Of Tibet Tibetans commonly draw a distinction between three religious traditions: (1) the divine dharma (Iha chos), or Buddhism; (2) Bon dharma (bon chos); and (3) the dharma of human beings (mi chos), or folk religion. The first category includes doctrines and practices that are thought to be distinctively Buddhist. This classification implicitly assumes that the divine dharma is separate and distinct from the other two, although Tibetan Buddhism clearly incorporated elements of both of these traditions. Bon is commonly considered to be the indigenous religious tradition of Tibet, a system of shamanistic and animistic practices performed by priests called shen (gshen) or bonpo (bon po). Although this is widely assumed by Buddhists, historical evidence indicates that the Bon tradition only developed as a self-conscious religious system under the influence of Buddhism.
Vipassanā bhāvanā Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Vipassanā bhāvanā ("vision supérieure" ou "vue pénétrante") est le nom d'une méthode de méditation dont le principe est de « prêter attention à la réalité ». Origine[modifier | modifier le code] La pratique[modifier | modifier le code] C'est une des pratiques de méditation les plus étudiées avec la Méditation transcendantale[1]. Dix-huit inspections[modifier | modifier le code] Stades[modifier | modifier le code] Souillures[modifier | modifier le code] Dans le Mahâyâna et le Hinayana[modifier | modifier le code] Références[modifier | modifier le code] Articles connexes[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code] (en) Vipassana Fellowship Bibliographie[modifier | modifier le code] William Hart, L'art de vivre, Méditation Vipassanā enseignée par S.N. Références[modifier | modifier le code] ↑ (en) Raymond J.
Introduction au bouddhisme Le Bouddhisme Il n'existe pas de définition stricte du bouddhisme. Le présent texte n'est qu'un reflet de ma compréhension du bouddhisme. Un "bouddhiste" est une personne qui adhère à l'enseignement de Siddharta Gautama, qui vécut 500 ans avant Jésus-Christ. Schématiquement, une personne atteint l'état de "Bouddha" quand elle a un peu tout compris des choses du monde et elle a appris à se maitriser. Le plus utile est peut-être de commencer par brosser les différences entre le bouddhisme et la plupart des autres religions : C'est une religion de l'impermanence. Un bouddhiste est responsable de ses actes. La théorie de la réincarnation est une idée religieuse qui était très présente en Inde, berceau du bouddhisme. Vous *êtes* l'ensemble de vos pensées, qui vous traversent l'esprit au fil de la journée et des événements. Beaucoup de problèmes émanent de personnes qui sont assaillies par leurs pensées. Prendre ses distances par rapport aux pensées. Le bouddhisme est un édifice imposant.
Symbolic Imagery in Himalayan and Tibetan Sacred Art The arts of India, Tibet, Nepal, and Bhutan display a rich stylistic diversity. However, these Himalayan regions share many symbols and important figures in their arts. Dating from the first millennium, Himalayan art is part of the Buddhist tradition. It is beyond decorative or fine arts and thus is sacred art. Figures Found in Sculpture and Paintings Most Himalayan art begins with sacred figures. Buddhas—The main image of Buddhas, or “enlightened ones,” possess common features in Himalayan art. Deities or Saints in Tantric Art Religious texts called tantras describe numerous forms of deities. Tantric Deities—Deities, or gods, that personify various enlightened qualities. Postures Sacred sculpture and paintings show the buddhas and bodhisattvas in a recognizable variety of postures. Lotus position—This posture is commonly associated with meditation. Tibetan Artists Training for Sacred Art Specially trained monks created most of the sculptures and paintings for monasteries or royalty.
Tarot divinatoire - Wikipedia Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La Papesse, arcane majeur du Tarot Visconti Le tarot divinatoire est l'application de la cartomancie aux cartes du Tarot de Marseille ou de ses variantes historiques ou modernes. C'est un art divinatoire qui utilise toutes ou une partie des 78 cartes du Tarot. Histoire[modifier | modifier le code] pour l'histoire des jeux de cartes utilisés dans le Tarot divinatoire voir l'article Tarot de Marseille L'usage divinatoire du Tarot pourrait être daté de 1527 avec la parution du Chaos del Tri per uno, essai littéraire de lecture divinatoire avec les tarots de Teofilo Folengo écrit sous le pseudonyme de Merlin Cocai. C'est à la fin du XVIIIe siècle à Bologne en Italie qu'est attesté un des premiers documents connus avec la liste de cartes du Tarot et leurs significations divinatoires[1]. Le rayonnement du Tarot divinatoire fondé sur le Tarot de Marseille ou le Tarot de Besançon prendra son essor en France avec Antoine Court de Gébelin.
Le Dharma en deux mots (Les 4 sceaux du bouddhisme) "Le bouddhisme se caractérise par quatre particularités ou « sceaux ». Lorsqu’on retrouve ces quatre sceaux dans une voie ou une philosophie elle peut être considérée comme la voie du Bouddha" Les gens me demandent souvent : "Comment présenter le bouddhisme en quelques mots ?" ou elles me demandent "Quelle est la philosophie ou la vision spécifique du bouddhisme ?" Malheureusement, en Occident le bouddhisme semble être atterri dans le département religieux et même dans le département de l’auto-croissance ou l’auto-aide. Beaucoup de personnes s’imaginent que la méditation signifie se relaxer, regarder le lever de soleil ou contempler les vagues déferlant sur une plage. Les quatre sceaux : Le premier sceauLe second sceauLe troisième sceauLe quatrième sceau Une dénomination En premier lieu je pense qu’il faudrait examiner le contenu véritable de la méditation bouddhiste. Quelle est donc cette vision spécifique à laquelle les bouddhistes essaient de s’accoutumer ? Quatre sceaux Le premier sceau
Buddhist Feminism (Part 3) When the Hindu Tantric tradition began to seep into Buddhism, with its complicated sexual yogas and meditation, it had a radical effect on certain Buddhists’ attitude toward women. The earthiness and sensuality attributed to women, which the sexist side of Buddhism saw as their spiritual weakness, became a spiritual power in Tantric Buddhism. The female yogi, “yogini”, who channels her sexual energy into meditation in the midst of the sex act was seen as one of the most important teachers a Tantric monk could have (an idea reflected in Herman Hesse’s novel SIDDHARTHA). For instance, the Tantric master Marpa, and his wife, shared a “long and highly fruitful relationship” with the consort-guruess Da-me-ma, and the Tantrist Savari was taught by two sisters, Logi and Guni, who, As Tantric consorts, helped him to important breakthroughs on his path. The PrajnaParamita (Perfect Wisdom) must be adored everywhere by those who strive for liberation. Agenda for a Buddhist Feminism
Âtman Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Vedānta[modifier | modifier le code] En tant que conscience absolue ou conscience pure, l'ātman est aussi le Brahman dans le Vedānta et particulièrement l'Advaita Vedānta. La nature de l'ātman est identique à celle du Brahman à savoir : être absolu et éternel, conscience absolue, pur Je Suis Cela (Cela signifiant l'Âme universelle, le Brahman, qui est le pouvoir qui envahit tout, toute chose et toute créature) et félicité absolue[5]. Celui qui connaît l'ātman est « l'agent de chaque chose (visvakrt), l'agent du Tout (sarvakarta), le monde est à lui et il est ce monde même »[6]. Bouddhisme[modifier | modifier le code] Le bouddhisme n'admet pas l'existence de l'ātman. C'est la non-existence du soi (anātman) , la notion complémentaire de l'ātman, qui est employée pour désigner le non-soi des phénomènes corporels et mentaux (skandha). Notes et références[modifier | modifier le code] Voir aussi[modifier | modifier le code] Brahman
Bodhisattva : celui qui a formé le vœu de suivre le chemin indiqué par le Bouddha Shākyamuni Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Il existe cinquante-deux niveaux de Bodhisattvas : dix degrés de la foi, dix degrés de la demeure, dix degrés de la pratique, dix degrés du transfert de mérites, dix terres, éveil correct et équivalent, et éveil merveilleux. Au début se trouvent les novices qui apprennent les théories en les mettant en pratique, ils doivent s'entraîner pendant trois grands kalpas d'après le Mahāyāna pour devenir Bouddhas, et au bout du chemin se situent les très grands Bodhisattvas tels qu'Avalokiteshvara et Manjushri qui, ayant déjà été Bouddhas dans le passé, reviennent dans notre monde en jouant le rôle de Bodhisattva pour faciliter le progrès et l'éveil de ceux qui les veulent de leur plein gré. Le Bodhisattva Manjusri (bronze japonais du XVIIe-XIXe siècle) Naissance du Bodhisattva[modifier | modifier le code] Le Bodhisattva dans les différents courants[modifier | modifier le code] Theravada[modifier | modifier le code] Le Soutra du filet de Brahmā, (sk.