


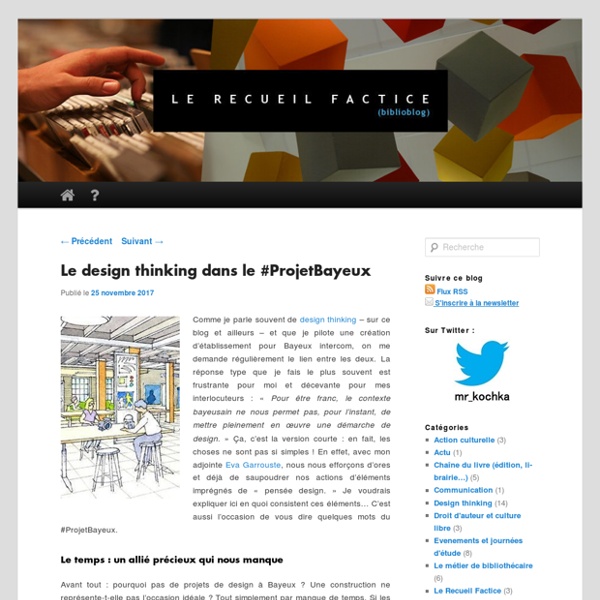
Le design thinking, de Stanford à l’école primaire française Cet article est le fruit d’une collaboration avec Frédérique Vayssac, Professeure des écoles à Lyon et Flavien Chervet, Président Exoflow et ancien étudiant IDEA (emlyon/Ecole Centrale). Le design thinking, méthode d’innovation déjà ancienne, a fait irruption dans les entreprises de façon récente, en réponse à l’impératif d’innovation généralisée. Issue de l’université de Stanford, et plus particulièrement de son école de Design, la D.School, la démarche est restée limitée dans les années 60 aux milieux confidentiels du design industriel. Les ouvrages de Peter Rowe et de Tim Brown ont popularisé, et ouvert à d’autres univers, cette approche créative, collaborative et itérative. Expérience utilisateur Pour faire simple, le design thinking permet de passer d’une logique d’innovation limitée au seul produit, ou service, à la prise en compte de l’expérience utilisateur, sous forme d’usage rationnel et émotionnel. Aujourd’hui, le design thinking est abondamment mobilisé par les entreprises.
Qu'est-ce que le Design Thinking ? - Prim à bord Le Design Thinking est une méthodologie issue du monde des designers qui s’étend aujourd’hui à toutes les sphères professionnelles. Elle s’applique à toute sorte de projet dont l’objectif consiste à inventer un nouveau concept, service, objet pour répondre à un besoin. Il s’agit d’une méthode d’innovation centrée sur la créativité . Depuis une trentaine d’années, le développement du Design Thinking a reçu plusieurs déclinaisons méthodologiques. Dans les années 90, l’approche centrée sur la résolution de problème en lien avec l’intelligence collective s’est développée autour de cinq principales phases : Empathie : identifier la problématique, être à l’écoute du besoin, comprendre l’utilisateur, ce qu’il fait ressent et dit de son environnement. Plus qu’un simple processus, le Design Thinking représente un état d’esprit, une façon d’appréhender les problématiques d’où les expressions de “Pensée Design” et “Esprit Design”. Des exemples dans le monde éducatif : Un dispositif en réseau :
Design and Thinking, un documentaire complet sur le design thinking Ce documentaire se base sur les fondamentaux du design thinking en se concentrant sur les problèmes qui impactent notre société, nous les humains dans notre quotidien. En faisant le parallèle avec le design comme une solution à ces problèmes. Le design thinking est présenté comme une méthode différente pour régler situations problématiques que celle que nous utilisons actuellement. Le documentaire va faire le tour des produits ou solutions qui ont été conçues grâce au design thinking. Comme par exemple, une seringue propre et sécurisée, des vélos personnalisables à souhait, ou des tests de grossesse pas cher grâce aux oeufs de grenouilles. En se posant les bonnes questions et aux bonnes personnes, ces personnes ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Grâce à se documentaire on remarque largement que le design thinking et ses valeurs sont applicables à tous les domaines, de la recherche scientifique à l’économie mondiale en passant par l’innovation technologique.
L’univers du Design Thinking | Zeboute' Blog Au premier abord, faire du Design thinking est troublant. On redevient enfant. On mange des bonbons et on peut dire tout ce qu’on veut. Bizarre dans le cadre professionnel… J’ai testé le Design thinking et allez, suivez moi ! A quoi sert le Design Thinking ? Le Design thinking est là pour déstructurer nos schémas de conception et de perception habituels. Surtout dans un monde agile, où l’innovation s’accélère et peut s’inscrire rapidement de manière tangible dans le monde réel. Le design thinking est une mise en scène. Et c’est là l’essentiel : mettre l’humain au centre de la place. Le lieu doit être accueillant. Se sentir bien. Loin des salariés lambda qui eux souffrent de leur conditions de travail. Le design thinking est là pour révéler l’intelligence collective. Et concentrer L’esprit. La partition est écrite par le coach du Design thinking qui a règlé toute la pièce, en plusieurs actes : Empathize : Define : Ideate : Prototype : Test : Seul reste le jeu des acteurs, de ce processus.
À lire ailleurs : « Les bibliothèques et les voies de l’innovation » L’Agence Régionale du Livre de Haute-Normandie m’a interviewé pour le dernier numéro de la revue Publication(s), qui comporte un dossier consacré à l’innovation en bibliothèque. Dans ce bref entretien, je parle de design thinking, du #ProjetBayeux (évidemment), mais aussi du fait de s’inspirer d’autres univers professionnels pour transformer nos pratiques (ce que l’on fera à Bayeux, avec un classement thématique inspiré du monde de la librairie et pour la valorisation des collections, que l’on souhaite renouveler en puisant dans les techniques de merchandising). Félicitations au journaliste Luc Duthil qui a retranscrit de façon synthétique une (très) longue discussion que nous avons eu ensemble ! Publication(s) numéro 33 peut être téléchargé directement ici ou bien feuilleté sur le site de l’ARL.
Réapprendre à s’étonner et à innover avec le design thinking Dans la méthode du design thinking, le travail de compréhension, d’observation, d’exploration et de production d’« insights » est au cœur de la démarche. Les phases de « compréhension » (Empathize) et « d’observation » (Define) sont inter-reliées, elles s’alimentent et se complètent pour fournir un ensemble d’insights susceptibles d’alimenter la phase d’idéation (Ideate). Pour la Hasso Plattner (Institut de design de Stanford), l’empathie, faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui et de percevoir ce qu’il ressent, est le pilier du design thinking. Centrée sur l’humain, elle offre la possibilité d’identifier des insights de ce que les individus pensent, ressentent et expérimentent. Mais selon la Hasso Plattner, l’identification de ces insights est difficile et dans tous les cas toujours plus difficile que ce que les individus imaginent. Identifier les « bruits de fond » qui cadrent les représentations et les actions Identifier les signaux faibles porteurs d’anticipation
Qu’est-ce que le design thinking ? Dans mon billet précédent, je soulignais l’importance de l’innovation en bibliothèque. Mais comment s’y prendre pour innover ? Doit-on se fier uniquement à l’intuition ou bien y a t-il des outils sur lesquels s’appuyer ? Dans ce billet, je vais parler du design thinking, une méthode née dans les ateliers des designers mais qui s’étend désormais à toutes les sphères où l’on cherche à innover : industrie, technologie, services… et même la culture. Si vous avez vu le tag « Management » au bas de cet article vous vous apprêtez peut-être à aller voir ailleurs en imaginant un article super barbant. Une méthode pour la conduite de projets innovants Le design thinking a aujourd’hui de nombreux promoteurs mais les définitions varient beaucoup en fonction des cas. Brown est président d’IDEO, une société de conseil dont les membres fondateurs ont notamment créé la première souris pour Apple en 1980. En termes de management, on se situe dans un cadre bien précis : la conduite de projet.
Le vocabulaire du design thinking Début 2017, j’ai eu le plaisir de diriger le numéro de la revue I2D consacré au design thinking. Le billet qui suit est une version légèrement remaniée d’un texte que j’ai rédigé pour clarifier certains termes récurrents dans le dossier. C’est une démarche un peu scolaire mais qui me semble importante. En effet, certaines personnes peuvent être sceptiques face à un jargon nouveau qui devient subitement à la mode. Pourtant, il n’y a aucune entourloupe cachée derrière des mots obscurs au premier abord, comme « idéation », « itération », « prototypage »… C’est juste que des idées nouvelles nécessitent parfois des mots nouveaux ou inhabituels. Le reste du dossier, qui contient une vingtaine de contributions de bibliothécaires, de designers ou d’experts UX, est accessible en ligne sur Cairn. Pour en savoir plus : Un billet de blog assez dense que j’ai rédigé au sujet du co-design dans les bibliothèques d’Helsinki. L’empathie est la capacité à se mettre à la place d’autrui.
Du design thinking au design éthique : redonner du sens à l’innovation - Mais où va le Web Le design thinking est une méthode d’innovation qui tire ses racines de pratiques exercées sur la côte ouest des Etats-Unis depuis les années 50. Ces pratiques connaissent un regain de vitalité, notamment pour faire face à des marchés devenus liquides et dans lesquels la fidélité des consommateurs reste sans cesse à reconquérir. Le crédo : mieux répondre aux besoins réels et non supposés des consommateurs en remettant « l’humain au centre ». De l’unique Ford T issue des chaînes du taylorisme à la variété des modèles que chacun peut désormais obtenir en claquant des doigts, les processus de production collent désormais au plus près des « besoins » des consommateurs. « Besoins » définis à l’intérieur d’un cadre de pensée lui même circonscrit à une certaine vision de l’Homme. Warning : cet article va vous demander quelques minutes de lecture, vous feriez bien d’aller vous chercher une tasse de café ! L’humain en nous souhaite la préservation de l’environnement. Que doit-on en conclure ?