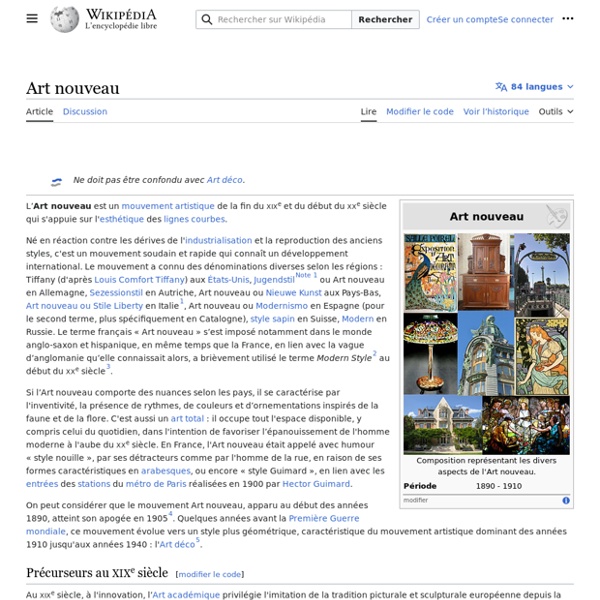Brutalisme
Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes »(janvier 2020). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. Tour de la Sécurité Sociale à Rennes, France (Bretagne), réalisé par Claude Flambeau en 1965. Le brutalisme désigne un style architectural issu du mouvement moderne, qui connaît une grande popularité entre les années 1950 et 1970 avant de décliner peu à peu, bien que divers architectes s'inspirent encore des principes de ce courant.
Japonisme
Le japonisme est l'influence de la civilisation et de l'art japonais sur les artistes et écrivains, premièrement français, puis Occidentaux, entre les années 1860 et 1890. L'art qui résulta de cette influence, notamment en réaction au classicisme et qui initie de nouveaux choix esthétiques (lignes courbes, éléments naturels), est qualifié de japonesque. Dans le dernier quart du XIXe siècle, l’ukiyo-e devient une nouvelle source d'inspiration pour les peintres impressionnistes européens puis pour les artistes Art nouveau.
marguillier
Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire. Français[modifier | modifier le wikicode] Étymologie[modifier | modifier le wikicode] (1510) Du latin matricularius, dérivé de matricula (« matricule »).
Architecture néo-classique
La vogue du romantisme remplaça l'architecture néo-classique avec des réalisations néo-gothiques dans le courant du XIXe siècle. L'origine du style[modifier | modifier le code] L'architecture néo-classique est l'héritière de l'architecture classique, théorisée par l'architecte antique Vitruve dans son traité qui définit la théorie des trois ordres (ionique, dorique, corinthien). Vitruve sera la grande référence des architectes pour qualifier le renouveau du recours à des formes antiques, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, jusqu'en 1850 environ. L'architecture néo-classique prétend avoir recours à des formes grecques, plus qu'italiennes, ainsi elle est appelée goût grec à ses débuts en France vers 1760.
Suprématisme
Le suprématisme est un mouvement d'art moderne, né en Russie, au début du XXe siècle. Son « créateur » est Kasimir Malevitch (1878-1935), qui présente en 1915 un premier ensemble de 39 tableaux suprématistes lors de la « Dernière exposition futuriste de tableaux 0.10 (zéro-dix) », tenue à Pétrograd du 19 décembre 1915 au 19 janvier 1916. En fait partie Quadrangle, surtout connu comme Carré noir sur fond blanc, que Malevitch forgera plus tard en œuvre emblème du suprématisme[2],[3]. Le suprématisme se développe à partir de 1915 avec Malevitch, mais aussi El Lissitzky, Ivan Kliun, Ivan Puni ou Olga Rozanova, toujours en Russie.
Historique de l´Hôtel de Ville
Vous êtes ici : Administration > Historique de l'Hôtel de Ville Suggérez cette page à un ami Les 800 ans de l'Hôtel de Ville du Cabaret des Echevins à la maison des Citoyens L'année 2013 a marqué les 800 ans de l'Hotel de Ville de Namur. A cette occasion une exposition a été organisée à la Galerie du Beffroi. 14 panneaux reprenant l'essentiel de l'histoire de l'Hôtel de Ville ont été réalisés pour cette exposition.
Art déco
Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes »(décembre 2013). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. L'Art déco est un mouvement artistique né au cours des années 1910 et qui a pris son plein épanouissement au cours des années 1920 avant de décliner à partir des années 1930. C'est le premier mouvement architecture-décoration de nature mondiale. Le style Art déco tire son nom de l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925[1].
Cubo-futurisme
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le cubo-futurisme russe est représenté par plusieurs œuvres de Lioubov Popova, notamment [Portrait] en 1914. Ce mouvement impulse ses idées vers l'architecture à travers son travail du mouvement et du dynamisme plastique (plan, ligne et texture.) Bibliographie[modifier | modifier le code] Giovanni Lista, « Futurisme et Cubo-futurisme » in Les Cahiers du Musée national d'art moderne, no 5, septembre 1980, Paris, p. 456-495.Giovanni Lista, « La Poétique du cubo-futurisme chez Fernand Léger » in Fernand Léger, Musée d’Art Moderne, 3 mars-17 juin 1990, Villeneuve d’Ascq.Giovanni Lista (éditeur), Ligeia, dossiers sur l’art : cubo-futurisme, no 21-22-23-24, octobre 1997-juin 1998, Paris.Giovanni Lista, Le Futurisme : création et avant-garde, éd. Voir aussi[modifier | modifier le code]
Namur La maison d'accueil «Les Trieux» fête ses dix ans Un
Namur La maison d'accueil «Les Trieux» fête ses dix ans Une porte ouverte sur une nouvelle vie «On repasse souvent pour dire bonjour» Page 19 Vendredi 2 février 2001 Namur La maison d'accueil «Les Trieux» fête ses dix ans Une porte ouverte sur une nouvelle vie
Stańczyk (Jan Matejko)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Stańczyk ou Stańczyk durant un bal à la cour de la reine Bona après la perte de Smoleńsk est un tableau peint par Jan Matejko en 1862. Il représente Stańczyk, un des plus célèbres bouffons de Pologne, durant le règne de Sigismond Ier de Pologne. Le tableau est une des œuvres les plus célèbres de Jan Matejko et l'un des plus connus de la peinture polonaise.
Symbolisme
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Sauter à la navigationSauter à la recherche Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : symbolisme, sur le Wiktionnaire
Quartier (ville)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir quartier. Un quartier est une division administrative ou géographique d'une ville.