


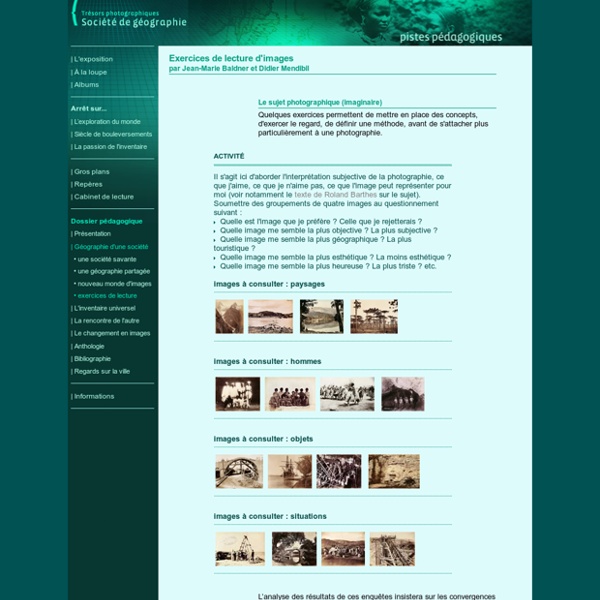
Séance n°3. L'image et sa légende Dominante : Lecture de l’image Photographies 1 à 6 de Yann Arthus-Bertrand Analyse de la fonction d’ancrage réciproque du texte et de l’image (le texte ancre l’image) Découvrir la notion de polysémie de l’image. Découvrir l’importance de la légende comme ancrage de l’image. Jouer avec l’image Etre capable d’écrire des légendes et des commentaires imaginaires à la manière des textes qui accompagnent les photos de Y. Transition avec les séances 1 et 2 Vous avez vu que l’image permet de mieux se représenter le lieu décrit par le texte. I. 1) Distribution des photographies 1 à 3 sans légendes Consigne 1 : Que peuvent représenter ces photos ? Consigne 2 : Vous donnerez un titre à cette photographie, et vous établirez une légende. 2) Noter dans le cours : définition et importance de la légende II. 1) Distribution de la photographie n°4 sans légende. Consigne 1 : Que voyez-vous ? Consigne 2 : quel est l’effet de la lecture de la légende sur la façon qu’on a de regarder l’image ? III. IV.
Histoire de la photographie - Musée Photo Maison Nicéphore Niépce Nicéphore Niépce et Daguerre Le premier procédé photographique ou héliographie a été inventé par Nicéphore Niépce vers 1824. Les images étaient obtenues avec du bitume de Judée étendu sur une plaque d’argent, après un temps de pose de plusieurs jours. En 1829, Niépce associa à ses recherches, Louis Jacques Mandé Daguerre. Hippolyte Bayard, 1801-1887 Niépce mort en 1833, Daguerre continua seul les travaux et inventa, en 1838, le daguerréotype, premier procédé comportant une étape de développement. Hippolyte Bayard En juillet 1839, un autre français Hippolyte Bayard découvrit le moyen d’obtenir des images directement positives sur papier. Fox Talbot, 1800-1877 William Henry Fox Talbot Toujours en 1839, l’annonce de l’invention du daguerréotype incita l’anglais William Henry Fox Talbot à reprendre des recherches interrompues, dont les débuts remontaient à 1834. John Herschell John Herschell, 1792-1871 Hippolyte Fizeau Abel Niépce de Saint-Victor,remplace le papier par du verre. Scott Archer
Expositions itinérantes gratuites Ce site vous propose, grâce à des partenariats, des expositions gratuites en ligne. C'est le résultat d'un partenariat avec le Musée du Vivant-AgroParisTech, premier musée international sur l'écologie et le développement durable (www.museeduvivant.fr). D'autres institutions peuvent s'agréger bien sûr. Les expositions sont conçues pour être présentées partout (écoles, collèges, lycées, universités, centres culturels à l'étranger, municipalités, entreprises, médiathèques, espaces publics...). Pensez aussi à vous inscrire dans le Réseau decryptimages, c'est gratuit et sans obligation. Premières expositions disponibles en ligne :
Comment les journaux ont choisi leurs photos de unes sur les attentats Libération En début de soirée, Libération publie une première version de leur une. Elle montre des corps recouverts de draps blancs devant le bar Le Carillon, rue Bichat. «Nous avions une couverture photo assurée par certains de nos photographes mais aucune image n’était assez forte alors nous avons utilisé une photo du «fil» [là où les différentes agences de presse diffusent des photos pour les rédactions, ndlr]», raconte Isabelle Grattard, chef de service au service photo du journal. «Nous avions une manchette forte qui mettait en avant le carnage alors nous avons pris le parti de montrer le travail des secours. Wall Street Journal Au Wall Street Journal, le choix de l'image de leur édition du week-end a fait l'unanimité dans la rédaction. La rédaction du WSJ a préparé trois unes à différents moments de la nuit. Le Parisien De façon exceptionnelle, Le Parisien a publié deux éditions ce 14 novembre. «Nous assumons la violence de cette image.
Les premières photographies de l'histoire La première photographie de l’histoire a été prise au mois d’août 1826, en Bourgogne par le Français Nicéphore Niépce (1765-1833). La photographie, intitulée le Point de vue du Gras, est prise depuis la fenêtre de sa maison de Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône, sur une plaque d’étain grâce au bitume de Judée, poudre dérivée du pétrole. Elle nécessita dix heures de temps de pose. Première photographie d’êtres humains Daguerréotype du Pont neuf et de la statue d’Henri IV à Paris par Louis Daguerre vers 1837. A gauche, deux personnes assises par terre près de la statue. Un matin d’avril 1838, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), ancien associé de Nicéphore Niépce, prend cette photo du boulevard du Temple de la fenêtre de son appartement, où se situe aujourd’hui la caserne de la place de la République. Premier autoportrait de l’Histoire L’un des premiers autoportraits photographiques est celui de Robert Cornelius (1809–1893). Première composition photographique
Exposition “Frontières” | Musée national de l'histoire de l'immigration L'exposition Si l’on excepte les frontières naturelles, qui ont constitué depuis les premières civilisations des barrières physiques à la mobilité humaine (océans, chaînes de montagne, fleuves), les frontières édifiées de main de l’homme ont eu tout d’abord la vocation de marquer son territoire, de se protéger de l’autre, du “barbare”. Les vestiges du mur d’Hadrien en Grande-Bretagne ou la Grande muraille de Chine attestent, en des temps et des lieux distincts, de ces préoccupations. Les frontières y compris intérieures ont également eu pour objectif majeur de contrôler les échanges de marchandises et les recettes fiscales des pouvoirs en place. La structuration d’un monde en “blocs”, empires coloniaux, bloc communiste, a connu son apogée puis son effondrement à la fin du XXe siècle. Il convient de s’interroger aujourd'hui sur la réalité à laquelle renvoie la notion de frontière. Commissariat scientifique Catherine Wihtol de Wenden, docteur en science politique. Catalogue de l'exposition
Ces photos trompeuses qui circulent après les attentats du 13 novembre à Paris Certains internautes profitent de l’émotion collective pour manipuler des images sur les réseaux sociaux. Le Monde.fr | • Mis à jour le | Par Les Décodeurs Entretenir la psychose, faire le buzz, diffuser de fausses informations pour attiser la haine… Les photos détournées qui ont commencé à circuler après les attentats de Paris montrent une nouvelle fois combien certains internautes profitent de l’émotion collective pour manipuler les images à des fins peu avouables, sans que ceux qui les partagent ne s’aperçoivent de la tromperie. En voici quelques exemples, repérés samedi 14 novembre sur Twitter. Lire Situations de crise : 7 conseils pour déjouer les rumeurs Des scènes de joie à Gaza… qui datent de 2012 Les attentats de Paris ont-ils provoqué des réjouissances dans les territoires palestiniens, comme l’affirmait cet internaute sur Twitter (l’auteur a supprimé son tweet depuis) ? Des rues parisiennes désertes… en plein mois d’août Des faux messages de la mairie de Paris Or il n’en est rien.
Petite histoire de la photographie Voici une très rapide histoire de la photographie. Mon document original, sous forme de diaporama powerpoint à montrer aux élèves, s’accompagne de nombreuses illustrations, que je ne peux reproduire ici, pour des questions de droit… Mais les curieux les retrouveront facilement sur Internet, avec les références indiquées. Vous trouverez à la fin une fiche pédagogique... I – L’origine de la photographie 1) Découverte optique : la chambre noire Toute l'histoire de la photographie tourne autour d’un principe d’optique : Quand la lumière pénètre par un petit trou (appelé sténopé) dans un espace fermé et sombre, l’image inversée de ce qui se trouve dehors se forme sur le mur opposé. Ce procédé était déjà connu dans l’Antiquité. Aristote, (Grèce, IVe siècle avant J.C.) fait part à travers ses écrits de l'utilisation de cette technique afin d'observer le ciel et les éclipses solaires. On fabriquait des pièces spéciales pour les peintres. 2) Découverte physique : la lentille II – Evolutions techniques