

Le cerveau est une bande-passante. Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Harvard Magazine «Si je fais de vous un pauvre du jour au lendemain, vous commencerez probablement à vous comporter comme vous pensez qu’un pauvre se comporte», explique Sendhil Mullainathan, économiste et professeur de Harvard, à la journaliste Cara Feinberg dans Harvard-Magazine.

En 2013, l’enseignant a publié avec son collègue Eldar Shafir le livre Why having too little means so much, évoquant l’influence du sentiment de pénurie et de pauvreté sur le processus de décision des individus. Il revient aujourd’hui sur leurs observations et l’écho qu’elles pourraient trouver à présent dans le monde politique et le travail social. À grands traits, on pourrait résumer la pensée des deux chercheurs ainsi: l’esprit humain est comparable à une bande-passante, laquelle nous permet de faire fonctionner nos facultés intellectuelles et physiques. Le problème, c’est que les soucis matériels y prennent une importance démesurée. Action forgée par les circonstances. Mythologie de la cabane en marche, et de l'an 01.
L'émergence des cabanes est une nouveauté sociologique du paysage !

Qu'elles soient construites par des gilets jaunes, des zadistes, des amoureux, ou des marginaux, elles apparaissent comme les symboles d'un nouveau mode de relation au monde. Revient en écho les années 70, et les utopies, qu'on avait oubliées. Mais elles mêmes ne s'inspiraient-elles pas de courants plus anciens ? " Il n’y a personne, il y a tout le monde. On ne sait pas, ça prend comme une mayonnaise ! Le film s’en prend aux valeurs du productivisme, à l’uniformité qui en découle, et à tous les formatages. . « Alexandre le bienheureux » d’Yves Robert, a été tourné en 67, et « Les valseuses », de Bertrand Blier en 74.
"Dègraissement " fut le mot qui sortit des cuisines pour migrer vers la direction du personnel qui ne tarda pas à s’appeler "direction des ressources humaines". Les cabanes sont au beau milieu du rond point. C’est qu’ils ont reconnu ce vieux rêve libertaire, surgi brutalement de leur enfance. Nature morte et nouvelles vanités. Petit résumé historique Introduit dans la peinture au XVIIe siècle, le terme de « Nature morte » désignait alors la représentation d’objets et de simples modèles inanimés.

Dans les écoles d’Art de l’époque, la peinture était hiérarchisée en canons bien définis où le summum était occupé par la scène historique d’inspiration biblique (pour tendre vers l’immortalité), venait ensuite le portrait et enfin la représentation du vivant. Le paysage et surtout la peinture d’objets, constituaient le rang inférieur de par leur nature « inanimée », c’est-à-dire « sans âme ». Dès le Moyen-âge, les objets étaient pourtant traités dans une technique illusionniste très réaliste qui avait pour but de « tromper l’œil » du spectateur. Cette vocation « hyperréaliste » d’avant l’heure eût un succès grandissant auprès des collectionneurs bourgeois qui appréciaient la représentation du luxe et des plaisirs.
Aporie ( Hiroshima mon amour ) 2.
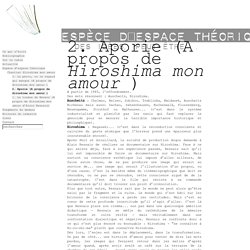
Aporie (A propos de Hiroshima mon amour ) Conquête spatiale, aberration ufologique. Par Camille Loty Malebranche L'homme contemporain, à la fois prométhéen et faustien, ne sait qu’incinérer le destin terrestre et vivre dans la tératologie d'une mégalomanie aux inepties les plus démentes, qu'enjolive le prétexte scientifique des tenants d'un certain scientisme officiel médiatisé.

Quand l'axiologie nie les valeurs spirituelles et morales, les plus sublimes conquêtes technologiques et envols scientifiques seront toujours détournés voire principalement utilisés au service de la réification de l'homme par l'homme, du crime, de la cruauté de certains hommes pour dominer et massacrer leurs semblables... Ainsi, après le nucléaire et son danger encore présent d'hécatombe planétaire, l'ère des satellites est-elle ternie par la surveillance des peuples et pays par des puissances militaires bellicistes; la percée de la cybernétique se vautre dans la fange assassine des drones sicaires; et des mythes loufoques sont concoctés pour manipuler l'imaginaire collectif! Et l’homme inventa la pensée. Réfléchissant à l’histoire de l’humanité au cours des derniers millénaires, quelques penseurs européens des XVIIIe et XIXe siècles ont noté une surprenante coïncidence.

Bon nombre des personnages les plus influents de l’histoire du monde ont vécu au milieu du Ier millénaire av. J. -C., plus précisément entre – 800 et – 200 à peu près : Confucius en Chine ; Bouddha en Inde ; les prophètes d’Israël (Amos, Isaïe, Jérémie) en Judée ; Socrate, Platon et Aristote en Grèce ; et Zarathoustra (Zoroastre) en Iran. Même si de nouvelles recherches ont récemment conduit à situer Zarathoustra à une époque antérieure, cette concomitance n’en reste pas moins impressionnante.
L’orientaliste français Anquetil-Duperron est probablement le premier à avoir attiré l’attention sur le phénomène, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (1). Tous, dans l’Europe d’alors, voyaient la vie de Jésus-Christ comme le grand tournant de l’humanité.