


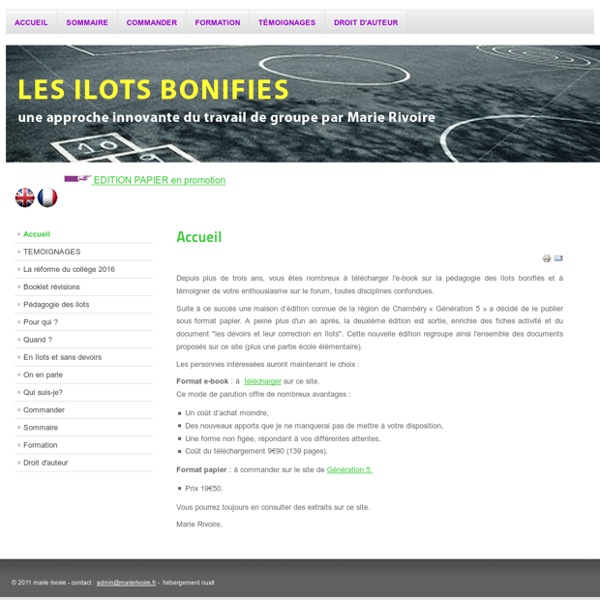
Ordres et Désordres. Enquête sur un nouveau paradigme, Jean-Pierre Dupuy, Sciences humaines Enfin libérée des catéchismes idéologiques, émancipée de tous les dogmes simplificateurs, à quelques années de l'an 2000, une pensée neuve se cherche. Un nouveau paradigme que des auteurs, ici et là, s'efforcent d'articuler. Il s'agit tout à la fois d'échapper aux réductionnismes d'avant-hier, de refonder l'autonomie de l'homme sur l'échec des vieux déterminismes, de bâtir un pont entre deux cultures — "scientifique" et "littéraire" — dont le divorce, sans cesse aggravé, n'est ni acceptable ni inéluctable. Il s'agit en bref d'apprendre à "penser la complexité". Encore inconnus du grand public, et chacun dans son domaine, des chercheurs s'emploient à banaliser ces nouvelles routes. Des concepts souvent mal compris circulent déjà d'une discipline à l'autre : "hasard organisateur", "auto-organisation", "ordre par le bruit", "système auto-référentiel", etc.
pourqoiletdgde.pdf Les comportements dans les groupes de travail Tout dirigeant, chef de service, chef de groupe est régulièrement conduit à réunir les membres du groupe dont il est responsable pour résoudre ou prévenir un problème constaté ou pressenti. Mais chacun a pu constater, d’expérience personnelle ou professionnelle, que ces réunions pouvaient être très productives et gratifiantes pour tous ou improductives et très frustrantes. Dès lors, il est indispensable à tout dirigeant d’avoir les moyens de mieux comprendre les comportements observables dans les réunions de groupes ou équipe de travail afin de mieux adapter sa réaction. Comment fonctionnent ces réunions, quels rôles peuvent y être joués, qu’est-ce qui peut conduire le responsable à atteindre ses objectifs ou à plus ou moins échouer ? Voici deux modèles explicatifs, le modèle de base et l’une de ses améliorations récentes. Le modèle de base. Pourtant les comportements alors observables peuvent être très divers, voire contraires à l’objectif. 1.1. Les rôles de tâche Les rôles de solidarité 1.2.
Principe d’engagement actif, d’attention et de plaisir Comment faciliter au maximum l’apprentissage? Les recherches en neurosciences ont identifié plusieurs facteurs qui modulent la vitesse de l’apprentissage et la durée de la mémoire : L’engagement actif de l’enfant Pour apprendre rapidement, l’enfant doit être sollicité, engagé, actif. L’attention Faire attention à un aspect du monde extérieur amplifie massivement l’activation cérébrale qu’il évoque. Le plaisir L’apprentissage est facilité lorsque l’enfant est récompensé de ses efforts. Nos recommandations En résumé, l’enseignant doit proposer un environnement motivant, où l’enfant soit actif, trouve du plaisir à apprendre, se sente autorisé à faire des erreurs (mais soit rapidement corrigé), et toujours récompensé de ses efforts. Les activités doivent être ludiques et faire appel, par exemple, à des jeux de rimes, des comptines, des « mots tordus », etc.
Enseignement aux grands groupes À l’université, particulièrement lors de la première année des programmes d’études, il n’est pas rare de rencontrer des groupes qui comptent de nombreux étudiants. Qu’il comporte 35, 80 ou 300 étudiants, la taille d’un groupe ainsi que l’espace dans lequel se déroule un cours influenceront certains choix de l’enseignant comme la planification pédagogique, le choix des méthodes d’enseignement, les interactions ainsi que les modalités d’évaluation du cours. Bien se préparer Les défis de l’enseignement à un grand groupe peuvent parfois paraître plus grands aux yeux des enseignants, pouvant même devenir une source de stress pour certains d’entre eux. Une façon efficace de surmonter le stress associé à l’enseignement à un grand groupe est de bien se préparer à enseigner dans un tel contexte pour être en mesure d’anticiper les écueils potentiels. Enseigner à un grand groupe Tenir compte de la courbe d’attention Interagir avec un large auditoire Évaluer un grand nombre d’étudiants
Mon intervention au Colloque européen contre le décrochage scolaire. | Classe maternelle, Gennevilliers Le 8 mai 2015, j’ai été invitée au Colloque européen sur le décrochage scolaire à Bruxelles pour exposer le travail réalisé dans la classe maternelle de Gennevilliers. Ce colloque s’est organisé avec la présence de Joëlle Milquet, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance en Wallonie-Bruxelles et de Mr Éric Charbonnier, analyste et expert en éducation au sein de la Direction de l’Education et des Compétences de l’OCDE. Ce fut l’occasion de faire de belles rencontres, et de partager un message : Quels sont les potentiels de l’Homme lorsqu’on lui laisse la possibilité de s’épanouir dans un environnement respectueux de ses besoins ? Les connaissons-nous ? Sur le même thème Actus ! Vous pourrez désormais trouver toutes les vidéos du blog sur une chaîne YouTube. Dans "Actualités" Colloque Education & Bien-être Le bonheur a-t-il sa place à l’école ? Dans "Publications & Interventions" Socialter - Numéro spécial Education
Le groupe en psychologie sociale Creuset de la formation de l'individu, qu'il soit redouté ou recherché, le groupe reste un élément nécessaire à la socialisation. La victoire de l'équipe de France en coupe du monde, la violence des bandes dans les banlieues... La vie des groupes fait parfois les titres de l'actualité. Avant d'être un objet scientifique, le groupe est en effet un objet de croyances. La force des croyances à propos du groupe n'en rend pas aisée l'investigation scientifique. Comment définir le groupe ? Quand il est question de définir le groupe, on s'accorde plus volontiers sur des définitions négatives (ce qu'il n'est pas) que sur des définitions affirmatives. Ainsi, l'agrégat des personnes qui forment cette file d'attente au bureau de poste se transformera en groupe lorsque, se mettant à interagir entre elles, ces personnes échangeront leurs représentations du service public et s'organiseront pour engager ensemble une action de contestation visant à obtenir que plus de guichets soient ouverts.
L'attention et le contrôle exécutif - Psychologie cognitive expérimentale - Stanislas Dehaene - Collège de France - 13 janvier 2015 09:30 Les sciences cognitives ont identifié au moins quatre grands facteurs clés que l’on peut qualifier de « piliers de l’apprentissage » dans la mesure où ils jouent un rôle déterminant dans la vitesse et la facilité de l’ensemble des apprentissages scolaires : l’attention ; l’engagement actif de l’enfant ; le retour rapide d’informations ; et la consolidation quotidienne des apprentissages. Commençons par l’attention, qui peut être définie comme l’ensemble des mécanismes par lesquels le cerveau sélectionne une information et en oriente le traitement. Le psychologue américain Michael Posner distingue au moins trois systèmes attentionnels : l’alerte, qui module globalement le niveau de vigilance ; l’orientation de l’attention, qui sélectionne un objet ; et le contrôle exécutif, qui sélectionne la chaîne de traitements appropriée à une tâche donnée et en contrôle l’exécution. Les systèmes cérébraux d’alerte et de vigilance signalent quand il convient de faire attention.
Travail de groupes, tutorat… : revoir la conférence virtuelle Le Cnesco a organisé, mercredi 17 janvier, sa deuxième conférence virtuelle interactive sur le thème de la différenciation pédagogique : Travail de groupes, tutorat… : comment faire travailler les élèves entre eux ? Cette conférence était animée par Nathalie Mons, présidente du Cnesco et professeure de sociologie à l’université de Cergy-Pontoise. Elle a fait intervenir : Céline Buchs, maître d’enseignement et de recherche à l’université de Genève et Yann Volpé, enseignant au primaire et chargé d’enseignement à l’université de Genève.
Neurosciences et numérique pour une pédagogie du succès Un autre regard sur l’échec scolaire Avec la rentrée des classes, les préoccupation des parents, des enseignants et de l’ensemble de la communauté éducative se tournent vers les challenges de cette nouvelle année scolaire. Beaucoup de discours mentionnent la "lutte contre l’échec scolaire" et il est évident que cette question mérite toute notre attention. Ainsi, sans entrer dans une analyse détaillée des statistiques de l’échec scolaire, on observe, en consultant la dernière livraison des "Indicateurs de l’enseignement 2013" publiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’un nombre important de nos enfants sortent de l’enseignement primaire et secondaire avec une ou plusieurs années de retard. Ainsi en 2012, dès la fin de l’école primaire, près de 22% des élèves accusent déjà un retard d’une année au moins et 4% de deux ans ou plus. Comprendre l’acte d’apprentissage Neurosciences et TICE l’attention. Les TIC comme levier pour l’enseignement Pour en savoir plus Quelques livres :
La coopération entre élèves c'est efficace ? "La recherche montre que les élèves qui bénéficient de dispositifs de coopération entre pairs vont avoir de meilleurs apprentissages et que les apprentissages se transfèreront quand ils travaillent de façon individuelle". Invités par le Cnesco et l'IFé dans le cadre d'une conférence virtuelle, Céline Buchs et Yann Volpé (Université de Genève) ont fait le point sur les dispositifs d'apprentissage entre pairs. S'ils s'avèrent efficaces et s'ils préparent les élèves aux "compétences du 21ème siècle", ils demandent aussi aux enseignants des compétences et un travail d'organisation important. Une réponse à l'hétérogénéité Qu'entend on par coopération entre élèves ? Céline Buchs a d'abord présenté ce que l'on sait des travaux de groupe. Comment composer les groupes ? Comment composer les groupes ? Céline Buchs met l'accent sur le fonctionnement du groupe. Yann Volpé est intervenu sur le tutorat entre élèves, une pratique encore assez rare. Enseigner la coopération explicitement François Jarraud
Les pratiques collaboratives dans l'éducation - François Taddei Paris Innovation Review – Nos systèmes éducatifs sont-ils toujours adaptés à un monde qui change à une vitesse sans cesse plus grande, qui est de moins en moins vertical et hiérarchique et de plus en plus horizontal et collaboratif ? François Taddei – Nos systèmes éducatifs sont fondés sur la résolution de problèmes classiques. Typiquement, pour entrer dans une grande école, il faut passer des concours qui consistent pour l’essentiel à résoudre des problèmes ordinaires. Le problème avec la première forme d’intelligence (la résolution de problèmes classiques), c’est que les machines savent l’appliquer. Pourquoi est-il si important d’apprendre à travailler en collectif ? Nous sommes confrontés dans le monde entier à des problèmes qu’on ne sait pas résoudre. Il est particulièrement intéressant de voir que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) va commencer à mesurer la résolution collaborative de problèmes à partir de 2015 dans le cadre de son programme PISA.
Ifé - Veille et analyses La coopération entre élèves : des recherches aux pratiques N° 114, décembre 2016 portrait Auteur(s) : Reverdy Catherine Télécharger la version intégrale du dossier (version PDF) Résumé : À l’heure où le travail en équipe, l’intelligence collective et le travail collaboratif en projet sont ancrés dans le monde du travail, que les idées de collectifs citoyens, de fablabs et d’échanges de savoirs se développent, que se passe-t-il à l’école ? Ce Dossier interroge la manière de mettre en œuvre la coopération dans les classes, à l’appui des recherches en éducation. Côté enseignement, pour mettre en place cet apprentissage coopératif, l’enseignant.e peut organiser les situations de coopération selon différentes modalités qui dépendent des objectifs d’apprentissage visés : ce peut être le tutorat, où un.e élève est expert.e, l’autre novice ; ou encore l’aide spontanée entre les élèves, pour pallier les difficultés ponctuelles. Abstract :
L'enseignement explicite : une méthode adaptée pour les élèves en difficulté Il y a une petite guerre dans le milieu de l'éducation. Pas de panique, ce conflit n'a rien de dangereux. Il n'est qu'idéologique. Or, un autre camp, celui d'un enseignement plus explicite est en train de reprendre de la vigueur depuis quelques années. Explicite n'est pas que magistral Même s'il s'agit d'une méthode plus « passive », il serait plus qu'erroné de croire que l'enseignement explicite n'est qu'une nouvelle façon de nommer les cours magistraux. Ensuite, les cours se déroulent en trois volets. Par la suite, une fois la nouvelle notion inculquée, c'est la pratique guidée qui se met en place. Aider les élèves en difficulté Mais pourquoi cette approche revient-elle peu à peu dans l'actualité éducative? Toutefois, comme le précise le chercheur Clément Gauthier dans un papier publié en novembre 2014, il ne faudrait pas voir cette approche comme un nouveau dogme. Par contre, il faut savoir qu'elle est extrêmement exigeante pour le professeur. Références Appy, Bernard.