


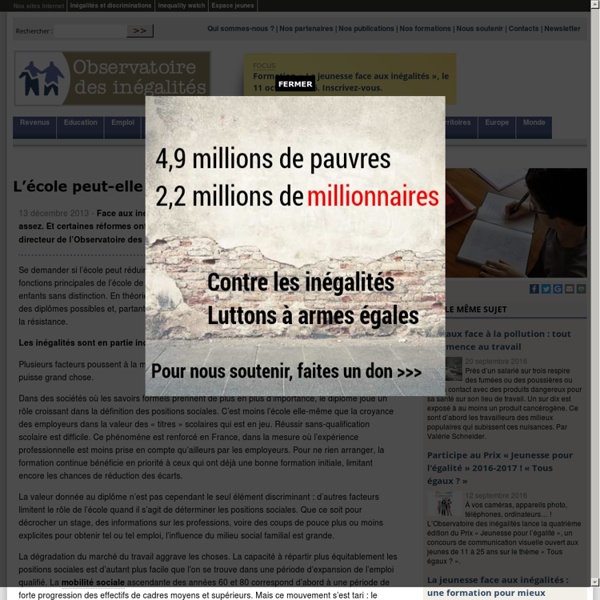
Les inégalités scolaires en France : évolutions, contradictions et paradoxes – Les Carnets du Cedrhe Introduction Les résultats obtenus par les élèves français lors de l’évaluation internationale PISA de 2015, publiés en décembre 2016, à l’instar de ceux de 2009 et de 2012, attestent à la fois une augmentation de la proportion d’élèves en difficultés et l’accroissement des inégalités scolaires de performance. Ils montrent que la France est l’un des pays de l’OCDE où le poids de l’inégalité sociale sur l’inégalité scolaire est le plus important. Comment expliquer cela alors que plusieurs initiatives politiques visant à démocratiser l’éducation et à réduire les inégalités scolaires se sont succédées au cours du XXe siècle et au début XXIe siècle ? Instruments de mesure Alors que les enquêtes de type “suivi de cohorte” ont débuté dans les années 70, celles qui visent à évaluer les compétences ou les acquisitions des élèves (et permettent donc d’en mesurer les inégalités) sont plus récentes en France. Démocratisation ou massification de l’enseignement secondaire ? [1].
Persévérance scolaire et « café.thé.B.i. » J'aimerais partager avec vous une vidéo qui a été tournée à la CSMB dans le cadre de la semaine sur la persévérance scolaire. Elle porte sur l’un de nos projets récents : le café.thé.B.i. Lien : Ce projet vise à informer, inspirer et mobiliser tous les acteurs du milieu (enseignants, directions, conseillers pédagogiques, directions générales, directions de services) dans un projet commun : celui de mettre en place les conditions visant à favoriser l’intégration pédagogique du TNI dans les classes. Ce projet s’articule autour des principes et de la formule du World Café, dont l’objectif est de faire émerger de nouvelles idées, à travers les échanges, et aussi des pratiques pédagogiques diversifiées et innovantes. Pour faciliter ces échanges, nous avons créé dans nos bureaux le café@290 (un café wi-fi avec TNI et tables circulaires).
Une école inégale 14 septembre 2003 - Les inégalités sociales face à l’école n’ont pas disparu avec l’élévation du niveau général d’instruction. Et plus on avance dans les études, plus elles sont fortes. « L’inégalité d’éducation est, en effet, un des résultats les plus criants et les plus fâcheux, au point de vue social, du hasard de la naissance » (1). Pour Jules Ferry, la construction d’un service public d’éducation laïque et gratuite avait bien sûr pour mission d’élever le niveau général d’instruction. La massification de l’école Au XIXe siècle, le premier souci des Guizot, Gambetta et Ferry est d’apprendre à lire et à écrire aux Français. Quand s’ouvre le XXe siècle, la durée moyenne des études est de six ans ; à la fin du siècle, elle a doublé. Au début du XXe siècle, les efforts principaux demeurent consacrés à l’école primaire : un quart seulement de la génération née au début de ce siècle obtenait alors son certificat d’études primaires. Cette massification ne s’est pas faite sans difficultés.
Parcours d'excellence: "Accompagner un élève ne se limite pas à l'aide aux devoirs" Depuis vingt-cinq ans, l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) propose à des étudiants bénévoles d'accompagner tout au long de l'année scolaire des jeunes issus des quartiers populaires. Au programme: aide aux devoirs, visites de musées, sorties à la bibliothèque, et tout un travail sur l'estime de soi et la construction du projet professionnel. Soit à peu près la même démarche que les "Parcours d'excellence" présentés par la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem ce lundi. Ce dispositif proposera dès septembre 2016 un accompagnement personnalisé aux élèves de 3e des établissements classés REP+. L'Express a demandé à Eunice Mangado-Lunetta, directrice déléguée de l'Afev, ce qu'elle pense de cette nouvelle initiative ministérielle. En présentant son dispositif des "parcours d'excellence", la ministre de l'Education nationale a notamment déclaré dans Le Monde que "l'accès à l'élite ne doit plus être la chasse gardée des milieux privilégiés".
«En France, on attend que les difficultés scolaires arrivent pour agir» 35e sur 38. Telle est la position de la France en termes d’inégalités scolaires, selon un rapport de l’Unicef publié cette semaine. Située entre la Slovaquie (34e) et la Belgique (36e), l'école de la République fait figure de mauvais élèves. Quelle a été votre première réaction à la lecture de ce rapport ? Cette étude rapporte des éléments plusieurs fois soulignés. Comment expliquer cette position de la France par rapport au reste de l’Europe ? C’est justement l’objet d’un travail que va rendre public le CNESCO. Les Pays baltes et scandinaves sont encore une fois bien classés. Par la formation continue, plus développée dans ces pays. Hormis les critères économiques, quels sont les facteurs qui génèrent ces inégalités ? Chaque élève arrive à l’école avec une histoire familiale différente. La ministre de l’Education nationale a réagi en qualifiant le rapport de «réquisitoire contre la politique de la droite». Ces données s’inscrivent dans la durée. Cyril Castelliti
Faire entrer l'École dans l'ère du numérique L'essentiel Notre monde connaît aujourd’hui avec le numérique une rupture technologique aussi importante que le fut,au 15e siècle, l’invention de l’imprimerie. La transformation radicale des modes de production et de diffusion des connaissances et des rapports sociaux emporte, partout et pour tous, de nouvelles façons de vivre, de raisonner, de communiquer, de travailler, et, pour l’École de la République, de nouveaux défis. Car transmettre des savoirs à des enfants qui évoluent depuis leur naissance dans une société irriguée par le numérique et donner à chacun les clés pour réussir dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle future nécessitent de repenser en profondeur notre manière d’apprendre et d’enseigner ainsi que le contenu des enseignements. Faire entrer l’École dans l’ère du numérique : un impératif pédagogique et un projet de société Le numérique au service des missions de l’École Éduquer au numérique : une nouvelle mission pour l’École Une nouvelle gouvernance
L’orientation à la fin du collège accentue les inégalités sociales 6 février 2014 - Les vœux d’orientation des familles en fin de troisième dépendent fortement de leur milieu social. 90 % des enfants de cadres supérieurs demandent une seconde générale ou technologique, contre moins de la moitié des enfants d’ouvriers non-qualifiés et d’employés de services aux particuliers. « A résultats scolaires et autres caractéristiques sociales donnés, les enfants d’agriculteurs, d’employés et d’ouvriers choisissent moins souvent d’être orientés en seconde générale et technologique, sans que cette moindre ambition ne soit corrigée par les décisions du conseil de classe ». Alors que l’étude Pisa menée par l’OCDE a fait grand bruit, la note d’information du ministère de l’éducation (voir « pour en savoir plus ») est passée presque inaperçue. Les auteurs étudient le passage en seconde, un moment crucial pour les élèves, puisqu’aujourd’hui presque tous continuent jusqu’à ce niveau. Or 95 % des vœux des familles sont aujourd’hui satisfaits.
Comment le système éducatif français aggrave les inégalités sociales Le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) dévoile, mardi, deux ans de travaux sur l’école. Le bilan est désastreux. LE MONDE | • Mis à jour le | Par Mattea Battaglia et Aurélie Collas Des inégalités sociales à l’école, produites par l’école elle-même… C’est la démonstration que fait le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), en rendant publiques, mardi 27 septembre, les conclusions d’une vingtaine de rapports. Tout un spectre de la recherche – des sociologues aux économistes, des didacticiens aux psychologues, français et étrangers – a été mobilisé deux années durant, pour interroger ce mythe de l’égalité des chances dans notre système éducatif. Ce n’est pas la faute de l’enseignement privé, dont la responsabilité a encore été pointée du doigt, récemment, dans nos colonnes, par l’économiste Thomas Piketty, en tout cas concernant Paris. Lire aussi : Ecole : des inégalités profondes et persistantes La politique des ZEP en cause Réquisitoire sévère
L'école est-elle vraiment de plus en plus inégalitaire? Depuis quand l’école augmente les inégalités scolaires? Peut-on critiquer le rapport Pisa qui ne cesse de le rappeler? Le discours de déploration sur l’école plombe-t-il l’école française ? Cela fait des années que je répète – que tous ceux qui travaillent sur l’éducation – répètent et écrivent ces phrases: La France est championne des inégalités scolaires. Le système scolaire français ne réduit pas les inégalités sociales mais les creuse. En France, les élèves les plus en difficulté sont de plus en plus en difficulté. Je ne le fais pas pour le plaisir mais parce que c’est ce qui ressort de nombreuses études et enquêtes internationales et françaises : Pirls pour le niveau en langue, Timss pour les mathématiques, Pisa -alternativement centré sur les compétences en langues, en sciences et en mathématiques et enfin, les études fournies par le service des statistiques de l’Education nationale, la DEPP Quelle déprime! A lire / à écouter - Les enjeux de l'enseignement supérieur en 2017 Focus.
L’école, mission égalité ? 7 janvier 2014 - Assurer l’accès de tous au savoir est l’une des missions fondamentales de la République. En théorie. Mais en pratique, l’accès au savoir n’est pas le même pour tous les élèves. L’école pour tous ? L’école permet à tous de mieux comprendre le monde, de connaître ses droits pour mieux les faire respecter, et d’acquérir des savoirs et des savoir-faire. 90 % des enfants d’enseignants observés en sixième en 1995 ont obtenu le bac en moyenne sept années plus tard, contre 40,7 % des enfants d’ouvriers non-qualifiés. Les conditions de vie Les conditions de logement, qui dépendent beaucoup du niveau de revenus des parents, comptent pour une part non négligeable. Les parents qui aident L’environnement joue un rôle majeur dans la réussite à l’école. Une école inadaptée En France, les programmes valorisent plus qu’ailleurs la culture des catégories socialement favorisées : la maîtrise d’un savoir mathématique théorique et de la langue française.
La mixité sociale, une chance pour les élèves La mixité sociale à l’école reste un principe fort et consensuel en France. Mais sa mise en œuvre se heurte aux résistances des familles. Rassembler toute une classe d’âge, sans distinction, pour apprendre et vivre ensemble, cela peut paraître une évidence dans un système éducatif financé par des fonds publics. L’école, en particulier au stade de la scolarité obligatoire, n’a-t-elle pas le devoir de doter tous les enfants d’une éducation commune leur permettant de s’intégrer dans la vie et de s’y côtoyer sans heurt ? La mixité sociale est alors une exigence et un principe peu contestable (1). Pour cela, le système doit offrir à tous des conditions d’accueil et d’apprentissage de qualité égale. Article de 1752 mots. Sociologue, chercheure à l’OSC et à l’Iredu, elle a publié, entre autres, avec François Dubet et Antoine Vérétout, Les Sociétés et leur école.
Élèves de milieux défavorisés: «assieds-toi et tais-toi» | Hugo Pilon-Larose | Société Les parents issus de milieux défavorisés contribuent au maintien des inégalités sociales dans les salles de classe en apprenant à leurs enfants à ne pas poser de questions et à se débrouiller par eux-mêmes, constate une sociologue de l'Université de l'Indiana dans une étude, obtenue par La Presse, qui sera publiée cet automne. La professeure Jessica McCrory Calarco a passé près de trois ans dans une école du New Jersey pendant lesquels elle a interviewé enfants, parents et enseignants. Au cours de son expérience, elle a remarqué que les enfants reproduisaient à l'école des phénomènes inégalitaires vécus entre les classes sociales, car implicitement, c'est ce que leurs parents leur avaient appris. «Nous savions par des recherches antécédentes que les enfants de la classe moyenne, contrairement aux enfants issus de milieux défavorisés, posaient plus naturellement des questions en classe et allaient chercher de l'aide», explique la professeure. «Tous les enfants peuvent réussir»
Les nouvelles inégalités 18 février 2004 - Jean Bensaïd, Daniel Cohen, Éric Maurin et Olivier Mongin s’interrogent sur les nouvelles formes que prennent les inégalités. Que la question des inégalités apparaisse désormais comme un phénomène social majeur est en tant que tel révélateur d’un changement considérable. Autrefois, on aurait parlé d’exploitation, de domination. Ce changement de discours est à bien des égards paradoxal et c’est sans doute pourquoi nous avons tant de mal à en bien comprendre les causes et la nature profonde. Le paradoxe de départ est que l’on doive affronter comme un problème politique nouveau la hausse des inégalités, alors même que le grand espoir du XXe siècle était, à l’inverse, que l’État-providence et la scolarisation de masse parviennent à les réduire. Le second paradoxe porte sur la réalité de cette hausse des inégalités. Il faut donc aller au-delà de ces statistiques globales. La tertiarisation de l’économie Les employés sont également une catégorie en pleine mutation. 1. 2. 3.
Mixité sociale, et après ? Suffit-il de mieux répartir les populations précaires pour régler les problèmes sociaux ? Cet ouvrage collectif coordonné par Éric Charmes et Marie-Hélène Bacqué, deux spécialistes des études urbaines, en doute sérieusement. Tandis que les acteurs politiques voient dans la mixité sociale une solution pour lutter contre les tensions qui résulteraient d’« un apartheid territorial, social, ethnique » (pour reprendre l’expression de Manuel Valls), les chercheurs montrent que la mixité sociale cache un autre problème, qui est celui des inégalités sociales et spatiales. Les politiques de mixité s’appuient, selon M.H.
• Titre : L’école peut-elle réduire les inégalités sociales ?
• Auteur :Louis Maurin
• Date de publication : 15 février 2024
Résume Dans cet article, Louis Maurin explique que l’école devrait permettre à tous les élèves d’avoir les mêmes chances de réussir, peu importe leur origine sociale et leurs classes sociale. Mais en réalité, ce n’est pas ce qu’il se passe. Les enfants de familles plus favorises sont souvent très bien accompagnés à la maison par exemple en ayant des cours particulières ou bien de l’aide aux devoirs, tandis que ceux qui viennent de milieux plus défavorisés ont moins d’aide pour les devoirs à faire. L’école n’arrive toujours pas à réduire cette différence qu’il peut avoir. Même les dispositifs mis en place pour aider les élèves en difficulté n’ont pas toujours de bons résultats. Le soutien des parents joue un rôle important et crucial, les parents qui ont peu de connaissances scolaires ou ont du mal à suivre ou aider leurs enfants durant toute leurs scolarités. Pour tout dire, l’école nous montre souvent les inégalités au lieu de les corriger.
Pour conclure, même si l’école essaie de donner les mêmes chances à tous, elle ne parvient pas vraiment à réduire les inégalités sociales. Il faudrait plus de moyens mis a disposition, ainsi plus de soutien pour les élèves défavorisés, et des changements profonds pour que chacun ait réellement sa chance de réussir. by amelbouchentouf Apr 18