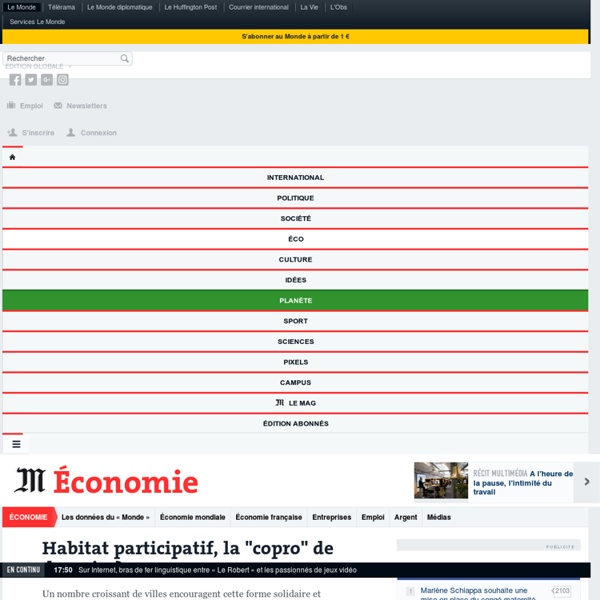Habitat participatif : «Le lien social en milieu urbain est de plus en plus difficile à créer»
Cécile Viallon est la coprésidente de l’association Eco habitat groupé, une association de groupes vivant en habitat participatif née dans les années 70, recréée au début des années 2000. Elle est également membre de la toute nouvelle «Coordin-action», coordination des associations d’habitat groupé qui s’est organisée à l’occasion du vote de la loi Alur pour appuyer son adoption. Elle organise, les 19 et 20 octobre prochains, les journées portes ouvertes de l’habitat participatif. Pour elle, il était temps de remédier à cette carence française. Lire aussi les principales mesures de la loi Duflot sur le logement Pourquoi donner un statut juridique spécifique aux logements dits «participatifs» ? Jusqu’alors, l’habitat participatif a été l’œuvre de groupes pionniers qui ont su se débrouiller en créant le concept de propriété collective alors que la loi était essentiellement conçue pour encadrer la propriété privée. Recueilli par Anna LECERF
Conduite de projet d'habitat participatif | Immo Participatif
Un projet immobilier collaboratif repose sur une désintermédiation autrement dit la mise en œuvre d’un projet porté par les propriétaires futurs (habitants ou investisseurs). Ceci suppose le rassemblement de partenaires et la gestion du projet. S’il s’agit d’un achat groupé d’un bien existant et n’exigeant pas de lourds travaux (appartement, maison, immeuble, résidences secondaire, etc.) l’enjeu est de rassembler des partenaires et de trouver sur le marché le bien immobilier. Immoparticipatif offre la possibilité de rechercher des partenaires, futurs habitants ou investisseurs et d’accéder à des biens en vente.Si le projet immobilier collaboratif exige des travaux de construction, d’extension, de réhabilitation, le groupe de projet a besoin d’un soutien dans le montage de l’opération. Il convient en amont du projet d’avoir une vue d’ensemble sur la faisabilité financière, architecturale, juridique. Nos références en conduite de projet sur le blog.
Qu'est-ce qui fait la qualité de vie en ville ? L'absence de bruit, de pollution... mais pas seulement - Sciences
S'il semble difficile de réunir tous les éléments pour une bonne qualité de vie en ville, des spécialistes ont pourtant décidé de les étudier pour aider à comprendre ce qui peut faire que nous apprécions ou non, notre quartier. Une étude, qui a pour objectif de mieux guider les politiques urbaines, est en effet réalisée par des climatologues, acousticiens ou encore sociologues qui ont arpenté, ensemble, les rues de Paris jeudi. Le quartier élu a été celui de la Porte de Bagnolet, dans le XXe arrondissement pour ses populations socialement variées et sa proximité avec le périphérique parisien, source de grande pollution dans la capitale. "Les gens ne sont pas des thermomètres... Ils perçoivent les éléments de leur environnement en fonction de leur ancrage social", rappelle l'urbaniste Sinda Haouès-Jouve, pilote du projet de recherche Eurequa. Description "physique" et approche "sociologique" Bruit et température L'attachement à son quartier, facteur de bien être
Habitat participatif
Définition de l’habitat participatif Le principe fondamental de l’habitat participatif est l’implication des futurs habitants dans la conception et la gestion de leurs logements. L’habitat participatif est considéré comme une troisième voie entre le logement social et la promotion privée. A noter que le terme recouvre un certain panel d’approches : l’autopromotion qui est une forme de promotion immobilière mais autogérée par plusieurs familles qui ont fait le choix de se regrouper,l’habitat coopératif caractérisée par une coopérative d’habitants propriétaire des logements (=propriété collective) conçus par leurs habitants et gérés de façon participative,l’habitat groupé ou cohabitat où le projet d’habitat est conçu et géré par plusieurs familles parfois en coopération avec un bailleur social ou un bailleur/promoteur privé. L’habitat participatif est apparu dans les années 70 notamment sous sa forme autogérée, dans le prolongement de la philosophie des cités radieuses de Le Corbusier.
Lieux d'exil aux abords de la ville
Tout a commencé dans les années 70. Les entreprises françaises, en manque de main d'oeuvre bon marché, font appel à des ouvriers étrangers qui immigrent en masse en provenance des anciennes colonies. Il faut loger cette nouvelle population dans des habitats sociaux, des édifices froids et hauts en périphérie des villes. Dans ces quartiers, pas de commerce. Dans les barres, des hommes, aujourd'hui chômeurs, accueillent leurs familles avant la fermeture des frontières en 1974. Ces édifices de béton, a la population marginalisée, font à l'heure actuelle, l'objet d'un plan gouvernemental. Le petit Nanterre (Photo: MP) Dans ce quartier, l'isolement est double : le fleuve et les voies de chemin de fer séparent les 9000 habitants de l'îlot du reste des 76 000 résidents de Nanterre. Marjorie (Photo: MP) Et c'est là, dans ce quartier 'difficile' que se trouve le centre socioculturel Les Canibouts. Anti-ghetto
Habitat Participatif - PARIS 2014