


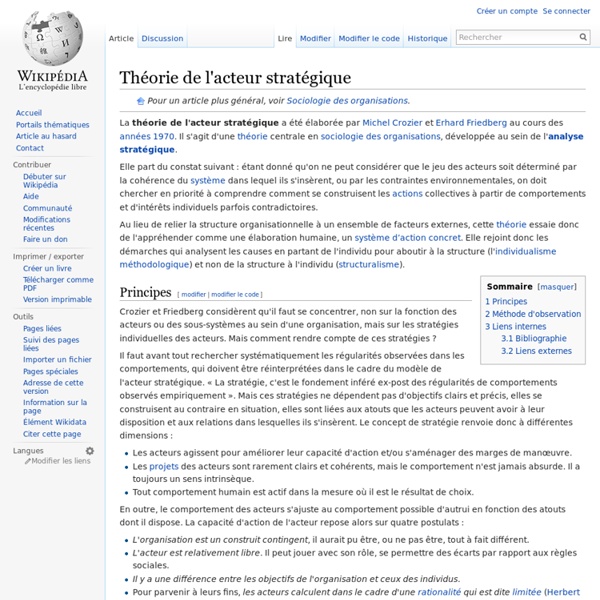
Rationalité limitée Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La rationalité limitée est un concept utilisé en sociologie et en micro-économie. Il porte sur l'étude du comportement d'un individu (ici appelé acteur) face à un choix (l'achat d'un produit,...). Il suppose que l'acteur économique a un comportement rationnel, mais que sa rationalité est limitée en termes de capacité cognitive et d'information disponible. Dès lors, l'acteur va généralement s'arrêter au premier choix qu'il jugera satisfaisant. En d'autres termes, l'acteur est rationnel (s'il préfère A à B et B à C, on peut en déduire qu'il préfère A à C). On s'écarte alors de l'un des postulats premiers de la micro-économie, qui veut que l'acteur soit pleinement rationnel concernant la situation envisagée. Ce concept a été forgé par Herbert A. Thèse de Simon[modifier | modifier le code] Premier déblocage[modifier | modifier le code] Le comportement de l’homme est induit par l’information. Deuxième déblocage[modifier | modifier le code]
Attitude (psychologie) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Attitude. L'attitude est « l'état d'esprit » d'un sujet (ou un groupe) vis-à-vis d'un autre objet, d'une action, d'un individu ou d'un groupe. Le savoir-être de quelqu'un. C'est une prédisposition mentale à agir de telle ou telle façon. Elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable. L'attitude est un concept indispensable dans l’explication du comportement social et une notion nécessaire dans l'explication des réactions devant une tâche. Il existe autant de définitions de la notion d'attitude que d'auteurs. Théorie tri-componentielle des attitudes : Rosenberg et Hovland (1960) Bien que la théorie tri componentielle des attitudes, comme beaucoup d'autres concepts majeurs de la psychologie sociale, fut une idée développée dès le début du siècle, nous nous reposerons sur la description qu'en ont fait Rosenberg et Hovland (1960). Portail de la psychologie
Interaction (sciences sociales) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Une interaction est un échange d'information, d'émotion ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets. "[...] Les interactions sont des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature des éléments, corps, objets, phénomènes en présence ou en influence." (Edgar Morin, 1977, p. 51[1]) Il est possible de définir l'interaction sociale chez les hommes comme une « relation interhumaine par laquelle une intervention verbale ou une attitude, une expression significative ou une action provoquent une action en réponse, qui retentit sur l'initiateur (échanges). » [réf. nécessaire] Celle-ci est fondamentale pour les individus et favorise les processus de neurogenèse[3]. Le terme d'interaction est souvent utilisé comme une contraction d'interaction sociale. Les interactions sont verbales ou non verbales (gestes, regard, attitudes...). Les interactions peuvent être :
La théorie des représentations sociales La représentation sociale [2] est un mode spécifique de connaissance. Dans un groupe social donné, la représentation d’un objet correspond à un ensemble d’informations, d’opinions, et de croyances relatives à cet objet. La représentation va fournir des notions prêtes à l’emploi, et un système de relations entre ces notions permettant aussi, l’interprétation, l’explication, et la prédiction. Travailler sur une représentation, c’est : « observer comment cet ensemble de valeurs, de normes sociales, et de modèles culturels, est pensé et vécu par des individus de notre société ; étudier comment s’élabore, se structure logiquement, et psychologiquement, l’image de ces objets sociaux ». Herzlich (1969). Qu’est que la représentation sociale ? C’est à un sociologue Français que l’on doit l’invention du concept de représentation : Durkeim (1898). C’est à Moscovici (1961), que l’on doit reprise et renouveau des acquis Durkeimiens. Les constituants de la représentation sociale En conclusion
Grand résumé de Socio-analyse des raisons d’agir. Études sur la liberté du sujet et de l’acteur, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010 1Que la socio-analyse existe depuis plus d’un demi-siècle ne suffit évidemment pas à expliquer pourquoi j’ai, en ce qui me concerne, été amené à m’inscrire dans ce courant de pensée et à y élaborer ma propre démarche. C’est là le résultat d’un long processus de réflexion, commencé au début des années 1970, sur l’idée de « relation sociale », et inspiré depuis par l’évolution de la sociologie elle-même au cours des vingt ou trente dernières années. Pour des raisons qui me sont encore assez obscures – et qu’il faudra bien que j’élucide un jour ! –, la notion de « relation sociale » est, pour moi, une véritable obsession depuis quarante ans : je n’ai jamais cessé de construire et reconstruire ce concept, avant, pendant et après toute recherche empirique. 4C’est ici qu’intervient l’évolution culturelle de nos sociétés. 5C'est par la socio-analyse, démarche sociologique qui situe l’individu-sujet-acteur-libre au cœur de son approche, que je cherche à éclairer cette boîte noire.
untitled Pour vivre libre, vivez en accord avec vos valeurs Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faisiez là, dans cette vie ? Dans ce job ? Dans cette ville ? En effet, selon la définition de Claude Paquette dans « Pour que les valeurs ne soient pas du vent » une valeur est « une référence déterminante pour la conduite d’une vie, d’un projet ou d’une organisation ». Les valeurs représentent une somme d’indicateurs fiables de motivation et d’énergie dans vos choix et dans vos prises de décisions les plus justes et écologiques pour vous-même. Une valeur a un impact bien plus important dans votre vie qu’une qualité ou qu’un talent. Enfin, en utilisant une métaphore, vous pourriez considérer que vos valeurs sont le carburant que vous mettez dans votre voiture et qui vous permet d’avancer. Valeurs – Contre Valeurs – Anti Valeurs Il est tout d’abord important de noter quelle est la définition exacte d’une valeur, mais aussi quelle est la signification que vous lui donnez. Les Valeurs ou mieux se connaître pour renforcer son Estime de soi
Valeurs (psychologie) Pour les articles homonymes, voir Valeur. La psychologie, notamment la psychologie sociale, tente d'établir le lien entre théorie et pratique. De plus, la psychologie sociale s'intéresse aussi bien à une vision supra-individuelle qu'individuelle des valeurs. Les valeurs servent de « principes guidant nos vies »[3]. Comme les motivations, les valeurs ont fait l'objet de modélisations et ont suscité la création d'outils de mesure de leur intensité. Pour les articles homonymes, voir valeur. D'autres disciplines s'intéressent à la notion de "valeur" ou de "valeurs" : Voir les articles spécifiques qui leur sont consacrés. Les valeurs sont définies comme « des préceptes généraux d'une société entière »[6]. Les valeurs varient d'un individu à l'autre, de même que leur degré d'importance. Plusieurs auteurs ont réalisé des recherches sur les valeurs à un niveau individuel et culturel. Les valeurs nous informent sur ce qui est important pour une personne. La typologie des valeurs Exemples : M.
Le questionnaire Schwartz Value Survey L’intérêt que le concept de valeurs a suscité est très ancien puisque son origine remonte à la Grèce antique, avec les écrits de Platon sur le fondement des gouvernements et de la responsabilité des citoyens. Dans ce questionnaire, vous vous demanderez : "Quelles valeurs sont importantes pour moi en tant que principes directeurs de ma vie ? Et quelles sont les valeurs moins importantes pour moi ?". Vous devez évaluer l'importance qu'a pour vous chaque valeur en tant que principe directeur dans votre vie. 0 : Signifie que la valeur n'est pas du tout intéressante pour vous, qu'elle n'est pas, pour vous, un principe directeur; 3 : Signifie que la valeur est importante; 6 : Signifie que la valeur est très importante; Plus le nombre (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) est élevé, plus importante est la valeur en tant que principe directeur dans votre vie. Avant de commencer, lisez les valeurs numérotées de 1 à 30 et choisissez celle qui, pour vous, est la plus importante - et notez son importance.
Mini-ABC de la psychothérapie brève systémique Acteurs, Double contrainte, Système, Tâches thérapeutiques... Ce petit ABC de l'approche systémique introduit une dizaine de concepts illustrés par des exemples. A comme acteurs Une psychothérapie fait souvent intervenir plusieurs acteurs qui peuvent jouer un ou plusieurs rôles: S'informer: Consulter dans le but d'avoir une autre lecture d'une situation sans grand désir (ou sans véritable espoir) de la changer. Se plaindre: Exprimer le désir d'un changement mais ne pas (encore) s'investir pour qu'il advienne. Contraindre: Désigner un proche comme celui qui devrait consulter un thérapeute. Être contraint: Se rendre en thérapie parce qu'on a été désigné comme celui qui devrait changer. S'engager: S'impliquer activement dans une stratégie de changement. Le psychothérapeute doit-il obtenir d'une personne qu'elle s'engage, alors qu'elle n'en exprime pas le désir? Pour ma part, j'estime qu'il est plus respectueux de renseigner pour que chacun puisse choisir en toute liberté le rôle qui lui convient.