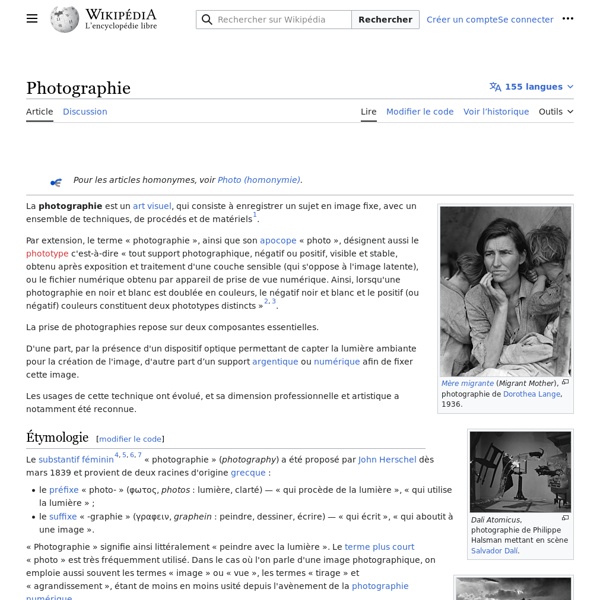Histoire de la photographie
Au 16ème siècle, Léonard de Vinci a découvert le principe optique de l’appareil photographique. C’est un français, Nicéphore Niepce, qui a inventé la photographie en fixant les images. La plus vieille photographie connue date de 1822. En 1829, Niepce s’associe avec le peintre Daguerre. Pendant 4 ans, ils travaillent séparément en se donnant les résultats de leurs expériences. Pendant 6 ans, Daguerre continue seul les recherches. En 1841 un anglais Fox Calo découvre le "Calo type", qui ne donne pas des positifs comme le Daguerréotype mais des négatifs. 50 ans plus tard, un américain, George Eastman, invente un appareil facile à manier, à portée de tous. Un ingénieur allemand, Oscar Barnac, décide de réaliser un appareil qui soit petit et de haute précision. Les appareils se sont modernisés au cours des années. De nos jours, on utilise des appareils numériques sans film. Jazzy
Histoire de la photographie
Depuis son invention, qui date officiellement de 1839, la photographie a évolué au fil des nombreuses innovations technologiques et techniques dans les domaines de l'optique, de la chimie, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique. Nous vous proposons de retracer les grandes étapes de l’histoire de la photographie, des premiers clichés à l’avènement de la photo numérique. L’invention de la photographie L’invention de la photographie nécessitait la réalisation d'un dispositif optique permettant la création de l'image et la découverte d’un moyen de fixer cette image sur un support durable par un processus chimique irréversible. Les deux phénomènes nécessaires pour obtenir une photographie étaient pour certains connus depuis longtemps, notamment l’effet de la lumière sur le chlorure d'argent. Les évolutions techniques L'invention du négatif La photographie en couleur Le petit format Le Polaroïd La photo numérique Plus d'information :
Argentique : Top 10 des appareils photos mythiques - Blog Pixopolitan
Aujourd’hui la photographie de manière générale s’exprime via le numérique. Mais pour en arriver là , il a fallu bien des innovations avant de créer l’appareil que vous tenez sans doute entre vos mains. En l’honneur de la photographie, nous vous proposons une petite rétrospective sur ces appareils photos argentiques mythiques qui ont marqué l’histoire de la photographie. On constate depuis quelques années un regain d’intérêt pour la photographie argentique. Vive la nostalgie ! 1. Le Brownie est un appareil qui a connu de très nombreuses évolutions et versions. En 1900, Kodak révolutionne la photographie grand publique et donne la possibilité à tout le monde de faire ses propres photographies en commercialisant le Kodak Brownie. Fort de son succès, il sera suivit du Brownie 2 en 1901, un peu plus élaboré (fini le boitier en carton) et bien plus tard il cédera sa place aux Brownie Junior Six-16 et Six-20 à partir de 1933. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Appareil photographique historique
Cet article a pour but de faire découvrir les appareils photographiques historiques qui ont marqué l'histoire. Les appareils photographiques y sont présentés dans l'ordre chronologique. Alexander S. Wolcott[modifier | modifier le code] Principe de l'appareil d'Alexander S. En 1839, les daguerréotypes faisaient fureur en Europe. Fonctionnement[modifier | modifier le code] Une image du sujet est visible sur une plaque (A), par l'interstice (B) creusé à même la chambre, grâce à un miroir concave (C), poli, qui concentrait les rayons. Fox Talbot[modifier | modifier le code] Le principe de l'appareil photographique d'Alexander S. Aussi appelés « souricières », ces appareils, dont certains mesuraient six centimètres de côté, ne se révélèrent pas assez puissants (négatif de 6 cm2) et Talbot les rejeta. Le Mammouth[modifier | modifier le code] Le Mammouth conçu par George Raymond Lawrence en 1901. André Adolphe Eugène Disdéri[modifier | modifier le code] Brownie[modifier | modifier le code]
L'histoire qui se cache derrière l'invention de la photographie
Le 19 août est la Journée internationale de la photographie, mais connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière son invention ? Ce matin, vous l'avez sûrement vu passer dans votre fil d'actualité, Facebook vous indiquait que la photographie avait 177 ans aujourd'hui. On pourrait donc imaginer que la première photo de l'histoire a été prise le 19 août 1839, ce qui est totalement faux. La Journée internationale de la photographie ne célèbre pas l'invention du procédé technique mais sa reconnaissance officielle par l'État français. Capture d'écran Facebook, faite le 19 août 2016. On pourrait alors croire que l'inventeur de la photographie est Louis Daguerre, inventeur du daguerréotype. Le principe de la camera obscura est connu depuis l'Antiquité : si on perce un trou dans une boîte noire totalement obscure, l'image de la scène à l'extérieur se reflète à l'envers à l'intérieur, sur la paroi opposée au trou. Point de vue du Gras, Nicéphore Niépce, 1826.
Les Inventeurs, Histoire de la photographie - Biographies
L’inventeur : Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) Nicéphore Niépce est considéré comme l’inventeur de la photographie. Né à Chalon-sur-Saône d’une famille très aisée d’avocats, il est promis à une carrière ecclésiastique jusqu’à ce qu’il y renonce pour s’engager en 1792 dans l’armée révolutionnaire. En 1806, de retour en Bourgogne après 10 ans passés à Nice, Niépce fait fructifier ses biens et montre ses premiers talents d’inventeur en créant avec son frère Claude le pyréolophore, sorte de moteur marin à explosion. Celui-ci ne sera finalement jamais commercialisé mais initie une série d’inventions toutes plus coûteuses les unes que les autres, l’obligeant à contracter des emprunts. En contact permanent avec son frère Claude parti en Angleterre, c’est en 1816 que Niépce commence ses premières recherches héliographiques, et durant 11 ans il va développer son procédé jusqu’en 1824 où il indique à son frère dans une lettre : « La réussite est complète ».
les appareils photos d'hier,les progrès de l'histoire
L'appareil photo d'hier, une histoire dans l'histoire de la photographie. Pour résumer tout ce que j'ai raconté à propos de l'histoire de la photographie, on peut dire que trois hommes en sont à l'origine : Nicéphore Niepce qui réalise la première prise de vue de 1826, Daguerre, inventeur du premier procédé facilement utilisable, le daguerreoptype qui est publié en 1839, et William Henry Fox Talbot qui a créé en 1840 le procédé négatif-positif. La chambre de gauche, l'une des premières construites, s'est vendue en 2010, 732 000 € ! A droite, un exemplaire plus modeste comme il s'en est fabriqué des quantités dans les années 1840 Le daguerréotype, dont la mise en oeuvre était fastidieuse, et surtout nécessitait des temps de pose très longs, a donné naissance à quelques accessoires qui nous semblent assez drôles, aujourd'hui ! j'ai trouvé que le temps de pose pour un Daguerreotype était de 15 à 30 minutes en 1839, 20 à 90 secondes en 1841, mais seulement de 10 à 60 secondes en 1842...