


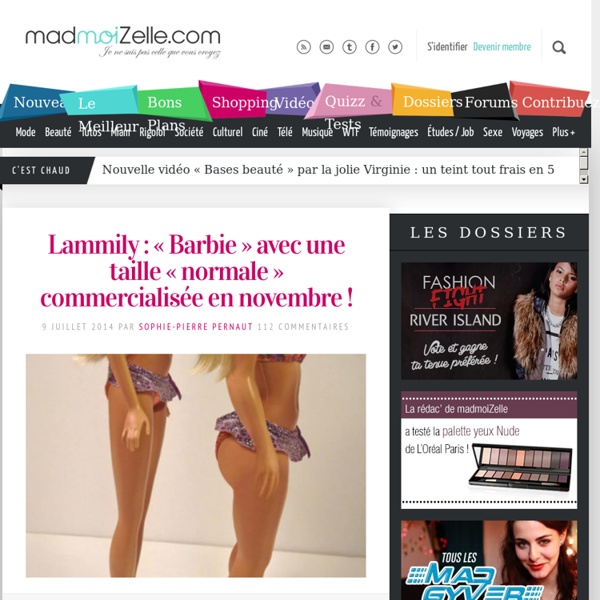
Observatoire des inégalités 11 avril 2014 - Marie, Antoine, Mansour, Rayene sont quelques-uns des lauréats du prix « Jeunesse pour l’égalité 2014 ». Ce prix remis par l’Observatoire des inégalités récompense les meilleurs films et affiches parmi 450 participants. Un regard inédit de la jeunesse sur les inégalités sociales, entre les sexes ou selon la couleur de la peau. Le jury a tranché. Un choix est toujours subjectif. Du clip musical au photomontage, les œuvres reçues couvrent un champ très large. Et après ? Ce concours marque aussi le point de départ d’une campagne de sensibilisation sur les préjugés que l’Observatoire des inégalités souhaite mener à destination des jeunes, mais aussi du grand public. Les grands gagnants sont : Dans la catégorie des films 11-15 ans : 1er prix : Six femmes, six histoires d’Antoine Bergeron, Loeiza Beuzet, Coline Rogel, Maëlle Gahinet, Léa Digaldi, Arthur Lange, Lucas Bernicot et Anne-Cécile Gonot, du collège Charles de Gaulle à Ploemeur (56). 2ème prix : Egalité ?
Et si on gardait nos poils pubiens ? L’avantage des mois de novembre, c’est qu’on peut officiellement passer en mode fourrure d’hiver. Terminées les épilations frénétiques, balancés les rasoirs, oubliées les amourettes de vacances : femmes hirsutes, bonjour. C’est le moment béni où on se met en jachère. La peau apprécie. Il y a des hommes qui aiment les poils. Quand j’avais quinze ans (il y a quinze ans), on se rasait les jambes et les aisselles, mais on ne touchait pas au pubis. Pour les demoiselles plus jeunes, je peux comprendre que ce soit une autre paire de manches. Voici donc de bonnes raisons de garder haut son gazon. – La fourrure est plus hygiénique. Il ne s’agit pas de retourner dans les 70’s, mais de faire ce que VOUS voulez. Tous les articles Sexe , Vis ta vie Les autres papiers parlant de Poils
Le contrôle des femmes par le vêtement Saviez-vous qu’avant le 31 janvier 2013, le port du pantalon par les Parisiennes était passible d’emprisonnement ? Cette ordonnance vieille de 2 siècles interdisait ainsi aux femmes de « se travestir », avec une tolérance pour celles qui devaient « tenir un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval ». Le ministère des droits des femmes vient seulement de l’abroger. Les hôtesses d’Air France, ont, quant à elles, dû attendre 2005 pour pouvoir porter le pantalon. Le vêtement féminin est, en effet, bien plus qu’un simple bout de chiffon. La jupe, plus particulièrement, constitue un élément premier de distinction de genre. Cette différence sexuée établit une hiérarchie entre les genres : l’une des vocations du vêtement féminin est avant tout d’entraver le mouvement (robe fuselée resserrée dans le bas, harnachement des sous-vêtements, du corset au porte-jarretelle) et donc de maîtriser les femmes. Et l’on n’en finit pas de réglementer le vêtement féminin.
women olympians 21 « Ma chère fille, j’espère que tu auras une vie sexuelle épanouie. » En réaction aux « 10 règles à suivre pour sortir avec ma fille », un père a écrit une lettre ouverte à sa fille, intitulée « Ma chère fille, j’espère que tu auras une vie sexuelle épanouie ». Il est temps d'en finir avec l’hypocrisie générationnelle à propos de la sexualité des jeunes femmes. Les 10 règles à suivre pour sortir avec ma fille tournent à plein tube sur les réseaux sociaux. Supposément écrite par le « père inquiet » typique, elles s’adressent aux potentiels prétendants désireux d’entrer en contact intime avec la fille-du-père-inquiet. La dernière mode est de les porter en T-shirt. 1. Il existe plusieurs variantes de cet ensemble de règles, qui reposent toutes sur les mêmes concepts : réduction de la fille à l’état de propriété de son pèreopposition entre le père et le petit ami, le bonheur de l’un faisant nécessairement le malheur de l’autreintimidation et menaces de violence (mais c’est pour riiiire, c’est du second degré, n’est-ce pas !). Ferrett Steinmetz est écrivain. Oui.
représentations sexuées dans l'audiovisuel foot 02 02 Je suis en relation libre — Témoignage La relation libre, qu’est-ce donc ? C’est un couple dans lequel la fidélité n’est pas un passage obligé. Voici le témoignage d’une madmoiZelle qui vit ça avec son copain depuis un an ! Je suis avec mon copain depuis plus d’un an, et nous sommes en relation libre. Ce qui veut dire que nous pouvons, chacun de notre côté, aller fricoter avec d’autres personnes sans que cela ne soit vécu comme une trahison ou comme une raison de rompre. La fidélité, un passage obligé ? Déjà, il faut dire que la fidélité, ça n’a jamais trop été mon truc. Sans compter le stress énorme causé par mes mensonges incessants, des histoires façon Inception avec plusieurs gros mensonges emboîtés, le tout saupoudré d’une grosse dose d’omission ; j’étais assez jeune (fin du lycée/début de mes études) et clairement, je n’avais pas les nerfs assez solides pour ça. Seulement, je n’avais jamais pris le temps de réfléchir sur cette fidélité, cette monogamie obligatoire. Apprendre à s’écouter et à être en couple différemment
Accueil - Zéro Cliché ! La sexualité expliquée par TomSka dans une vidéo géniale TomSka, célèbre youtubeur, a décidé de faire une vidéo claire et décomplexante sur la sexualité. Et c’est plutôt très réussi ! Le très célèbre youtuber TomSka, papa des vidéos Meanwhile qui ont inspiré Pendant ce temps, est revenu ce week-end avec une nouvelle vidéo. TomSka a décidé de passer en revue le plus de sujets relatifs à la sexualité possible, avec beaucoup d’énergie, un débit de paroles incroyable et, surtout, une évidente ouverture d’esprit. « Ceci est une vidéo sur le sexe. Avis à nos traductrices adorées, vénérées, auréolées de succès : si vous souhaitez retranscrire le reste de la vidéo, on vous en sera reconnaissantes pour toujours et on mettra votre travail ici en vous mentionnant. Mise à jour - Voici la retranscription en français du reste de la vidéo de TomSka ! « Partie 2 : la sexualitéQuand il s’agit d’utiliser nos parties, nous avons tous des préférences différentes. (*Pour le « sois insouciant », c’est ce que SPP a cru comprendre.
La discrimination positive fait débat aux États-Unis Une étudiante, Abigail Fisher, souhaitait intégrer l'Université du Texas. Elle se dit victime de discrimination liée à sa couleur de peau. Abigail Fisher se dit victime de «racisme anti-Blancs». La Cour suprême des États-Unis examine depuis mercredi le cas de cette jeune femme blanche de 22 ans, qui avait vu sa candidature refusée par l'Université du Texas en 2008. Après la période des quotas ethniques, abandonnés depuis 1996 car jugés trop discriminatoires, la loi n'a cessé d'évoluer au gré des procès et des décisions de la Cour suprême. Pour remplacer les quotas, le Texas a donc adopté deux règles complémentaires. «Le mérite devrait être le seul critère» La règle attaquée par Abigail Fisher, qui ne faisait pas partie des «10 %», concerne l'attribution des places restantes. Abigail pense avoir été écartée ainsi au profit d'un étudiant de couleur. L'Université du Texas, par la voix de son directeur des admissions, Kedra Ishop, défend sa politique. L'exemple californien
La pression pesant sur les corps féminins illustrée par des photos crues La pression que la société et les canons de beauté exercent sur les corps féminins est illustrée dans une série de photos crues. Ça fait peur et un peu mal. Malgré les dizaines de campagnes de sensibilisation qui tentent chaque année de dénoncer la pression des médias, et de la société en général, sur les corps des femmes, les diktats actuels de beauté restent assez rigides. The Fanciful, Monstrous Feminine (Le fantasque et monstrueux corps féminin) est un projet photographique de l'artiste australienne Jessica Ledwich visant à dénoncer les tortures que les femmes font subir à leur corps pour être physiquement « dans la norme ». C'est déroutant, violent et terriblement percutant. Partage sur les réseaux sociaux & viens réagir sur le forum !
L'expérience de la discrimination positive aux Etats-Unis Le Monde.fr | • Mis à jour le | Par Mathilde Gérard Alors que Valérie Pécresse vient de confirmer l'objectif du gouvernement d'atteindre 30 % de boursiers dans les grandes écoles françaises, Le Monde.fr examine les politiques de discrimination positive menées dans trois pays : Etats-Unis, Brésil et Inde. Premier volet aux Etats-Unis. L'"action affirmative" – pendant américain de la discrimination positive – est née de la lutte pour les droits civiques et l'abolition de la ségrégation raciale. A la fin des années 1960, le gouvernement républicain de Richard Nixon entend favoriser, par des politiques de traitement préférentiel, l'accès à l'emploi et l'admission dans les universités de certains groupes ayant fait l'objet dans le passé de pratiques discriminatoires. L'affirmative action américaine désigne au départ des dispositions destinées à susciter en amont une augmentation du nombre de candidats noirs à certains postes. Les politiques d'action affirmative ont-elles joué leur rôle ?