


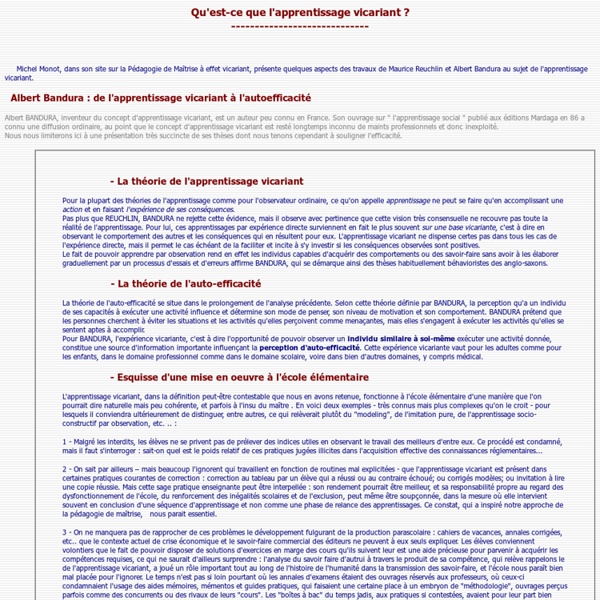
Social Learning Theory Bandura Social Learning Theory People learn through observing others’ behavior, attitudes, and outcomes of those behaviors[1]. “Most human behavior is learned observationally through modeling: from observing others, one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a guide for action.” (Bandura). Social learning theory explains human behavior in terms of continuous reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and environmental influences. Necessary conditions for effective modeling Attention — various factors increase or decrease the amount of attention paid. Retention — remembering what you paid attention to. Reproduction — reproducing the image. Motivation — having a good reason to imitate. Reciprocal Determinism Social learning theory has sometimes been called a bridge between behaviorist and cognitive learning theories because it encompasses attention, memory, and motivation.
Les effets positifs de l’apprentissage vicariant Depuis le rapport Delaubier, publié en 2002, le système scolaire français a franchi un pas vers la reconnaissance des spécificités cognitives des enfants à haut potentiel intellectuel (dits « surdoués » ou « intellectuellement précoces ») et les enseignants ont été sensibilisés à l’échec particulièrement injuste de certains d’entre eux. Jacques Bert nous apprend que la PMEV ferait particulièrement bon ménage avec la précocité. Du sur mesure Les objectifs de cette méthode sont en effet en adéquation avec les besoins de cette catégorie d’enfants. Pour qu’il y ait apprentissage vicariant, il faut que soient en présence, face à un apprentissage donné, des enfants qui ont déjà maîtrisé cet apprentissage et des enfants qui, le découvrant, vont avoir besoin de prendre des repères pour se l’approprier. Pour les élèves en difficulté, pour les « atypiques » Les avantages particuliers que peut représenter cette méthode pour cette catégorie d’enfants sont multiples :
L'apprentissage social, retour aux sources Doc 27 Albert Bandura est un psychologue canadien né en 1925. En 1963, il publie l'ouvrage intitulé "Social Learning and Personality", qui attendra près de 25 ans avant d'être traduit en français. Bandura développe dans cet ouvrage la théorie de l'apprentissage social. Tout apprentissage est social Nous apprenons en regardant les autres, et en tentant ensuite de les imiter. Selon lui, l'observation suivie de l'imitation permet de faire bien des économies dans le processus d'apprentissage : si l'on observe attentivement une personne compétente dans un domaine et qu'on s'attache à reproduire son comportement, l'on n'a pas besoin de procéder par une fastidieuse série d'essais-erreurs (comme le défendaient les behavioristes) pour parvenir au comportement ou au savoir faire juste. Bien entendu, il convient d'observer une personne dont on se sent proche, avant de prétendre reproduire (ou s'inspirer de) son comportement. Imiter, pas si simple... Social learning, je prends ! Albert Bandura sur Wikipedia
Construire sur ce qui rassemble, au-delà des différences Si dans la société et plus particulièrement dans la société française chacun s'accorde à constater la place grandissante du numérique et de ses usages dans la vie de tous les jours, la rapidité avec laquelle les technologies se développent rend toute réflexion inachevée sur le formidable changement de paradigmes auquel nous assistons L'accès à internet, de nos jours indispensable autant pour les entreprises et les services publics que pour tous les citoyens, ouvre l'accès par une très grande diversité de canaux à une multitude d'informations en continu. Comment rester libre dans cette surcharge informationnelle ? Obnubilés par « l'évolution exponentielle » des technologies comme la caractérise Joël de Rosnay n'est-il pas nécessaire de s'arrêter un instant pour, ensemble, réfléchir aux conditions, aux conséquences et donc aux inflexions nécessaires, de l'inévitable interaction entre ces technologies et ce qui fait la richesse des sociétés, l'humain ? Claude TRAN
getpart.php?id=lyon2.2009 Doc 17 Les sentiments d’appartenance(s) constituent l’un des aspects (collectifs) de l’identité et donc du sentiment de Soi. A. Mucchielli pense que le sentiment d’appartenance prend ses sources « dans la relation primitive du nourrisson avec sa mère, puisqu’on sait que dans son état premier, le nourrisson ne se distingue pas de sa mère », et découle tout autant du fait que l’être humain est un être social25. Pour l’adulte, le sentiment d’appartenance est avant tout ce qui définit l’image qu’il projette dans la société, c’est-à-dire son statut. Il y a des moments dans l’existence où, plus ou moins brusquement, l’individu prend du recul par rapport à ses groupes d’appartenance, ou certains d’entre eux. Le souhait d’entrer dans un nouveau groupe conduit à l’idée qu’il va falloir modifier quelque chose dans sa manière d’être, d’agir et peut-être de penser. Il optera pour cette démarche d’autant plus volontiers : Autrement dit, comme le remarquent V.
Positive Education Blog: Building Character & Achievement | Smart Strengths The Long Driveway When we imagine a positive future, we imagine ourselves enjoying that future. We just assume that we will enjoy the situation we foresee – the place, the people, the activities. In other words, we see ourselves savoring the event. Unfortunately, many times, when we approach that future, we do not experience the joy we anticipated. We fail to savor. The Beginning The driveway at our new house is 200 yards long. Anticipation Over the next couple of months, as we found a builder, drew up plans, and signed a contract, we would need to be at the lot for one reason or another periodically. Oops! Finally, as fall became winter, we were in! The Choice to Savor Fortunately for me, I had two things going for me in that moment. Over the next few days, I cemented this habit by reminding myself each morning to pay attention to the walk and to savor the experience. Rituals Rituals are important. What positive rituals do you have? Positive Guidance with Jolanta Burke (Webinar) Resilience
Théorie de l'apprentissage social Plusieurs théories reçoivent la dénomination de théorie de l’apprentissage social. La plus connue d'entre elles est celle d’Albert Bandura. La théorie de l’apprentissage social (« Social Learning Theory », abrégée SLT) d’Albert Bandura décrit comment l'enfant peut apprendre de nouveaux comportements en observant d'autres personnes : il imite les modèles de comportement qui font l’objet de récompenses et non de punitions[1] (notion d'« observational learning »)[2]. Cette théorie a connu de nombreuses applications dans des domaines aussi divers que la psychologie (éducation, etc.), la sociologie, la criminologie et la « planning theory » (en santé publique)[3]. Théorie d’Albert Bandura[modifier | modifier le code] La théorie de l’apprentissage social d'Albert Bandura désigne trois procédures d’acquisition qui ont leur source dans l’entourage de l’individu : Théorie de Lev Vygotsky[modifier | modifier le code] Théories de la planification de Friedmann[modifier | modifier le code]
La pédagogie active sans la pédag... La définition de Apprentissage social- Doc 15 L'apprentissage social désigne l'acquisition de savoirs et de savoir-faire résultant de l'observation du comportement d'autrui. Le terme social qualifie la nature du processus d'apprentissage et non le contenu des acquisitions possibles. Plus précisément, il indique que l'acquisition s'opère sous l'effet de l'environnement social plutôt que physique. L'apprentissage du point de vue béhavioriste Selon l'approche béhavioriste de l'apprentissage, les acquisitions sont le produit des événements extérieurs. Ainsi, l'individu subit passivement ce processus. La théorie de l'apprentissage de Bandura L'apprentissage social est également appelé apprentissage par observation ou apprentissage vicariant. Les processus attentionnels: ils déterminent ce qui va être observé et ce qui va être extrait de l'observation. La motivation impact sur ces sous-processus. Le renforcement vicariant Tout d'abord, la valeur accordée à un renforcement dépend des critères propres à l'observateur.
Making Learning Memorable With a title like Making Learning Memorable, what was the probability that Dan Levy would be able to deliver on his promise when he taught a 90-minute class at the Ed School as part of the Master Class series? Considering Levy has been teaching quantitative methods and program evaluation at the Harvard Kennedy School as a senior lecturer for the past 10 years, and has won several top teaching awards, the chances, statistically speaking, were probably pretty good. Based on the amount of laughter that happened during the Ed School session, which was meant to showcase craft from inspiring educators across Harvard, it looks like Levy did deliver. So what lessons were learned about teaching from Levy, who, despite being dubbed a “master teacher,” admits that he is introverted by nature? • Think about what you want your students to most learn. • Don’t be afraid to joke. • Use technology, but don’t overdo it. • Disasters happen.
ContenuCooperationCollaboration- Doc 28 Entre la coopération et la collaboration, la différence est nuancée. Sources: site Outils et Réseaux F. Henri et K. La première différence : comment partage-t-on le travail ? De manière générale, les groupes collaboratifs et coopératifs travaillent ensemble sur un but commun ou partagé. En coopérant Le groupe est divisé en équipes spécialisées qui réalisent une partie de tâche. En collaborant Les membres du groupe travaillent pour un but commun. Autres différences De cette manière de réaliser la tâche commune, découlent d'autres différences : La maturité des groupesLes interactions entre les personnes La manière de considérer le but La maturité des groupes La démarche coopérative est plus structurée et encadrante. Les interactions entre les personnes En coopérant, chaque membre est responsable d'une action ou sous-tâche. Dans les démarches collaboratives chacun utilise l'ensemble des ressources dans le groupe. En conclusion "collaborer" renvoie à l'histoire sombre de la guerre 39-45. concept
Enseigner en primaire avec le numérique Après « Enseigner en histoire-géographie avec le numérique » et avant « Enseigner les arts avec le numérique », voici, coordonné par Armelle Legars et Ostiane Mathon, et une relecture de Michel Guillou, « Enseigner en primaire avec le numérique ». Quelques extraits. Avant-propos du dossier par Armelle Legars et Ostiane Mathon « Quelle place le numérique occupe-t-il aujourd’hui dans les espaces d’apprentissage de nos écoles primaires ? Quels enjeux éducatifs et pédagogiques permet-il de requestionner ou de soulever ? Différents acteurs de l’école se sont emparés de ces questions dans ce dossier. L’école numérique, tout de suite ? Faire entrer le numérique dans les classes ? Matériel Et si on commençait par y faire entrer du matériel ? Pourquoi un ordinateur et un vidéoprojecteur ? La twictée, une dictée à l’heure numérique, par Régis Forgione et Fabien Hobart Pour une culture de l’horizontalité, par Philippe Roederer Bien entendu, le numérique ne réinvente pas le travail d’équipe.
La révolution du social learning XEnvoyer cet article par e-mail La révolution du social learning XEnvoyer cet article par e-mailLa révolution du social learning La transmission interne des savoirs remise au goût du jour E-Learning 2.0. Pour Frédéric Domon, directeur de l'agence SociaLearning et co-auteur d'un livre blanc sur le sujet, “le social learning peut être considéré comme le développement des savoirs, des aptitudes et attitudes, par la connexion aux autres – que ce soient des collègues, des mentors ou des experts – via les médias électroniques synchrones ou asynchrones”. L'échange social, facteur d'apprentissage Ces théories éprouvées au service de la formation ont été remises au goût du jour par le développement du Web 2.0 et des réseaux sociaux. L'un des problèmes du e-learning est que bien souvent, les apprenants ne vont pas au bout de leur formation. “Le social learning ne repose pas tant sur le contenu que sur la façon dont on va se connecter aux autres, explique Frédéric Domon. Par Fabien Humbert
Contenu inaccessible - Les fondamentaux Réseau Canopé