


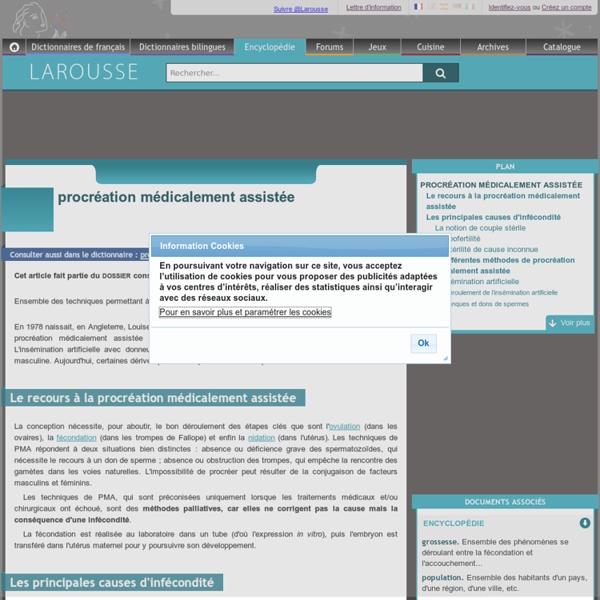
Politique : PMA : le malaise d'enfants nés d'un don TÉMOIGNAGES - La première génération d'enfants issus du don de gamète anonyme veut faire entendre sa voix. «Nous sommes une génération d'abandonnés, orphelins de nos origines»… À l'heure où la question de la procréation médicalement assistée revient sur le devant de la scène médiatique, la première génération d'enfants issus d'un don de gamète anonyme veut faire entendre sa voix. «Nous avons à présent un recul de plus de 40 ans sur ces techniques. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation implique au préalable le devoir impérieux de prendre en compte notre expérience, celle des parents et des donneurs», scandent les membres de l'association Procréation médicalement anonyme (PMA) qui militent pour l'accès aux origines. Un débat complexe, où se font aussi entendre des partisans de l'anonymat. «Un sentiment d'injustice» «La connaissance de son histoire, généralement, on considère que c'est un droit. «Nous sommes envahis par un grand sentiment d'injustice, d'humiliation.
Mères porteuses : la justice ouvre une nouvelle brèche - France Dans le dossier sensible des mères porteuses, la justice française avance à pas comptés. Officiellement, la gestation pour autrui est interdite en France. Mais elle est pratiquée dans de nombreux pays. Et dans une société où les problèmes d'infertilité concernent un nombre croissant de couples, sans que le monde médical puisse déterminer précisément quelles en sont les causes (pollution ? nourriture ? Mais dans une autre affaire, la cour d'appel de Rennes vient de prendre une décision radicalement opposée. "C'est un énorme progrès" Dans cette affaire, la cour d'appel de Rennes relève qu'elle n'a pas été "saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui" - interdit en France, légal en Inde - "mais de la transcription d'un acte d'état civil", précisent les juges dans leurs attendus. La cour d'appel de Rennes a rendu "un très bel arrêt", qui "dit le droit d'une manière juste", "applique l'article 47 et rien que l'article 47", s'est félicitée l'avocate des parents, Me Mecary.
Gestation pour autrui : un cadre contre les dérives Le Monde.fr | • Mis à jour le | Par Michèle André, Elisabeth Badinter, Gérard Bapt, Joëlle Belaisch-Allart, Serge Blisko, Patrick Bloche, Gilles Bon-Maury, Jean-Michel Boucheron… Chaque victoire emportée par la France contre ses propres conservatismes est le résultat d'une confrontation. Lorsqu'il s'agit de prendre acte de l'évolution de notre société, les libertés à conquérir sont toujours précédées d'incompréhensions, d'inquiétudes et de prophéties menaçantes. Il y a un demi-siècle, on imposait aux futurs parents la naissance d'enfants non désirés. La multiplicité et la plasticité des modèles familiaux ne peuvent être ignorées plus longtemps. Depuis, des enfants naissent grâce à des gestations pour autrui dans plusieurs démocraties avancées. Oui, sans encadrement, la société peut dériver vers une instrumentalisation des femmes, une réification de leurs corps, une marchandisation de l'enfant. La gestation pour autrui ne sera une authentique pratique altruiste que si elle est encadrée.
Interruption volontaire de grossesse (IVG) Article premier. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Art. 2. Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L 176 du Code de la santé publique. Art. 3. Après le chapitre III du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse". Art. 4. La section I du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée : " Art. " Art.
Le CCNE dit non au suicide assisté et à la sédation à visée euthanasique Dans son avis n. 121 intitulé Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir rendu public le 1er juillet, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’oppose à toute forme de légalisation du suicide assisté ainsi qu’à la prescription de sédatifs à visée euthanasique. Le débat sur la fin de vie aurait pu enfin être clos mais le président du CCNE Jean-Claude Ameisen a estimé que cet avis n’était qu’une « étape » dans la réflexion et nécessitait l’organisation d’états généraux qui se tiendront à l’automne. Quant au chef de l’État, il a confirmé son intention de présenter avant la fin de l’année un projet de loi visant à modifier l’actuelle législation. Suicide assisté : fin de non-recevoir Concernant le suicide assisté, l’avis n. 121 ne prend pas la peine de répondre à la question du président de la République sur les critères sensés l’encadrer : il lui oppose tout simplement une fin de non recevoir. Deux sédations "« Les doses utilisées sont titrées et adaptées à l’intention.
Principe de précaution "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique Définition du principe de précaution Le principe de précaution est un principe philosophique qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir des risques, lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes, principalement dans le domaine de l'environnement et de la santé. Contrairement à la prévention qui s'intéresse aux risques avérés, la précaution, forme de prudence dans l'action, s'intéresse aux risques potentiels. Le principe de précaution existait à différents niveaux dans des chartes et conventions internationales ou dans des lois nationales. En France, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement énonce ainsi le principe de précaution : >>> Terme connexe : Environnement >>> Terme connexe : Sécurité >>> Terme connexe : Sûreté Accueil Dictionnaire Haut de page Contact Licence CC
Peut-on distinguer euthanasie active et euthanasie passive ? Ô toi qui prolongeas mes jours, Reprends un bien que je déteste ! Ô Diane, je t’implore, Arrêtes-en le cours ! (Iphigénie, dans C.W. Gluck, Iphigénie en Tauride) Selon l’enquête européenne EURELD effectuée en 2001-2002 dans six pays européens [1], entre 36 % et 51 % de tous les décès (sauf 22 % pour l’Italie) sont le résultat d’une décision médicale de fin de vie. L’aspiration à « mourir vivant » Le débat autour de la légitimité éthique de l’euthanasie, en France et ailleurs, n’en est probablement qu’à ses débuts, malgré la publication récente du rapport Leonetti sur l’évaluation de la loi homonyme de 2005 sur la fin de vie [3]. En outre, dans le cas spécifique de l’euthanasie, le décalage entre les deux questions de sa légitimité éthique et de son éventuelle légalisation est encore plus important que dans le cas d’autres pratiques à la frontière de la médecine. Faire mourir et laisser mourir La terminologie et ses enjeux Je plaide, quant à moi, pour la définition large.
Faut-il instaurer un droit à mourir? François Hollande propose que "toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable [...] puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité". Mais il dit aussi qu'il n'est "pas favorable" à "l'euthanasie". On a un peu de mal à comprendre... Marisol Touraine: Nous ne parlons pas d'"euthanasie" parce que ce mot donne lieu à des interprétations très différentes. Jean Leonetti: La proposition de François Hollande est floue alors que la définition de l'euthanasie est claire: il s'agit de donner la mort à un malade qui le réclame pour abréger ses souffrances. M. J. M. Cette aide pourrait survenir en "phase avancée", dites-vous, mais celle-ci est beaucoup plus difficile à déterminer que la "phase terminale". M. J. M. J. M. J. M. Un Etat qui donne le droit de tuer, n'est-ce pas symboliquement dangereux pour la société? M. J.
L'euthanasie n'est pas compatible avec les valeurs de la gauche (capture d'écran Youtube - vodeotv - cc) Du même auteur Impliqués professionnellement dans l’accompagnement de patients en fin de vie, nous sommes aussi des citoyens engagés, qui nous reconnaissons dans un grand nombre des valeurs incarnées sur la scène politique par la gauche. Aujourd’hui, nous voulons dire notre indignation vis-à-vis de la proposition de loi visant à légaliser les injections létales et le suicide assisté, signée par de nombreux sénateurs « de gauche ». Nous l’avions été tout autant il y a un an par la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par le groupe socialiste. Ces différents textes laissent entendre que la seule solution pour mourir dans la dignité serait de bénéficier d’une assistance médicale provoquant la mort. Un des acquis emblématiques de la gauche a été de mettre fin à la barbarie de la peine de mort, au juste motif qu’aucune situation ne peut justifier la mise à mort d’un autre être humain.
droits des malades et des personnes en fin de vie, sédation profonde, directives anticipées, soins palliatifs. Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie - Panorama des lois - Actualités Où en est-on ? La loi a été promulguée le 2 février 2016. Elle a été publiée au Journal officielJournal officielJournal de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements. du 3 février 2016. Déposée à l’Assemblée nationale par MM. De quoi s'agit-il ? A la suite d’une concertation sur la question de la fin de vie, la loi pose le principe selon lequel "toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. La loi tend au développement des soins palliatifs. Sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, les traitements seront suspendus ou ne seront pas entrepris quand ils n’ont que pour seul effet un maintien artificiel de la vie et apparaissent inutiles ou disproportionnés (la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement). Le patient a le droit de refuser un traitement et le médecin a obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de son choix.
Fin de vie : ce que la loi change pour les malades DROIT DES PATIENTS. Les décrets de la loi votée en février sur les droits des personnes en fin de vie sont parus vendredi au « Journal officiel ». Voici les trois mesures phares. On meurt mal en France. La mise sous sédation profonde jusqu'à la mort Le décret précise les conditions dans lesquelles peut être décidé l'arrêt des traitements. La consigne des patients plus forte que l'avis du médecin Doit-on me maintenir en vie si un accident me plonge dans un coma irréversible ? La désignation d'une personne de confiance La nouvelle loi inscrit dans le marbre ce dispositif encore mal connu. Elle n'aurait pas réglé le cas de Vincent Lambert Vincent Lambert. OGM : le principe de précaution Le principe de précaution est inscrit dans le droit français pour protéger l'environnement contre des risques qui ne sont pas encore bien évalués. Il faut donc pouvoir prouver l'absence et non la présence de risques potentiels, un travail ardu en ce qui concerne les OGM. Dominique Lecourt (professeur de philosophie à l'université de Paris VII et délégué général de la fondation Biovision de l'Académie des sciences) revient sur le principe de précaution. Le principe de précaution en France et en Europe C'est en Allemagne, à la fin des années 1960 sous le nom de Vorsorgeprinzip, à propos de problèmes d'environnement que le principe de précaution est pour la première fois formulé. Son accession à la notoriété internationale coïncide avec la Déclaration de Rio au Sommet de la Terre en juin 1992. Le 2 février 1995, la loi Barnier l'inscrit dans le droit français sur la protection de l'environnement. Une preuve de l'absence de risque Un peu d'histoire... La prévoyance Amélioration des techniques
"Bébé-médicament" : l'équilibre périlleux d'une solution extrême Le projet de loi adopté le 15 février prévoit de pérenniser l'autorisation du double diagnostic préimplantatoire. Est-ce raisonnable ? Le Monde.fr | • Mis à jour le | Par Jean-René Binet, professeur de droit privé à l'Université de Franche-Comté, membre de l'Institut universitaire de France Depuis 2004, la loi française autorise à titre expérimental une pratique qui est sous les feux de l'actualité depuis peu. Il s'agit de concevoir un enfant par fécondation in vitro pour permettre une greffe de cellules au profit d'un grand frère ou d'une grande sœur atteint d'une maladie génétique incurable entrainant la mort dès les premières années de la vie. Cette pratique pose en effet problème, mais c'est le propre des sujets de bioéthique que de contraindre le législateur à rechercher l'équilibre entre des intérêts divergents, entre des valeurs en conflits. En 2004, parce qu'il avait conscience des problèmes soulevés, le Parlement a concédé cette technique en lui assignant des limites.