


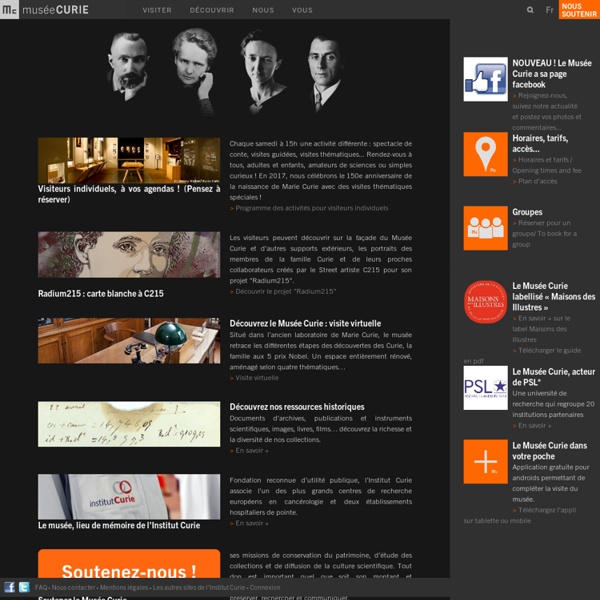
Marie Curie Marie Skłodowska-Curie vers 1920. Signature Marie Curie et Pierre Curie — son époux — partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique de 1903 pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce jour la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts[1]. Elle est également la première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium[2]. Biographie Enfance Maria Salomea Skłodowska naît à Varsovie, alors dans l'Empire russe, d'un père d'origine noble (herb Dołęga), professeur de mathématiques et de physique, et d'une mère institutrice. En l’espace de deux ans, elle perd sa sœur Zofia, morte du typhus en janvier 1876, et sa mère, qui succombe à la tuberculose le 9 mai 1878. Maladie Œuvres
Ecriture de contes orientaux Chacun connaît l'histoire de Shéhérazade, fille du grand vizir, qui raconte chaque nuit au sultan, son époux, une histoire dont la suite est toujours reportée au lendemain : c'est le moyen qu'elle a trouvé pour échapper à la mort. En effet, déçu par l'infidélité de sa première épouse, le sultan a décidé d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Grâce au stratagème qu'elle a imaginé, Shéhérazade est épargnée car son époux est impatient de connaître la suite du récit commencé la nuit précédente. Au bout de mille et une nuits, le sultan, qui finit par tomber amoureux, renonce définitivement à tuer sa jeune femme. Les Mille et Une Nuits sont constituées de contes enchâssés, mettant en scène des personnages qui se répondent les uns aux autres.
Pierre et Marie Curie Couple de physiciens français. Marie Curie, née Skłodowska (Varsovie 1867-Sancellemoz, près de Sallanches, 1934) Pierre Curie (Paris 1859-Paris 1906) 1. Introduction Le père de Pierre, Eugène Curie, médecin et fils de médecin, est d'une famille protestante originaire d'Alsace ; il est libre penseur et profondément républicain. 2. Son premier travail est une étude, en collaboration avec Desains, sur les radiations infrarouges, dont il mesure les longueurs d'onde. Mais ils doivent alors cesser leur collaboration : Jacques devient maître de conférences à Montpellier et Pierre est nommé en 1882 chef de travaux à l'École de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris, qui vient d'être fondée. 3. En 1884, il publie un mémoire sur la symétrie et les répétitions dans les milieux cristallins. 4. Cependant, le laboratoire de l'École de physique et de chimie reçoit enfin quelque matériel, et Pierre Curie peut reprendre ses recherches expérimentales. 5. 6. 7. 8.
France Collections 3D | Musée archéologie nationale Le musée d'Archéologie nationale est engagé dans une vaste campagne de numérisation 3D de ses collections, dans le cadre du projet France Collections 3D de l'agence photo de la RMN-GP. Il a été parmi les premiers musées nationaux à s'impliquer dans ce projet et des sessions de numérisation sont régulièrement oganisées depuis 2014 pour mettre à disposition de tous les modèles 3D des pièces majeures de ses collections. Quelques objets emblématiques du musée sont déjà disponibles : Le projet France Collections 3D Porté par l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais au service des musées français, ce projet va permettre la diffusion des oeuvres majeures du patrimoine français. A l'instar d'autres projets menées par les grands musées étrangers, il s'agit de modéliser en 3D une partie des collections des musées. Les applications de ces modèles 3D sont nombreux :