


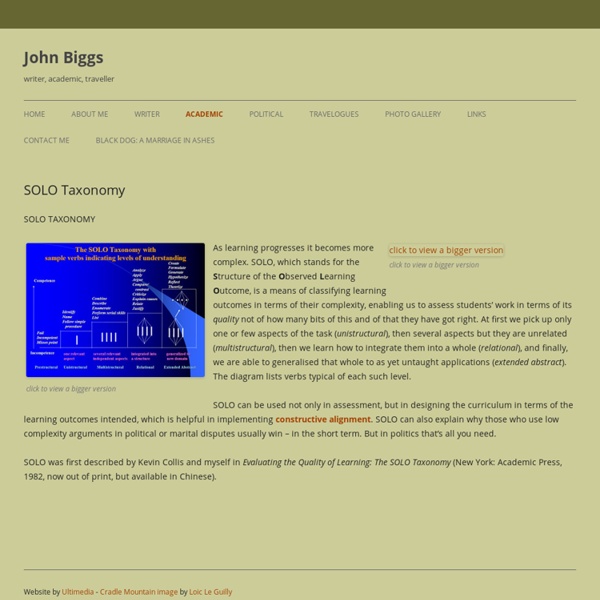
Les objectifs pédagogiques : guide pratique (3/3) Les objectifs pédagogiques : guide pratique (3/3) Un objectif pédagogique doit être exprimé avec précision et clarté, mais ce n’est pas suffisant : Pour être complet, un objectif pédagogique devrait comporter (« devrait », car dans la pratique, les objectifs pédagogiques comportent rarement tous ces éléments) : Un comportement observable (c’est-à-dire vérifiable de manière formelle) : le comportement est indiqué par le verbe dont l’apprenant est le sujet, par exemple :« être capable de remplacer un disque dur SATA défectueux par un disque en bon état ayant les même caractéristiques techniques »Des conditions d’exécution, précisant comment est effectuée l’action, par exemple :« en utilisant la documentation constructeur n° XY-385″Des critères de performances, qui précisent les limites d’acceptation de l’action effectuée, par exemple :« en moins de 30 minutes, et avec un taux d’erreur de moins de 5% » Quelques exemples d’objectifs pédagogiques précis et complets :
Strategies for Effective Lesson Planning Stiliana Milkova Center for Research on Learning and Teaching A lesson plan is the instructor’s road map of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. Before you plan your lesson, you will first need to identify the learning objectives for the class meeting. Then, you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on student learning. Objectives for student learningTeaching/learning activitiesStrategies to check student understanding Specifying concrete objectives for student learning will help you determine the kinds of teaching and learning activities you will use in class, while those activities will define how you will check whether the learning objectives have been accomplished (see Fig. 1). Steps for Preparing a Lesson Plan Below are six steps to guide you when you create your first lesson plans. (1) Outline learning objectives What is the topic of the lesson? (2) Develop the introduction Conclusion Online:
Bloom's Digital Taxonomy Verbs [Infographic] When using Bloom’s Digital Taxonomy (a revised take on Bloom’s devised by educator Andrew Churches), it helps to have a list of verbs to know what actions define each stage of the taxonomy. This is useful for lesson planning, rubric making, and any other teacher-oriented task requiring planning and assessment strategies. The Bloom’s Digital Taxonomy verbs in this handy infographic apply specifically to each stage of the taxonomy. They progress from LOTS (lower-order thinking skills) to the HOTS (higher-order thinking skills). According to Churches on his wiki Edorigami, “Bloom’s Revised Taxonomy describes many traditional classroom practices, behaviours and actions, but does not account for the new processes and actions associated with Web 2.0 technologies …” This means the verbs listed below are applicable to facilitating technology use in the modern classrooms. A Quick Reference Tool for Bloom’s Taxonomy Verbs Poster Files For You
Constructive Alignment | John Biggs In my last year of teaching, I had a class of 82 schoolteachers who were studying how psychology could be applied to teaching. It suddenly struck me how silly it was to give the usual exam or final assignment, in which my students tell me what I had told them about applying psychology to education. Rather, they should be telling me how they themselves could apply what psychology they knew to improve their teaching decisions – that was the underlying intended outcome of the course. In constructive alignment, we start with the outcomes we intend students to learn, and align teaching and assessment to those outcomes. Constructive alignment is an example of outcomes-based education (OBE). See also: Teaching for Quality Learning at University, Buckingham: Open University Press/McGraw Hill, 2011. with Catherine Tang, extends our third edition with a wider range of examples of constructive alignment on the basis of our work in several countries. Amazon USA Amazon UK
La « flipped taxonomie » Marcel LEBRUN Nous avons, dans la vidéo précédente, parler de la cohérence des objectifs, des méthodes, de l’évaluation … des outils. Les objectifs sont souvent décrits par un verbe (un savoir-faire, un savoir-agir, un savoir-être …) qui s’applique sur un nominatif (un contenu, un savoir, un savoir-faire …) : l’étudiant sera capable de « Verbe » à propos d’un « nominatif », par exemple, l’étudiant capable de citer les composantes de l’alignement constructiviste (épisode 2), l’étudiant sera capable d’appliquer la loi de Newton … Le « sera capable » associé au « verbe » est désigné par la notion de capacité. Cette capacité constitue encore un état potentiel … il sera capable, oui mais quand ? Comment ? La compétence veut dépasser cet état potentiel, mettre l’objectif, l’intention en état de fonctionner. La compétence est donc un « CCC », une ou des Capacités, qui s’appuie sur des Contenus pour résoudre des problèmes dans un Contexte donné, ou dans des familles de contextes donnés. Tardif, J. (2006).
Ice Breakers - Communication Skills Training from MindTools.com Ice breakers can be an effective way of starting a training session or team-building event. As interactive and often fun sessions run before the main proceedings, they help people get to know each other and buy into the purpose of the event. If such a session is well-designed and well-facilitated, it can really help get things off to a great start. Click here to view a transcript of this video. But have you ever been to an event when the ice breaker session went badly? As a facilitator, the secret of a successful icebreaking session is to keep it simple: design the session with specific objectives in mind and make sure that the session is appropriate and comfortable for everyone involved. This article helps you think through the objectives of your session, and then suggests various types of ice breaker you might use. When to Use Icebreakers As the name suggests, these sessions are designed to "break the ice" at an event or meeting. Consider using an ice breaker when: So What's the "Ice"?
Le guide complet de la taxonomie de Bloom La taxonomie de Bloom rappelle une évidence : apprendre, ce n’est pas répéter, c’est comprendre et utiliser. Mémoriser une règle sans savoir l’appliquer ne suffit pas. L’essentiel n’est pas d’accumuler des savoirs, mais de s’en servir. Cette classification organise les apprentissages en six niveaux progressifs, du simple au complexe. Ce guide vous donnera les outils concrets pour utiliser Bloom efficacement : définitions claires, verbes d’action, exemples pratiques et plan d’application immédiat. Qu’est-ce que la taxonomie de Bloom ? La taxonomie de Bloom est une classification des apprentissages créée en 1956 par Benjamin Bloom, puis révisée en 2001 par Anderson et Krathwohl. L’objectif principal est de faire passer les élèves de la simple récitation à la réflexion authentique et à l’innovation. Pourquoi cette classification change tout ? Le problème actuel est frappant : environ 80% des questions posées en classe se limitent aux deux premiers niveaux. Applications immédiates 1. 2. 3. 4.
5 Common Misconceptions About Bloom's Taxonomy 5 Common Misconceptions About Bloom’s Taxonomy by Grant Wiggins & The TeachThought Staff Admit it–you only read the list of the six levels of the Taxonomy, not the whole book that explains each level and the rationale behind the Taxonomy. Not to worry, you are not alone: this is true for most educators. But that efficiency comes with a price. 1. This is false. The essential behavior in interpretation is that when given a communication the student can identify and comprehend the major ideas which are included in it as well as understand their interrelationships. Not only is this higher-order thinking – summary, main idea, conditional and cautious reasoning, etc. 2. This is not true, a misreading of the word “apply”, as the text makes clear. The whole cognitive domain of the taxonomy is arranged in a hierarchy, that is, each classification within it demands the skills and abilities which are lower in the classification order. Why UbD is what it is. 3. 4. 5. No they weren’t.
la pédagogie par objectifs | Didac2b la pédagogie par objectifs Les applications du type Opale suggèrent de présenter les objectifs en début de séquence. Obnubilés par la dernière innovation web 2.0, par une interpolation de mouvement dans un logiciel qui fait du flash « sans connaissance de l’Actionscript » ou par une pop-up qui ne veut pas s’ouvrir chez un stagiaire, nous avions un peu oublié ce que sont ces objectifs. Rafraichissement : Les objectifs pédagogiques ont été popularisés par Mager et Bloom au début des années 60. sous forme de comportement observable décrits par des verbes d’action (la performance) ;avec des critères précis (le niveau de performance) ;et une indication des conditions de réalisation. Dans la formation, une séquence est la période pendant laquelle on traite d’un objectif. Pour rédiger un objectif, on utilise des verbes d’action qui décrivent des comportements observables. La taxonomie de Bloom peut nous y aider : La taxonomie de Bloom la pyramide de Bloom WordPress: J'aime chargement…
Qui connaît la taxonomie de Bloom Schéma d'Olivier Legrand (détail) C’est un exemple pur de la façon dont la twittosphère peut dévorer notre temps. Mais c’est aussi l’inverse : une preuve de l’intérêt à s’exposer l’esprit à des centaines de sollicitations imprévues et à se laisser emporter par ses élans de curiosité. Le merveilleux éducatif (à ne pas confondre avec le pittoresque, façon « j’ai survécu dans l’enfer du neuf-trois ») fait voyager non seulement à travers les classes, les salles des profs ou les amphis, mais aussi à travers les époques, les concepts et les délectables controverses que génère le thème « éducation ». Au cours d’une déambulation sur Twitter, je suis, donc, tombé sur la taxonomie de Bloom. Il est reconnu par le Larousse, qui le définit comme la « science des lois de la classification » et l’étend à toute « classification, suite d'éléments formant des listes » dans un domaine donné. Autant dire que tout travail d’analyse, d’une certaine façon, commence par une démarche de taxonomie. Et Bloom ?
Taxonomie de Bloom Plus récemment, d'autres auteurs (Wang, Haertel et Walberg, 1993) ont souligné l'effet de variables complémentaires telles que les processus métacognitifs ou le climat de la classe. Les élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés: la pédagogie de maîtrise insiste beaucoup sur l'importance des remédiations qui vont de pair avec l'évaluation permanente des acquis des élèves. A ce propos, Bloom parle d'évaluation formative pour désigner une forme d'évaluation intégrée au processus d'apprentissage et dont le but est le diagnostic immédiat des difficultés pour pouvoir y apporter une réponse rapide sous la forme de remédiations ajustées aux besoins de chacun. La régulation permanente des apprentissages à travers la passation régulière de tests et l'apport judicieux d'activités de remédiation permet, selon Bloom, d'envisager un enseignement collectif dont l'efficacité ne serait pas loin d'égaler les effets du tutorat individuel.
Taxonomie de Bloom Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La roue de la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d'acquisition des connaissances[1]. Description[modifier | modifier le code] La taxonomie organise l'information de façon hiérarchique, de la simple restitution de faits jusqu'à la manipulation complexe des concepts, qui est souvent mise en œuvre par les facultés cognitives dites supérieures[4]. Composition[modifier | modifier le code] La taxonomie des objectifs éducationnels selon Bloom. Elle peut être résumée en six niveaux, chaque niveau supérieur englobant les niveaux précédents. Note: Dans la liste suivante, traduite de l'anglais, certains verbes peuvent se recouper par le sens, le lecteur est invité à consulter des ouvrages de références pour s'assurer du sens exact des verbes. Révision[modifier | modifier le code] Ainsi en 2001 une taxonomie révisée de Bloom a été proposée par plusieurs auteurs dont Lorin W.
Taxonomie de Bloom Appellation en anglais Bloom’s taxonomy - The taxonomy of educational objectives Résumé introductif La taxonomie de Bloom (1956) est un modèle de conception pédagogique qui consiste à regrouper des objectifs d'apprentissage, du plus simple au plus complexe, en 6 catégories ou types d'activités du domaine cognitif: la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l’évaluation. Stratégies apparentées Type de stratégie Cette stratégie est du type modèle, car elle vise en premier lieu le découpage et l’ordonnancement du contenu d’enseignement sous forme de progression pédagogique. Plus précisément, la taxonomie de Bloom est un modèle plutôt centré sur l'apprentissage. Types de connaissances Selon l’objectif d’apprentissage qui est formulé à l’aide de la taxonomie de Bloom et de la microstratégie utilisée pour l’atteindre, des connaissances de types conceptuelles, factuelles, métacognitives et procédurales peuvent être visées. Description « 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bibliographie