


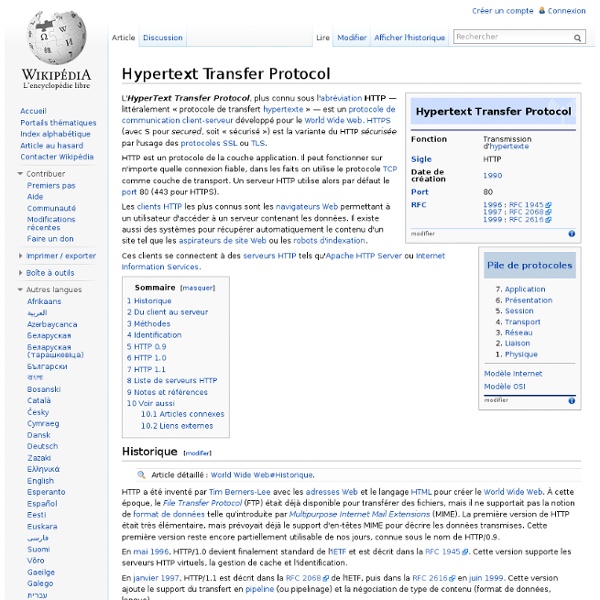
World Wide Web Le World Wide Web (/ˌwɜːld waɪd ˈweb/[a]), abrégé en WWW, W3, le Web, la toile mondiale ou simplement la toile[1], est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de consulter, à l'aide d'un navigateur, des pages regroupées en sites. Web signifie littéralement « toile (d’araignée) », image représentant les hyperliens qui lient les pages web entre elles[b]. Le Web est une des applications d’Internet[2], qui est distincte d’autres applications comme le courrier électronique, la visioconférence et le partage de fichiers en pair à pair. Inventé en 1989-1990 au CERN par Tim Berners-Lee épaulé de Robert Cailliau, le Web a popularisé Internet[3]. Le World Wide Web est désigné par de nombreux noms et abréviations synonymes : WorldWideWeb, World Wide Web, World-wide Web, Web, WWW, W3, Toile d’araignée mondiale, Toile mondiale, Toile. Pour écrire « le web », l’usage de la minuscule est de plus en plus courant. Exemple :
Cookie (informatique) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Cookie. En informatique, un cookie (ou témoin de connexion, abrégé en témoin au Québec[1]) est défini par le protocole de communication HTTP comme étant une suite d'informations envoyée par un serveur HTTP à un client HTTP, que ce dernier retourne lors de chaque interrogation du même serveur HTTP sous certaines conditions. Le terme cookie dérive du terme anglais magic cookie, qui est un paquet de données qu'un programme reçoit et renvoie inchangé. Les cookies étaient déjà utilisés en informatique quand Lou Montulli[2] a eu l'idée de les utiliser dans les communications Web en juin 1994. En ce temps, il était employé de Netscape Communications, qui avait développé une application de e-commerce pour un client. John Giannandrea et Lou Montulli ont écrit la même année la première spécification des cookies de Netscape. L'introduction des cookies n'a pas été largement connue du public pour autant.
File Transfer Protocol Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir FTP. File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers. La variante de FTP protégée par les protocoles SSL ou TLS (SSL étant le prédécesseur de TLS) s'appelle FTPS. FTP obéit à un modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'une des deux parties, le client, envoie des requêtes auxquelles réagit l'autre, appelé serveur. FTP, qui appartient à la couche application du modèle OSI et du modèle ARPA, utilise une connexion TCP. Ce protocole peut fonctionner avec IPv4 et IPv6. Histoire[modifier | modifier le code] Interopérabilité[modifier | modifier le code]
Tim Berners-Lee Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee en 2010. Compléments Timothy John Berners-Lee, KBE, né le 8 juin 1955 à Londres, est un citoyen britannique, principal inventeur du World Wide Web (WWW) au tournant des années 1990. Biographie[modifier | modifier le code] Tim Berners-Lee est né le 8 juin 1955 à Londres, en Angleterre. Il est père de deux enfants. Carrière[modifier | modifier le code] L'invention du World Wide Web[modifier | modifier le code] L'ordinateur NeXT, utilisé par Tim Berners-Lee pour inventer le World Wide Web. En 1980, il intègre l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). L'objectif de cette proposition est le partage des documents informatiques, ce que Tim Berners-Lee a l'idée de réaliser en associant le principe de l’hypertexte à l'utilisation d'Internet. Capture d'écran du navigateur World Wide Web C'est en mai 1990 qu'il adopte l'expression de World Wide Web pour nommer son projet.
Pair à pair Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le pair à pair peut être centralisé (les connexions passant par un serveur central intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant directement). Il peut servir au partage de fichiers en pair à pair, au calcul distribué ou à la communication. Principe général[modifier | modifier le code] Le pair-à-pair a permis une décentralisation des systèmes, auparavant basés sur quelques serveurs exposés à la censure et à l'enregistrement en masse de données privées : il permet à tous les ordinateurs de jouer directement le rôle de client et serveur (voir client-serveur). En particulier, les systèmes de partage de fichiers permettent de rendre les objets d'autant plus disponibles qu'ils sont populaires, et donc répliqués sur un grand nombre de nœuds. L'utilisation d'un système pair-à-pair nécessite pour chaque nœud l'utilisation d'un logiciel particulier. Le modèle pair-à-pair va bien plus loin que les applications de partage de fichiers.
Internet Protocol Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir IP. Internet Protocol (abrégé en IP) est une famille de protocoles de communication de réseau informatique conçus pour être utilisés par Internet. Les protocoles IP sont au niveau 3 dans le modèle OSI. Les protocoles IP s'intègrent dans la suite des protocoles Internet et permettent un service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux connectés. Fonctionnement[modifier | modifier le code] Lorsque deux terminaux communiquent entre eux via ce protocole, aucun chemin pour le transfert des données n'est établi à l'avance : il est dit que le protocole est « non orienté connexion ». Services délivrés[modifier | modifier le code] Les protocoles IP assurent l'acheminement au mieux (best-effort delivery) des paquets. Fiabilité[modifier | modifier le code] Les garanties qu'un protocole IP n'offre pas sont déléguées aux protocoles de niveau supérieur. Historique des versions[modifier | modifier le code] En-tête IPv4.
John Eckert Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Eckert. Études[modifier | modifier le code] Eckert s'est d'abord lancé dans des études commerciales à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, avec l’encouragement de ses parents, mais en 1937 il rejoint la Moore School of Electrical Engineering (en). À Moore School, Eckert participa aux recherches sur la synchronisation des radars, améliora la vitesse et la précision de l’analyseur différentiel de la Moore School et, en 1941, il devint assistant de laboratoire pour un cours d’été en électronique pour l’entrainement à la défense proposé via la Moore School par le Département de la Guerre des États-Unis. L’invention de l’ENIAC[modifier | modifier le code] Le docteur John Mauchly, alors directeur du département de physique de l’Ursinus College (en) situé à proximité, était étudiant du cours d’été en électronique. Esprit d’entreprise[modifier | modifier le code] Une démonstration de l’UNIVAC I
IPv4 Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. IPv4 (Internet Protocol version 4) est la première version d'Internet Protocol (IP) à avoir été largement déployée, et qui forme encore en 2013 la base de la majorité des communications sur Internet, avec l'IPv6. Elle est décrite dans la RFC 791 de , remplaçant la RFC 760, définie en . Chaque interface d'un hôte IPv4 se voit attribuer une ou plusieurs adresses IP codées sur 32 bits. L'épuisement des adresses IPv4 a conduit au développement d'une nouvelle version d'IP, IPv6, et à la transition d'IPv4 vers IPv6 afin d'adopter cette nouvelle version. Représentation d'une adresse IPv4[modifier | modifier le code] Une adresse IPv4 est représentée sous la forme de quatre nombres décimaux séparés par des points comme par exemple 193.43.55.67. En-tête IPv4[modifier | modifier le code] Version (4 bits) : version d'IP utilisée. Longueur de l'en-tête ou IHL (pour Internet Header Length) (4 bits) : Type de service ou ToS (pour Type of Service) (8 bits) :
Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L'ENIAC (acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer), est le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing-complet. Il peut être reprogrammé pour résoudre, en principe, tous les problèmes calculatoires. Histoire[modifier | modifier le code] Le principe de l'ENIAC vient d'une idée de John William Mauchly, professeur de physique. Participant à une conférence à l'Ursinus College, il voit des analystes produire des tables de tir, il se rend compte que ces calculs pourraient être réalisés électroniquement. Le , il est dévoilé au public à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie puis est transféré à Aberdeen Proving Ground, un laboratoire de l'US Army au Maryland, en 1947 où il est remis en marche le 29 juillet et commence les calculs des tables de tirs. Caractéristiques[modifier | modifier le code] Détail d'un panneau de contrôle de l'ENIAC