


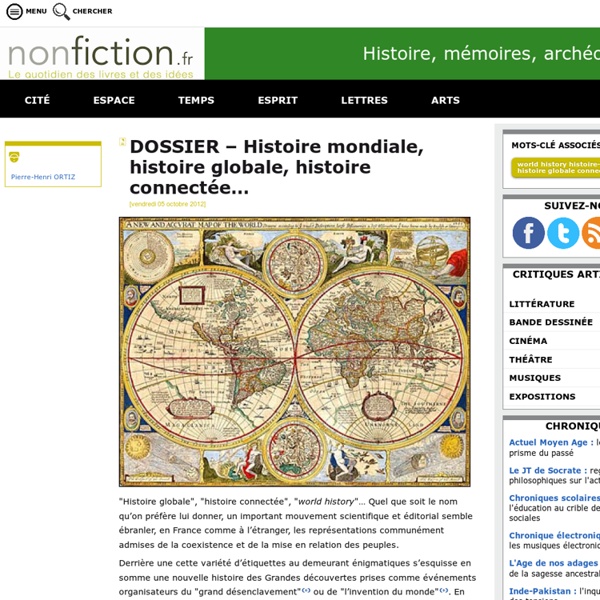
L'histoire globale pour tous L'histoire globale pour tous [dimanche 03 février 2013 - 11:00] Histoire Inventer le monde. Éditeur : La Documentation Française 64 pages Combien de temps faut-il à une innovation pour se diffuser dans la société ? À défaut d'apporter une réponse, le dernier livre de Patrick Boucheron contribue à l'accélération de ce processus. Synthétiser le foisonnement Difficile de résumer en quelques pages la richesse des évolutions de l'histoire du monde. Ces mondialisations auraient pu être chinoise ou turque, puisqu'à cette époque, l'islam est l'un des principaux facteurs de décloisonnement du monde via le commerce. L'introduction en forme de récit se double d'une mise au point très claire dans le domaine de l'historiographie. Mettre en avant la diversité Les documents accompagnés de mises au point de l'auteur font la part belle aux peintures, aux photographies d'objets et aux cartes. Finalement, c'est un support pédagogique luxueux qu'a édité La Documentation Française.
Pour l’histoire connectée Recensé : Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales, Paris, Seuil, 2011, 670 p., 28,40 euros Le 22 juin 1596, quatre vaisseaux hollandais commandés par Cornelis de Houtman jettent l’ancre en rade du port de Banten, à Java. Ils sont venus chercher les précieuses épices, le poivre en particulier, dont l’accès leur est devenu bien difficile en Europe depuis que leur adversaire acharné, le roi d’Espagne Philippe II, est devenu aussi roi du Portugal. À Banten, Houtman et ses hommes découvrent une cité de 40 000 habitants, un kaléidoscope linguistique déroutant (on y parle javanais, malais, soundanais…), des marchands persans, gujaratis et chinois aux réseaux bien installés, et une société complexe en proie à d’intenses conflits politiques. Comment les Hollandais seront-ils reçus, et que peuvent-ils comprendre de cet univers inconnu ? Penser la rencontre La distance est telle entre ces univers sociaux qu’on peut même se demander si la rencontre a pu avoir lieu. Une histoire à parts égales
La loi, la mémoire et l'histoire par Jean-Denis Bredin de l’Académie française Canal Académie vous propose d’écouter la retransmission de la communication de Jean-Denis Bredin de l’Académie française, le 29 septembre 2008 devant ses confrères de l’Académie des sciences morales et politiques, à l’Institut de France : La Loi, la mémoire et l’histoire, un sujet au cœur du débat sur les lois mémorielles. Jean-Denis Bredin de l’Académie française, à l’Académie des sciences morales et politiques, le 29 septembre 2008 © Canal Académie Jean-Denis Bredin pense que rien n’est plus banal que d’instrumentaliser l’histoire et que l’histoire n’appartient à personne. Elle est une école de la critique et de l’intelligence. Pour en savoir plus Jean-Denis Bredin de l’Académie française
Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia : CAPES d’Histoire et de Géographie. Bibliographie actualisée pour l’épreuve sur dossier. Christian Delacroix,François Dosse et Patrick Garcia Cette bibliographie constitue une remise à jour du document publié en mai 2002. Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia dirigent la collection « Histoire en débats », Points-Seuil. Ils ont publié ensemble : Les courants historiques en France aux 19e et 20e siècles, 1999. Michel de Certeau, chemins d’histoire, avec Michel Trebitsch, 2002. L’indispensable … Les rapports du jury (à lire avant tout autre chose…). Lire attentivement les trois ou quatre derniers rapports du jury (publiés chaque année —novembre— par la revue Historiens et Géographes). Ouvrages « de base»… • Philippe Poirrier, Aborder l’histoire, Mémo-Seuil, 2000. En 96 pages (!) • Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Points-Seuil, (se procurer l’édition la plus récente). Désormais l’ouvrage de référence en épistémologie de l’histoire pour l’épreuve. à aussi l’avantage de proposer de nombreux textes courts. nb.
Patrick Boucheron : "L'histoire doit se défaire de son européo-centrisme" - 30 juin 2013 - Bibliobs Le Nouvel Observateur. Depuis une dizaine d'années, on assiste à l'essor d'une nouvelle histoire. Vous venez de publier un manifeste critique en faveur de l'histoire-monde. Pourquoi? Patrick Boucheron. L'histoire-monde est bien sûr un mot-monstre. La première se donne le monde pour objet et pour échelle. L'histoire connectée, illustrée notamment par Sanjay Subrahmanyam ou Serge Gruzinski, est radicalement différente de conception et de méthode. Merci, votre inscription a bien été prise en compte. Avec l'histoire connectée on est toujours dans le local, mais un local globalisé. Au total, la méthode de l'histoire-monde peut se ramener à quelques exigences générales: varier la focale et questionner les points de vue à partir desquels on regarde les phénomènes historiques. Mais il y a également une dimension politique dans cette histoire globale : déconstruire le «grand récit» européen de l'histoire du monde... Ce n'est pas un hasard. Propos recueillis par Gilles Anquetil
Le postmodernisme en géographie Louis Dupont Vous avez donné deux éléments pour apprécier la modernité, l’état objectif des choses, une réalité et une attitude, d’une part, et une manière de penser, donc tout un appareillage conceptuel et théorique, d’autre part. Vous en avez implicitement inclus un troisième, la critique postmoderne de la modernité, qui doit faire ses preuves. Cela me semble très pertinent car, pour être légitime, la pensée postmoderne doit prouver ou doit démontrer la rupture, autrement dit on ne pourra jamais légitimement dire qu’il y a une pensée postmoderne, une réalité postmoderne, tant qu’on n’a pas démontré la rupture d’avec la modernité. C’est le nœud, le cœur du problème, la rupture doit d’abord être discutée en termes épistémologiques et théoriques, mais aussi par rapport à la réalité. Jean-Marc Besse Cette intervention va me permettre de rappeler une chose à propos du thème de la rupture avec la modernité, et de l’idée selon laquelle il y aurait quelque chose après la modernité.
Sanjay Subrahmanyam : Aux origines de l'histoire globale « Après un rapide survol des tendances historiographiques sur la longue durée », l'historien, Sanjay Subrahmanyam explique dans sa leçon inaugurale que : « la circulation des textes et des matériaux oraux et écrits entre les XVIe et le XVIIIe siècles a produit une conjoncture générale qui permettait un éventail de possibilités quant à la production historique à l’échelle globale ».Les « historiographies se mettent clairement « en conversation » entre 1580 et 1620. Cette généalogie de l’histoire connectée est nourrie d’une série d’exemples concrets où le polyglotte Sanjay Subrahmanyam jubile à donner les noms de ces prédécesseurs mongols, portugais, ottomans, chinois… et les titres des ouvrages et autres chroniques dans leur langue d’origine. On voyage dans les textes, dans les temps et les thèmes mais aussi dans les sonorités… Il pratique cette histoire avec la malice iconoclaste d’un savant aux semelles de vent. Pour l’historien, Roger Chartier, qui y enseigne également, Pour prolonger :
M. SORRE introduction INTRODUCTION*a Je veux inscrire aux premières lignes de ce livre les noms de Paul Vidal de la Blache et de Charles Flahault. Les entretiens et les conseils de ces maîtres ont orienté mon esprit vers les problèmes de la géographie humaine en liaison avec la biologie. Depuis qu’ils ont disparu, les sciences biologiques ont fait d’importantes acquisitions. Ce livre n’est ni un Traité, ni un Manuel. On trouvera ici le fruit de réflexions poursuivies durant des années. La première tâche de la géographie humaine consiste dans l’étude de l’homme considéré comme un organisme vivant soumis à des conditions déterminées d’existence et réagissant aux excitations reçues du milieu naturel. Les maîtres de la géographie humaine ont été attirés par ces problèmes. L’écologie humaine revendique des titres anciens. En regard du monde inanimé et du monde vivant, ou plutôt tout mêlé à leur activité, l’homme. Encore est-il trop simple de parler de l’homme. Notre tâche présente est assez vaste. Max. * M.
Introduction : Pourquoi l’histoire globale ? Hugh Trevor-Roper, The Rise of Christian Europe, New York, Harcourt, Brace & World, 1965, p. 9 ; cité dans Romain Bertrand, « Histoire globale, histoires connectées : un “tournant” historiographique ? », in André Caillé et Stéphane Dufoix (dir.), Le « tournant global » des sciences sociales, Paris, La Découverte, 2013, p. 44-66. Cf. Chloé Maurel, « La World/Global History : questions et débats », Vingtième siècle, n° 104, octobre-décembre 2009, p. 153-166. Entreprise conjointe du GESI [Institut des études européennes et globales de l’université de Leipzig] et de l’unité mixte de recherches UMR 8547 Transferts culturels du CNRS à Paris. Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières. Philippe Norel, L’histoire économique globale, Seuil, Paris, coll. « Points économie », 2009. Pierre-Yves Saunier, Akira Iriye (dir.), Palgrave Dictionary of Transnational History, Londres, Palgrave Macmillan, 2009. Le Débat, numéro intitulé « Écrire l’histoire du monde », n° 154, mars-avril 2009. Haut de page
Mondialisation : regards de géographes - Laurent Testot, article Géographie La mondialisation bouleverse tout : la notion de citoyenneté comme les rôles des États ou les échelles de l’espace… La géographie se doit de repenser ces concepts. Éclairages. Une jeune femme de l’ethnie Tamang, accrochée à une immense balançoire, s’envole vers le ciel himalayen… Cette image semble flotter hors du temps. Mondialisation : la relecture des géographes Cette mondialisation tamang s’effectue dans le cadre plus large de la mondialisation du Népal. Nous sommes tous des Tamang Cet ouvrage se situe dans la filiation d’un livre publié en 1992, Le Monde : espaces et systèmes, conçu par trois géographes, Marie-Françoise Durand, J. L’invention du MondeUne géographie de la mondialisation Jacques Lévy (dir.), avec Patrick Poncet, Dominique Andrieu, Boris Beaude, René-Éric Dagorn, Marc Dumont, Karine Hurel, Alain Jarne, Blandine Ripert, Mathis Stock et Olivier Vilaça, Presses de Sciences Po, 2008.
Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique | Alternatives Economiques Ça bouge dans le monde des historiens. Pour preuve, le fort intéressant supplément du dernier numéro de la Revue d’histoire moderne contemporaine consacré à " l’histoire globale ". Cette nouvelle façon d’aborder l’histoire sort des déterminismes nationaux et du récit qui ne consiste à lire l’histoire du monde que comme une occidentalisation progressive. Les historiens français semblent bouder ces nouvelles approches qui tentent pourtant de créer une " histoire connectée ", selon l’expression de Sanjai Subrahmanyam.
Pascal Ory, L’histoire culturelle ; ... - La Cliothèque L’histoire culturelle est d’abord le produit d’une demande sociale ; son succès auprès des contemporanéistes en atteste. Considérée comme un secteur en sous-développement en 1986 , elle s’installe dans les questions de l’agrégation d’histoire et dans les programmes du secondaire à partir de la fin des années 1980. Son expansion agace, certains n’y voyant, comme François Bédarida, qu’une « tarte à la crème » ; pourtant, deux ans plus tard, Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli observent la prolifération de l’adjectif « culturel » apposé sur tant de travaux historiques et expliquent cet intérêt des historiens par le contexte d’un siècle finissant dans lequel seule la culture créerait du lien et produirait du sens . Les deux auteurs, partent d’un constat identique qui est l’institutionnalisation et l’autonomisation de l’histoire culturelle dans le champ bibliographique. Copyright Clionautes