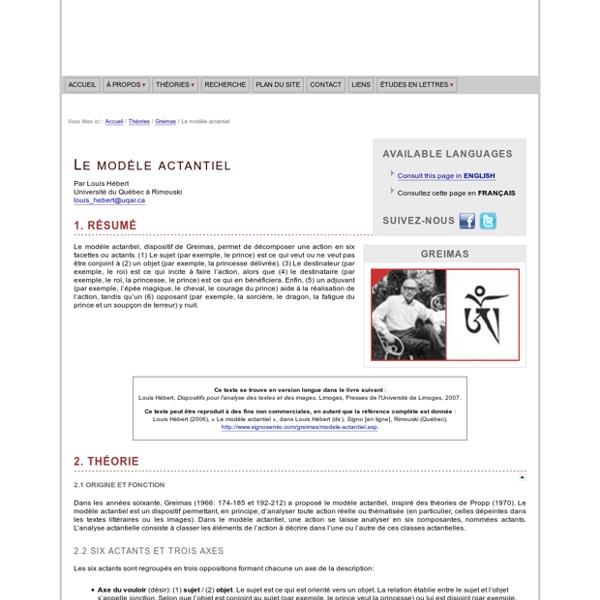Contes des ères abyssales
Néopassaction
20/04/16De nombreuses académies signent avec l'IFÉ des conventions d'utilisation de nos clés USB Néopass qui intègrent une formation de formateurs sur site.Si vous êtes intéressés, le calendrier d'accompagnement 2016/2017 est en cours de finalisation. Voir la carteContactez-nous 13/11/15Tout Neopass sur une clé USB : c’est maintenant ! Nous proposons de nouvelles modalités de collaboration aux rectorats et directions académiques qui souhaitent équiper leurs formateurs d’une version autonome de Neopass. Des précisions sur les conditions du partenariat ? Contactez-nous 25/09/2015Deux nouveaux parcours disponibles Conçus par le centre Alain-Savary et utilisant les ressources de la plateforme Néopass@ction, découvrez ces deux parcours de formation hybrides : 07/09/2015Nouveau : Le thème 8 : Débuter comme formateur, tuteur, conseiller pédagogique est en ligne Faut-il aider l’enseignant à faire classe ou à apprendre à faire classe ? Découvrir ce nouveau thème
Exemple de création d’un jeu de rôle programmé en 6e : Livre-jeu et livre dont vous êtes le héros
Camille Brouzes, professeur documentaliste au collège du Marais de Saint-Jean-de-Daye (Manche) a testé la création de livres-jeu numériques avec des élèves de 6ème. Il a choisi de travailler sur le livre-jeu car il offre une alternative aux productions classiquement associés à une recherche documentaire (panneaux d’exposition, exposé, textes de synthèse...). Deux projets menés Le premier projet de Camille Brouzes est issu d’une collaboration avec Elsa Massart, une enseignante d’histoire et une classe de 6ème. Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé (AP) en 6ème, Camille Brouzes a également travaillé sur la création d’un livre-jeu, plutôt du type « livre dont vous êtes le héros ». A la recherche des mythes, livre-jeu réalisé par des élèves de 6ème avec les professeurs documentaliste et d’histoireLe livre des 6ALe livre des 6BLe livre-jeu créé dans le cadre de l’AP 6ème Selon Camille Brouzes, le frein principal à ce type d’activités avec les élèves est le temps. Envie de lire ?
ZTAB
ZTAB is a free software for creating very easily Text adventure games : Build text adventure games, gamebooks or visual novelsText, image and sound based aventure gamesSimple and intuitive (no script at all)Graphical game edition (no script at all)Structurate your mind : draw facts, actions, conditions, and group factsDesign as you play:you playyou need to enhance ?just add new text, conditions, imagesand... continue playingnothing simpliest !As you design, ZTAB points out your errors.Import / export in many project formats:.avh (Advelh).tws (Twine).aslx (Quest).rpy (Ren'Py)Generate playable games:with runneror in HTMLGenerate clickable gamebooksRTFHTMLEPUBPDFUpload to your websitePrintConfidentiality mode System requirements : * Windows XP, Vista, 7, 8 (With .Net 4.0), 10 * Ubuntu (see docs to see how to make it work)
F - Les livres dont vous êtes le héros pour apprendre le français
Vous avez peut-être lu ce type de livre lorsque vous étiez enfant. Les livres dont vous êtes le héros, aussi appelés des livres-jeux, sont des romans divisés en chapitres à la fin desquels vous avez souvent une décision à prendre pour faire avancer l’histoire. Par exemple : Si vous voulez escalader la falaise, allez au chapitre 17.Si vous aimeriez rester où vous êtes, continuez la lecture.Si vous préfériez trouver un autre chemin, lisez le chapitre 14. Vous sautez donc des chapitres afin de faire avancer votre histoire, avec plusieurs fins du livre possibles. Il y a plusieurs bienfaits des livres dont vous êtes le héros en ce qui concerne l’apprentissage du français (ou une autre langue) : La lecture devient plus interactive. Des livres numériques dont vous êtes le héros à lire sur votre liseuse : Les livres dont vous êtes le héros s’adaptent bien au format livrel parce qu’il y a souvent des liens à la fin de chaque chapitre qui nous amènent exactement où on veut. EnregistrerEnregistrer
Introduction to ChoiceScript
A basic guide to the ChoiceScript programming language. Please post on the ChoiceScript forum if you have questions about ChoiceScript. What is ChoiceScript? ChoiceScript is a simple programming language for writing interactive novels like Choice of the Dragon. When you’re done, you can submit your finished ChoiceScript game to us so that we can host it for you publicly; we’ll give you a share of the revenue your game produces. Trying it out To begin, if you haven’t already, you’ll need to install Node.js. Next, download the ChoiceScript source from GitHub. You’ll need to extract the entire zip file. Once you’ve extracted the zip file, you’ll need to launch the ChoiceScript server. Windows: Double-click on run-server.bat. Launching the ChoiceScript server will open a window for the server, and it will also open your browser, showing you the example game. Your First Scene: *choice and *finish Here’s a simple scene written in ChoiceScript. Go On, Play with It! Indentation *choice #Hold 'em.