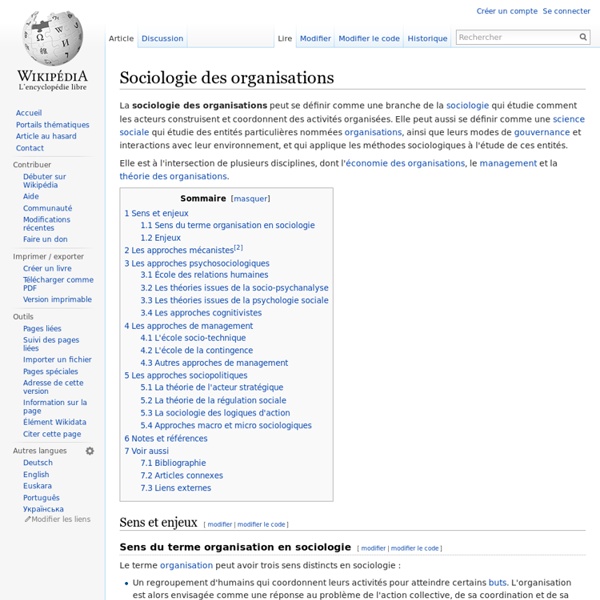La Troisième Vague
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Préambule d'avertissement[modifier | modifier le code] Chronologie de l’expérience d’après Ron Jones[modifier | modifier le code] Lundi[modifier | modifier le code] Jones donne une allocution sur la discipline : comment elle est nécessaire aux athlètes, aux artistes, aux scientifiques, et comment, par la maîtrise de soi, elle assure la réussite des projets. Mardi[modifier | modifier le code] Mercredi[modifier | modifier le code] Jeudi[modifier | modifier le code] Vendredi[modifier | modifier le code] Le journal de l’école, le Cubberley Catamount, consacre à l’expérience une brève extrêmement courte (numéro du [1]) et un article de fond, pourtant assez peu détaillé (numéro du [2]). Réactions et suites de l’expérience[modifier | modifier le code] Des psychologues s’intéressèrent alors à l’expérience menée par Ron Jones, notamment en matière de malléabilité d’esprit chez les adolescents. Questions de vérité historique[modifier | modifier le code]
ABC de la sociologie des organisations - Cours de théorie des organisations
La sociologie des organisations s'intéresse aux entités particulières que sont les organisations – définies comme un ensemble de personnes, de dispositifs techniques et de pratiques sociales en interaction - et applique des méthodes sociologiques à leur description. Elle étudie par exemple comment les acteurs construisent et coordonnent des activités organisées, l'identité au travail, la culture d'entreprise, l'histoire des formes d'organisation et la genèse des règles qui les régissent. On parle également de théorie des organisations, voire de sciences des organisations pour désigner l'ensemble des disciplines concernées (la sociologie, mais aussi l'économie, la gestion, les sciences politiques etc.). Dans le cadre d'un internet qui devient "massivement relationnel" elle s'intéresse à l'étude des réseaux sociaux et aux questions de l'identité numérique ou des identités numériques… Ces cours en diapositives animées, vidéo, pptx, pdf sont distribués sous licence Creative Commons 1. 2. 3.
Stéréotypes : Définition et caractéristiques
Stéréotypes : Définition et caractéristiques 1. Stéréotype et préjugés Le préjugé peut être défini comme une « attitude de l’individu comportant une dimension évaluative, souvent négative, à l’égard de types de personnes ou de groupes, en fonction de sa propre appartenance sociale. C'est donc une disposition acquise dont le but est d’établir une différenciation sociale » (Fischer, 1987) Le préjugé a deux dimensions essentielles : l’une cognitive, l’autre comportementale. Le stéréotype, quant à lui, « désigne les catégories descriptives simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui ou des groupes d’individus » (Fischer, 1987) Les stéréotypes correspondent donc à des traits ou des comportements que l’on attribue à autrui de façon arbitraire. 2. La notion de stéréotype apparaît dans le domaine des sciences sociales avec le développement de la théorie des opinions. 3. Source : Cours de Psychologie Sociale - Dijon
Capitalisme
La mise en forme de cet article est à améliorer(octobre 2017). La mise en forme du texte ne suit pas les recommandations de Wikipédia : il faut le « wikifier ». Comment faire ? Les points d'amélioration suivants sont les cas les plus fréquents. Pour une aide détaillée, merci de consulter Aide:Wikification. Si vous pensez que ces points ont été résolus, vous pouvez retirer ce bandeau et améliorer la mise en forme d'un autre article. Le capitalisme désigne l'économie de marché, vue sous l'angle du rôle des capitalistes, entrepreneurs ou épargnants, et du montant de leurs investissements dans la production de biens et de services. L'entreprise de production de biens et services crée de la valeur ajoutée par différence entre ses ventes et ses achats. Ambiguïtés de significations[modifier | modifier le code] Sa définition diffère dans le temps, dans l'espace, et en fonction des sensibilités politiques des personnes qui l'emploient. Étymologie[modifier | modifier le code] En 1932, M.
Théorie de la connaissance
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Une partie de cet article porte sur la théorie analytique de la connaissance, discipline philosophique qui s'est pour l'essentiel développée dans le monde anglophone[1]. Le monde germanique, de par l'apport anglo-saxon a repris les résultats analytique pour les réunir dans une théorie globalisante. Le passage est très distinct de Locke, Berkeley, Hume à Kant pour l'analytique. Définition classique de la connaissance[modifier | modifier le code] Croyance vraie justifiée[modifier | modifier le code] L'approche classique définit la connaissance comme une croyance vraie et justifiée[2], et non seulement une croyance vraie. Le terme de « connaissance » a longtemps désigné, en philosophie, des croyances dont la vérité est justifiée de manière certaine. Le problème de Gettier et les analyses contemporaines de la connaissance[modifier | modifier le code] Dans un célèbre article intitulé « Is Justified True Belief Knowledge? Jean C.
Expérience de Rosenhan
L'étude de Rosenhan est composée de deux parties. La première implique la participation d'associés en bonne santé mentale, les « pseudo-patients », qui simulent des hallucinations auditives brèves dans le but d'être admis dans douze hôpitaux psychiatriques des États-Unis, répartis dans cinq États différents du pays. Ils ont tous été admis et reconnus souffrant de désordres psychiatriques. Après leur admission, ils agissent normalement et déclarent au personnel soignant qu'ils se sentent bien, et n'ont plus d'hallucination du tout. Le personnel de l'hôpital échoue dans chaque cas à détecter la supercherie, et reste au contraire persuadé que tous les pseudo-patients montrent les symptômes d'une maladie mentale. La seconde partie consiste à demander au personnel d'un hôpital psychiatrique d'identifier de faux patients dans un groupe qui n'en comporte pas. Les pseudo-patients[modifier | modifier le code] « I told friends, I told my family, 'I can get out when I can get out. Maurice K.
GINALEX : Managers de Proximité, de Terrain et Agent de Maitrise, Formation Douai
De L'Individu À L'Acteur - Note de recherches - Pomponlili
Thème 1 : De l’individu à l’acteur. Chapitre 1 : Comment un individu devient-il acteur dans une organisation. I.Caractériser les fonctionnements individuels. L’individu, dans l’organisation, est toujours un être social, et de ce fait il estcaractérisé par sa personnalité, ses émotions, sa perception. 1.1 Personnalité et émotions. La personnalité correspond à l’ensembledes caractéristiques d’une personne donnée, qui définissent son individualité et permettent de la distinguer de tout autre être humain(Roger Perron). Lire la dissertation complète Citer cette dissertation (2012, 09). "De l'individu à l'acteur" Etudier.com. 09 2012. 2012. 09 2012 < "De l'individu à l'acteur." "De l'individu à l'acteur."