


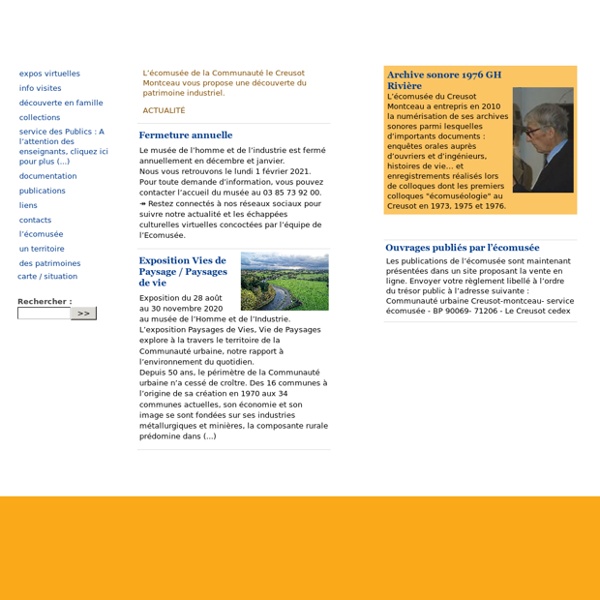
Mémoires d’un paysan bas-breton/Texte entier C’était en 1897, un soir de juin. J’habitais alors la vieille maison de Stang-ar-C’hoat, à l’orée de Quimper. On vint m’avertir qu’un glazik était dans le jardin, qui demandait à me parler. Glazik — comme qui dirait : « azuré » — est le terme par lequel on désigne en breton, à cause de leur veste et de leur pourpoint bleu de roi, les paysans de la région cornouaillaise comprise entre Rosporden et Pont-Labbé. Il se présenta le plus décemment du monde, gardant à la main son chapeau de feutre à larges bords, orné d’un ruban de velours noir, un tantinet fripé, dont les bouts pendaient. — Si vous voulez bien, dit-il, nous parlerons français. Je ne fus pas long à m’apercevoir qu’il le savait fort couramment et qu’il s’en servait même, le plus souvent, avec une justesse d’expression que bien des bourgeois lui eussent enviée. — Je viens à vous, parce que j’ai appris que vous frayiez volontiers avec les gens de ma sorte, les pauvres gens. Il y avait une certaine âpreté dans son accent. — Ah !
Early Birthplaces Lieux de naissance en Europe Bienvenue sur les lieux de naissance de la culture industrielle européenne! Nous – c’est à dire cinq musées allemand, anglais, français, polonais et espagnol de l’histoire de l’industrie – vous invitons à une tournée-découverte des origines de la révolution industrielle! Grâce au soutien de la part du programme Culture 2000 de l’Union Européenne, et sous la direction du LVR - Musée de l’Industrie (LVR - Industriemuseum) et des autorités régionales de Rhénanie, nous vous donnons, grâce à notre projet „Early Birthplaces of Europe – Lieux de naissance en Europe“, un aperçu des débuts de l’industrialisation à l’exemple du traitement sidérurgique industriel autour des années 1800. La technique des hauts-fourneaux de cette époque fut marquée à la fois par un transfert international d’énergie et par des particularités régionales. Renseignez-vous sur notre site Internet quant à la technique des hauts fourneaux dans les pays européens autour des années 1800.
Portrait d'un inconnu : le dernier défi d'Alain Corbin L'HISTOIRE : Vous publiez chez Flammarion Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot, où vous ressuscitez la vie et les mœurs d'un inconnu du siècle dernier, un sabotier des environs d'Alençon, né en 1798, mort en 1876. Comment vous est venue l'idée d'écrire l'histoire de quelqu'un qui n'a laissé aucune trace, auquel aucun historien ne s'était jamais intéressé ? ALAIN CORBIN : Je serais plutôt tenté de demander comment on avait pu, jusqu'à présent, ne pas y penser ! L'H. : Et vous, vous avez pense que vous seriez plus proche de la réalité en faisant surgir quelqu'un du néant ? LH. : Mais ce n'est pas lui qui parle, c'est vous. L'H. : C'est une biographie ? L'H. : Alors, à quel genre appartient-il, ce livre ? A. L'H. : A l origine, comment cela s'est-il passé ? A. Ensuite, j'ai consulté les tables décennales d'Origny-le-Butin pour la fin du xvmc siècle, c'est-à-dire le répertoire des naissances. L'H. : A chaque fois, vous aviez des directions de recherche très précises ? A. A. A. A. A.
Singapour, pivot de l'économie maritime mondiale We and our partners use non-sensitive information like cookies or device identifiers for purposes like displaying personalized ads, measuring traffic and preferences of our visitors as well as personalize content. Click on the button to consent to these operations and maintain a tailored experience. You can change your preferences at any time by coming back to this website. We and our partners do the following data processing:Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Storage and access to geolocation information to carry out marketing studies, Store and/or access information on a device
Comment Haussmann a réussi son Paris On sait tous à quoi ressemble un immeuble haussmannien, mais sait-on à quel point le baron Haussmann, délégué par Napoléon III, a totalement chamboulé le paysage de la capitale, avec ses immenses percées, son architecture régulière, ses parcs… ? "A l’époque d’Haussmann c’est le triomphe de la circulation physique, il faut faire circuler l’air, circuler les gens, circuler les capitaux…", affirmait le spécialiste de l’histoire de l’architecture Pierre Pinon sur France Culture, en 1991. Alors que le Pavillon de l'Arsenal, à Paris, inaugure une exposition consacrée au célèbre baron (visible jusqu'au 7 mai 2017), nous vous proposons un voyage dans le temps, à l'époque où les grands travaux haussmanniens redonnèrent du souffle à la capitale. Le Paris étouffant avant la transformation d'Haussmann Écouter 43 min Pierre PINON et Caroline MATHIEU : hommage a Georges Eugene HAUSSMANN Avec Haussmann et Napoléon III, un maître mot : "Circulez !" 19 min Haussmann_Permis de construire du 26 septembre 1991
Écoles, collèges, lycées et EDD - "Le tour du monde de Thalassa" Entre le vendredi 28 septembre et le vendredi 28 décembre 2007, l'unité de programmes Thalassa (France 3) diffusera une série de 13 émissions intitulée " Le tour du monde de Thalassa ". Ce " tour du monde ", qui commence et se termine par le port du Havre, suit la boucle réalisée par les navires porte-conteneurs de la compagnie maritime française CMA-CGM. Dans le cadre des programmes de géographie du secondaire, de nombreux sujets traités dans ces émissions présentent un grand intérêt pédagogique, car s'y croisent les thèmes de la mondialisation, des grandes routes maritimes (par Panama, par les détroits de la Sonde et Suez) de la conteneurisation, de la littoralisation des activités, de l'émergence de nouveaux paysages portuaires, des problématiques du développement durable. Le ministère de l'Éducation nationale et Thalassa ont donc décidé de s'engager dans un partenariat pédagogique. Documents d'accompagnement présentation générale de l'opération (337,81 ko) Fiches pédagogiques
Les premiers chemins de fer Contexte historique Au début du XIXe siècle, la France est encore un pays essentiellement rural où les dépêches sont acheminées à cheval et où les voyages s’effectuent sur des routes cahoteuses, dans l’inconfort des diligences et des malles-poste. La lenteur du rythme des échanges entrave l’essor économique. L’usage de la machine à vapeur provoque cependant une croissance sans précédent de la production industrielle et une véritable révolution dans les transports. Ainsi, bien avant l’apparition de l’automobile, le chemin de fer met fin au règne de la diligence. En France comme en Angleterre, les premières lignes de chemin de fer apparaissent dans les régions minières. C’est à partir de 1850 que les chemins de fer sont construits à un rythme accéléré pour constituer un maillage ferroviaire raccordé à celui des pays voisins. Analyse des images Ces mêmes moyens de transport sont également associés sur la lithographie anonyme qui illustre « les différentes manières de voyager ».
A Liverpool Slave Ship, par William Jackson, avec commentaires. The following items are from the Merseyside Maritime Museum's collections. 'A Liverpool slave ship' by William Jackson Accession number MMM1964.227.2 This unidentified 16-gun ship is typical of the vessels used in the slave trade. She is shown in a port profile against a wooded coastline, intended to represent West Africa. The ship is about to drop anchor and a boat is to be launched. In a section of this painting recent cleaning revealed three small boats with Africans on board approaching from the coast. 'Armed vessel in the Mersey off Birkenhead' by John Jenkinson Although this 14 gun brig is unidentified, she is typical of the large merchant vessels which were involved in slaving from Liverpool. The Dobson Detail from ship bowl, text reads ' Success to The Dobson 1770' The Dobson was a 200-ton ship built in Liverpool in 1770. The Watt Contemporary builder's model of the Watt The Watt, built by Edward Grayson of Liverpool for the firm of Watt & Walker, was launched in February 1797.
Le travail dans les mines François Bonhommé a représenté avec une grande fidélité l’activité sidérurgique et métallurgique dans les grands foyers industriels de la France du milieu du XIXe siècle, entre Abainville et Le Creusot. Il n’a pas éludé la représentation des paysages et du travail liés à l’extraction du charbon qui, dans le cas des bassins de Blanzy et du Creusot, se trouvaient si proches de ceux du fer et si étroitement associés à eux. Si Constantin Meunier a puisé son inspiration dans une région différente – la Belgique du “ sillon Sambre-Meuse ” –, ses sujets peuvent être rapprochés de ceux de Bonhommé, lui aussi attentif aux acteurs et aux gestes du travail, et appartiennent à un même contexte contemporain.Ce contexte, c’est celui d’un âge relativement bref : la France, plutôt mal dotée par son sous-sol, est entrée dans l’âge du charbon d’abord avec les locomotives (à l’approche de 1840), plus tard par la généralisation de la vapeur comme énergie industrielle ou comme moteur de la sidérurgie.
Histoire-géographie-éducation civique-ECJS - Ressources pour la classe de quatrième - ÉduSCOL Ces ressources ont été conçues sous forme de fiches pour aider les enseignants à la mise en œuvre des nouveaux programmes de quatrième du collège. Elles comportent des éclairages scientifiques qui apparaissent nécessaires sur les différents thèmes, notions ou problématiques. Elles proposent aussi des bibliographies et des sitographies simples et commentées, ainsi qu'une lecture croisée des programmes des différentes disciplines en vue de mettre en œuvre des projets pluridisciplinaires, notamment en histoire des arts. Classe de quatrième Histoire Des démarches pour mettre en oeuvre le programme Thème transversal : Les arts témoins de l'histoire aux XVIIIe et XIXe siècles Partie I - L'Europe et le monde au XVIIIe siècle Partie II - La Révolution et l'empire Partie III - Le XIXe siècle Géographie L'étude de cas en géographie Partie I - Des échanges à la dimension du monde Partie II - Les territoires dans la mondialisation Partie III - Questions sur la mondialisation Éducation civique
Le chemin de fer dans le paysage français Contexte historique En France, le Second Empire ouvre à bien des égards l’ère du rail. La révolution que le pays connaît dans les années 1850 et 1860 est due à l’initiative privée et à quelques capitalistes à la tête d’empires financiers, mais aussi à l’État, lequel accorde à ces derniers de nombreuses concessions nouvelles et des baux emphytéotiques (de 99 ans). Autrefois divisé en réseaux minuscules et dispersés, le réseau ferroviaire français est partagé à partir de 1857 entre six grandes compagnies (du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du PLM, du Paris-Orléans et du Midi). Le XIXe siècle français voit donc la généralisation de constructions et d’équipements nouveaux : gares, voies ferrées, ponts, viaducs s’immiscent dans le paysage urbain et rural. Les lignes exploitées, par exemple, atteignent en 1851 une longueur de 3 000 km ; près de vingt ans plus tard, c’est 16 000 km de voies qui sillonnent le territoire français. Analyse des images Interprétation Bibliographie Pour citer cet article