


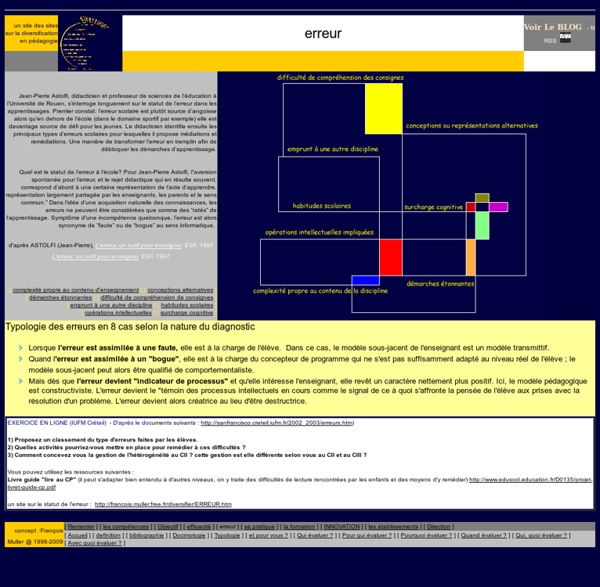
Apprendre, tous. L’effort que nous investissons dans Internet rend accessible plus de connaissances, d’outils et de ressources pour apprendre qu’on aurait pu en rêver il n’y a pas 30 ans. Cette abondance nous amène à réviser nos façons d’enseigner et à s’attarder un peu plus attentivement à celles que nous utilisons pour apprendre. Apprendre à la même vitesse, les mêmes choses pour les mêmes usages et pour les mêmes raisons est un mythe sur le point d’être enterré. L’apprentissage est lié à un contexte et c’est par ce contexte que l’individu détermine le sens de l’apprentissage pour lui. Apprendre est inné; jouer, discuter, s’intéresser, chercher une définition, tracer des tableaux, monter des modèles, écrire, photographier, dessiner, filmer... l’étendue des possibilités n’est limitée par rien d’autre que notre acceptation de limites. Et c’est justement à des moyens de franchir ces limites que nous vous invitons dans cette édition. Illustration : Lasse Kristensen - Shutterstock 22 avril 2013 23 avril 2013
Évaluer différemment les élèves : l’exemple danois Pas de notes avant 15 ans, pas de palmarès des établissements, des examens qui privilégient les projets ou les travaux inédits, l’utilisation généralisé des TIC dans l’évaluation : le Danemark présente une série de caractéristiques susceptible de faire réfléchir sur les relations entre l’apprentissage et les évaluations scolaires. Ce n’est certainement pas un modèle à recopier (les écoles était d’ailleurs ces derniers jours bloquées par un conflit entre les enseignants et les municipalités) mais il a le mérite d’aider à faire bouger les lignes et de considérer différemment des traits de notre système considérés comme naturels voire inhérents à toute situation scolaire. En France, toute réforme des modalités du Bac semble porter atteinte à la civilisation (universelle, cela va de soi), dévaluer les diplômes ou menacer l’équilibre des savoirs. Une école qui n’était pas obsédée par l’évaluation Les résultats restent confidentiels.
METACOGNITION a. Flavell (1976, 1977) : Considéré comme le pionnier dans le domaine de la métacognition, Flavell en propose la définition suivante : la métacognition se rapporte à la connaissance qu´on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui touche, par exemple, les propriétés pertinentes pour l´apprentissage d´informations et de données... b. La métacognition est un domaine qui regroupe : les connaissances introspectives et conscientes qu´un individu particulier a de ses propres états et processus cognitifs ; les capacités que cet individu a de déliberement controler et planifier ses propres processus cognitifs en vue de la realisation d´un but ou d´un objectif déterminé. c. A travers ces définitions, deux aspects différents de la métacognition peuvent etre mis en évidence : - la connaissance de ses propres processus et du produit de ses processus, dont celle des proprétes pertinentes pour l´apprentissage d´informations ou de données ;
Notes et compétences, quelle équation ? C'est une question qui agite la salle des profs, à l'heure de la mise en oeuvre du socle commun. J'émets l'hypothèse de l'incompatibilité. La note sur 20 permet, à travers l'exemple de la dictée, de sanctionner les fautes. On peut rétorquer que dans les multiples évaluations notées, les points sont comptés en positif : on pointe les réussites des élèves par un point, qu'on pourra d'ailleurs décliner jusqu'au quart de point selon le degré d'approximation de la formulation de l'élève. Retirer un demi ou un quart de point sur une question permet de signifier à l'élève que sa réponse n'est pas parfaite, mais qu'elle comprend tout de même un élément de réponse positif. Mais au final il restera encore une soustraction, celle qui sépare le 12 du 20, ces 8 points non acquis. Si l'on se penche sur les moyennes (obtenues par de savants calculs coefficientés), ce "réel" est biaisé. La moyenne d'un élève n'a de valeur que mise en rapport aux autres élèves de la classe.
Les fonctions cognitives de l'enfant et leurs dysfonctionnements - Mon Cerveau à l'école L’INSERM a organisé et mis en ligne en 2013 un séminaire de formation qui explique, pour les parents et les enseignants, le cerveau de l’enfant, ses principales fonctions cognitives, et la manière dont elles peuvent dysfonctionner chez certains enfants “dys”. Destiné aux associations de parents concernées par les troubles de la cognition chez l’enfant, ce séminaire de formation est organisé à l’initiative de la Mission Inserm Associations. Il a été conçu et animé par Michèle Mazeau, médecin en rééducation, spécialisée en neuropsychologie infantile et Pierre Laporte, psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, docteur en psychologie. seminaires-de-formation-ketty-schwartz Le Cerveau, organe d’apprentissage, avec Michèle Mazeau & Pierre Laporte Accéder à la vidéo Le langage oral, avec Michèle Mazeau Accéder à la vidéo Les fonctions du langageLangage et parole lLa “boite à outils” dont disposent les bébésLe mamalais, le babillage….Les troubles du développement du langage
La question, outil de l’enseignant Ou l’art de poser des questions pour former et évaluer… « Je t’en pose, moi, des questions ? » Combien de fois cela vous est-il arrivé de recevoir « à la figure » cette réplique toute faite, signe d’une indiscrétion ou curiosité potentielle envers votre interlocuteur ? La question peut donc agacer. Elle peut aussi montrer un signe d’intérêt. Faisons un petit tour d’horizon de la question pédagogique ! La question peut en effet être considérée comme l’outil de base de l’interaction pédagogique. D’une séance sur l’autre, il est aisé de mettre en ligne un quiz de 5 questions sur les points clés à connaitre lorsque l’on demande de « réviser tel chapitre ! Les résultats obtenus permettent de constituer 3 groupes lors du cours suivant : o Les non répondants (quiz non réalisé volontairement ou involontairement) o Les répondants avec erreurs (apprentissage partiel) o Les répondants avec maitrise (niveau atteint) Les étudiants qui ont réussi vont assister ceux qui ont fait des erreurs.
Test QI gratuit - Test psychotechnique - Tests de QI gratuits La suppression partielle des notes réduirait les inégalités entre élèves La suppression partielle des notes peut-elle permettre à l’ascenseur social de redémarrer ? Dans une France si attachée à la note sur 20, une telle conclusion apporterait une pierre dans le vif débat qui oppose défenseurs et détracteurs du système classique d’évaluation des élèves. Or, c’est précisément ce que montre une étude du CNRS qui vient d’être divulguée. Noyés dans l’actualité liée à la mobilisation des jeunes contre le projet de loi travail, ses résultats sont passés relativement inaperçus. L’expérimentation a été conduite en 2014-2015 dans 70 collèges et lycées de l’académie d’Orléans-Tours, dans des classes allant de la 6e à la 2de. Les consignes données aux établissements étaient claires : pas de notes en classe. Tous les élèves ont progressé Rien de révolutionnaire. L’étude du CNRS tend à avaliser cette tendance. « Ce n’est pas rien ! En revanche, aucun de ces effets n’a été observé en français et en histoire-géographie. « Moins d’appréhension » Aurélie Collas
Êtes-vous plutôt cerveau droit ou cerveau gauche ? Faites le test ! Selon le mode de fonctionnement de votre cerveau, la danseuse tourne soit dans le sens horaire soit dans le sens antihoraire. Si elle se tourne vers la droite, vous utilisez principalement le côté droit de votre cerveau et vous êtes très certainement droitier. Conflit :Le côté droit du cerveau veut choisir la couleur qui correspond au mot, tandis que le gauche veut choisir le mot écrit. Lorsque vous faites une erreur, c'est le côté gauche de votre cerveau qui s'exprime. Réponse A : Si vous avez choisi cette image, le côté gauche de votre cerveau est dominant. Réponse B : Cette forme est un compromis entre la première image simple et l'image plus compliquée de la réponse C. Réponse C : Si vous avez choisi cette image, c'est le côté droit de votre cerveau qui est dominant. Ici, les figures sont également de la même taille. Les figures sont de la même taille et quasiment de la même couleur. Ici, l'image originale a été décomposé en fragments.
Actualités pédagogiques - L'évaluation bienveillante au service des apprentissages des élèves Séminaire d'automne de l'académie de Reims - Vendredi 14 ocrobre 2016 Les documents proposés ci-dessous ont pour objet de faire partager les éléments présentés par Christophe Marsollier, Inspecteur Général de l'Éducation nationale Établissement et Vie scolaire, Docteur en sciences de l'éducation et Olivier Rey, Ingénieur chercheur Veille & Analyses à l'Institut français de l'éducation. Le programme du séminaire d'Automne Le support de la conférence de Christophe Marsollier : Les enjeux de la qualité de la relation pédagogique dans l'évaluation des travaux individuels et collectifs des élèves Le défi de l'évaluation des compétences par Olivier Rey Évaluer pour (mieux) faire apprendre par Olivier Rey sur ife.ens-lyon.fr Sitographie : La conférence nationale sur l'évaluation des élèves sur education.gouv.fr La revue numérique des professionnels de l'éducation sur cap-education.fr