


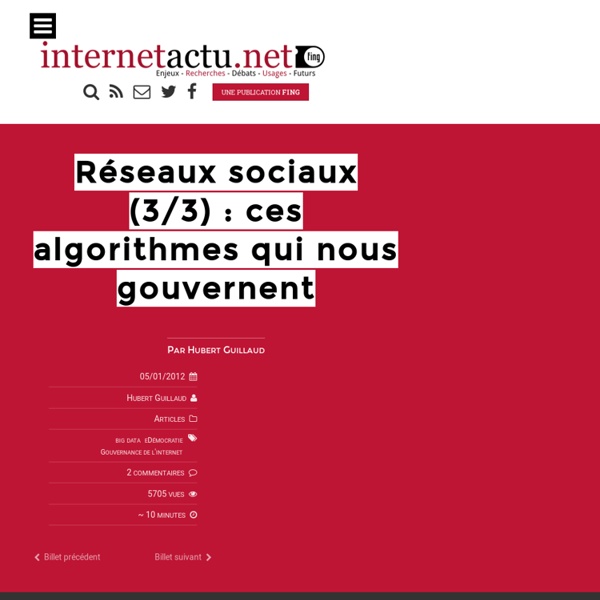
Réseaux sociaux (2/3) : des outils pour zoomer et dézoomer Par Hubert Guillaud le 04/01/12 | 4 commentaires | 3,022 lectures | Impression Les 12 et 13 décembre 2011 se tenait à Lyon un colloque universitaire sur les réseaux sociaux organisé par l’Institut rhône-alpin des systèmes complexes. Retour sur quelques-unes des présentations. Des outils pour mesurer le réel Pour Alain Barrat, chercheur au Centre de physique théorique de Marseille, les réseaux sociaux en ligne constituent un laboratoire très intéressant qui nous procure de nouvelles données pour faire des études à grande échelle, mais permettent également l’étude de l’évolution temporelle des réseaux (ce qui est plus difficile dans le réel). Après avoir évoqué l’influence de la proximité et de l’homophilie dans les réseaux sociaux de lecteurs, Alain Barrat a évoqué un autre exemple d’étude des relations en face à face développée par le réseau de recherche SocioPatterns. Dynamical Contact Patterns in a Primary School. from SocioPatterns on Vimeo. Hubert Guillaud
Réseaux sociaux (1/3) : diviser le monde pour le comprendre Par Hubert Guillaud le 03/01/12 | 9 commentaires | 4,874 lectures | Impression Les 12 et 13 décembre 2011 se tenait à Lyon un colloque universitaire sur les réseaux sociaux organisé par l’Institut rhône-alpin des systèmes complexes. Comme le soulignait Pablo Jensen en introduction, le sujet est plus qu’à la mode. Structurer pour organiser Vincent Blondel de l’université catholique de Louvain, responsable du laboratoire Large Graphs and Networks est un des spécialistes de l’analyse des très grands réseaux. Vincent Blondel a mis au point l’une des nombreuses méthodes d’identification de communautés qui existent (voir l’analyse de Santo Fortunato sur la détection de communauté dans les graphes (.pdf) qui recense et évalue les méthodes existantes), la méthode de Louvain, qui a été implantée depuis dans de nombreux logiciels comme Gephi, NetworkX, et est utilisée par de nombreuses sociétés comme Linked-in. Image : Les bassins téléphoniques en France métropolitaine. Mesurer la cohésion
Les médias sociaux décodés en une page Une infographie de Flowtown qui présente rapidement les plus grands médias sociaux. Flowtown vient de créer cet aide-mémoire qui résume les caractéristiques essentielles des plus importants médias sociaux occidentaux. Vous y trouverez les avantages et les inconvénients de chaque site, ainsi que la façon de vous inscrire et créer votre profile. Pour lire en grand format : Flowtown Pour recevoir gratuitement par courriel les articles aussitôt publiés, cliquez sur le lien suivant et suivez les instructions Abonnement à "173 Sud" par courriel
Panorama des médias sociaux 2012 (The english version of this article is here: Social Media Landscape 2012) Il y a quelques années une analyste disait que dans cinq ans, les médias sociaux seront comme l’air (omniprésents). Nous sommes en 2012 et les médias sociaux n’ont jamais occupé une place aussi importante sur le web, à tel point que l’on en vient à se demander dans quelle mesure il est encore pertinent de dissocier les médias sociaux et le web. Pourtant, si l’on s’en tient à la définition que j’ai donnée (“Les médias sociaux désignent un ensemble de services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur internet ou en situation de mobilité”), il existe bien une différence entre un site web classique et les médias sociaux, surtout si l’on étudie de plus près les différents types de médias sociaux. Un écosystème toujours aussi dense Nous retrouvons ainsi au centre de ce schéma trois acteurs qui proposent une large palette de fonctionnalités (Facebook, Twitter et Google+).
Online commenting: the age of rage | Technology | The Observer For a while after his first TV series was broadcast in 2009, comedian Stewart Lee was in the habit of collecting and filing some of the comments that people made about him on web pages and social media sites. He did a 10-minute Google trawl most days for about six months and the resultant collected observations soon ran to dozens of pages. If you read those comments now as a cumulative narrative, you begin to fear for Stewart Lee. This is a small, representative selection: "I hate Stewart Lee with a passion. Lee, a standup comedian who does not shy away from the more grotesque aspects of human behaviour, or always resist dishing out some bile of his own, does not think of himself as naive. Distanced or not, Lee couldn't help but be somewhat unsettled by the rage he seemed to provoke by telling stories and jokes: "When I first realised the extent of this stuff I was shocked," he says. The "40,000 words of hate" have now become "anthropologically amusing" to him, he insists.
Google+: The Complete Guide Using Google+? Add Mashable to your circles. You'll get the latest about new Google+ features and tips and tricks for using the platform as well as top social media and technology news. Guide updated January 18, 2012 Google+: It's the hot social network on the block. Google+, however, isn't the easiest thing to understand. A recent change new and old Google+ users should take note of is Search Across Your World launched on Jan. 10, 2012. Now Google can pull search results from your Google+ friends and material from other Google+ users whom you don't follow who have related content labeled public. We will continuously update this guide as new initiatives such as the Search Across Your World are started, further integrating Google+ into the Google ecosystem. We decided to dig into every aspect of Google+, from Hangouts to Circles, from Google+ Pages to what's next for Google's social network. So, without further ado, here is Mashable's complete guide to Google+: What Is Google+? Profile Photos
Les nouveaux médias sociaux ne sont peut-être pas si nouveaux que ça La lecture de la semaine, il s’agit d’un post du blog que Cynthia Haven, critique littéraire, tient sur le site de l’université de Stanford, en Californie. Le titre du post : “Les nouveaux médias sociaux ne sont peut-être pas si nouveaux que ça”. “Si vous vous sentez submergés par les médias sociaux”, commence Cynthia Haven, “sachez que vous n’êtes pas les premiers dans l’Histoire. Une avalanche de nouvelles formes de communication s’est abattue aussi sur les Européens des 17e et 18e siècles. “Le 17e siècle a vu la conversation exploser”, explique Anaïs Saint-Jude, directrice du programme BiblioTech de Stanford, “c’était la version moderne de la surcharge d’information”. Et le service public des postes a été pour nos ancêtres l’équivalent de ce que sont pour nous Facebook, Twitter, Google + et les smartphones. Image : La cartographie des la République des Lettres qui permet de suivre la correspondance des grands penseurs du siècle des Lumières. Que ces gens se racontaient-ils ?
danah boyd : pourquoi avons-nous peur des médias sociaux A l’occasion de la conférence SXSW qui se tenait mi-mars à Austin, Texas, la sociologue de Microsoft, danah boyd, a donné une très intéressante conférence sur « le pouvoir de la peur chez les publics en réseaux » dont elle a publié le transcript sur son site. Son intérêt pour cette question, comme elle l’explique, vient du fait qu’elle travaille particulièrement sur les cultures adolescentes et les rapports des jeunes aux nouvelles technologies (voir les nombreux articles que nous avons consacré aux travaux de cette chercheuse). Dans ce cadre, elle observe notamment l’intimidation en ligne et est souvent confrontée aux problèmes que les jeunes rencontrent via les réseaux sociaux. L’occasion de revenir avec elle sur comment les médias en réseaux favorisent nos angoisses et comment pouvons-nous les combattre. Pour danah boyd, si l’on suit une suite de causes à effets, les choses sont assez simples. Image : l’annonce de l’intervention de danah boyd sur le site de SXSW.
Les données de la servitude volontaire. Titre alternatif de ce billet : "286 téra-octets de gazouillis, et moi et moi et moi." La chose était déjà possible aux états-unis depuis quelques mois. Elle l'est désormais en France et dans quelques autres pays européens. Twitter vient d'annoncer la possibilité de récupérer l'archive de tous ses tweets. (NOTA BENE : les chiffres présentés ci-après n'ont vraiment qu'une valeur très "pifométrique" étant donné que l'on sait que Twitter dispose de plus de 500 millions de comptes mais que nul - y compris par ici - n'est en mesure d'indiquer combien sont publics et combien sont privés - ou alors j'ai pas trouvé l'info ... - , combien sont réellement actifs et combien sont des spambots, etc. Or donc la récupération rapide de mon archive Twitter me donne ceci. Un fichier index.html qui permet de "naviguer" dans l'archive de tous ses tweets classés par mois et par année, et d'y farfouiller pour y retrouver ... ce qu'on y cherche, et un fichier de données brutes "tweets.csv" de 2,3 Mo. A rien.