


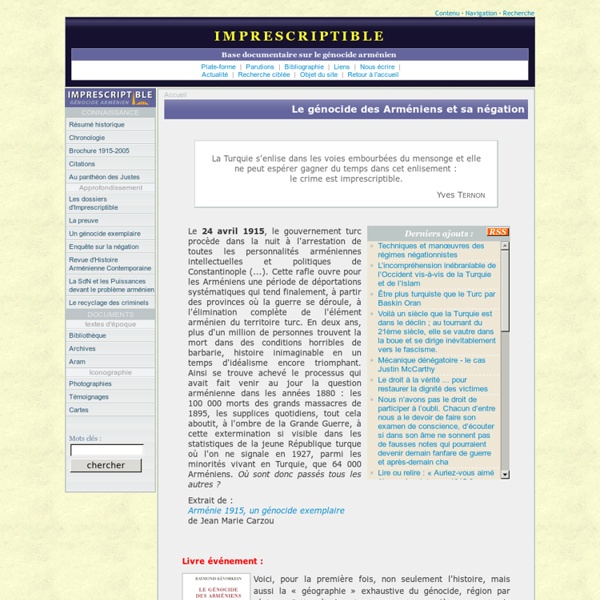
Un exemple de la violence de masse : le génocide arménien L’activité proposée consiste à confronter des extraits d’un film avec des documents d’époque. Les élèves complètent un questionnaire puis sont amenés à renseigner un schéma qui servira de trace écrite. Il est intéressant de montrer que la notion de génocide a été employée de façon rétrospective puisque le terme n’existait pas à l’époque. Il s’agit de faire réfléchir les élèves sur la nature génocidaire de ces terribles événements à partir de la définition de génocide. Dans le Mas des alouettes, Paolo et Vittorio Taviani évoquent le génocide arménien de 1915 à travers la saga d’une riche famille arménienne partagée entre ceux qui vivent encore sur la terre natale et vont éprouver dans leur chair toute l’horreur de la tragédie et ceux qui ont émigré en Italie et cherchent dans l’angoisse à envoyer subsides et secours aux leurs. base documentaire sur le génocide arménien dossier réalisé par Arte autour du génocide arménien
Journée de commémoration du génocide arménien Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La journée de commémoration du génocide arménien (en arménien : Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր) est un jour férié en Arménie et dans le Haut-Karabagh ayant lieu chaque 24 avril. Il est également l'occasion de commémorations par la diaspora arménienne à travers le monde[1],[2]. À Erevan, un défilé conduit traditionnellement des centaines de milliers de personnes jusqu'à Tsitsernakaberd. Le 24 avril est la date de la rafle des intellectuels arméniens en 1915 à Constantinople. Histoire[modifier | modifier le code] La date a d'abord été choisie par les Arméniens du Liban pour commémorer le génocide arménien en 1965, à l'occasion de son 50e anniversaire [3]. Le , la Chambre des représentants des États-Unis adopte la résolution no 148 adoptant la date du 24 avril, comme la « journée nationale de commémoration de l'inhumanité de l'Homme contre l'Homme ». La journée du 24 avril est également l'occasion de la commémoration du génocide assyrien.
262. R.Wan: "Le papier d'Arménie" (2012) Le dernier album de R.Wan réserve de belles surprises, au premier rang desquelles figure le troublant « papier d’Arménie », évocation sensible du génocide arménien. L'impeccable orchestration plonge l'auditeur dans une atmosphère ouateuse et onirique; quant au texte, il insiste sur la fragilité de la mémoire. L'éloignement dans le temps rend d'autant plus ténu les souvenirs d'un drame que les autorités turques s'emploient à nier ("une fumée de martyrs que l'armée nie en bloc"). En quoi les massacres de 1915 se distinguent-ils des pogroms précédents? Entre mer Noire et mer Caspienne, Caucase et Mésopotamie, situé au carrefour des grands Empires perse, romain, byzantin, puis arabe, mongol, ottoman et russe, le royaume chrétien d'Arménie est âprement disputé depuis sa fondation au VIème siècle avant JC. Le mouvement des Jeunes-Turcs s'empare du pouvoir en 1908. En février 1914, sous la pression des puissances occidentales, les autorités ottomanes signent la « réforme de l’Arménie ». 2.
Les racines du génocide arménien De 1915 à 1916, plus de la moitié des 1,5 à 2 millions d’Arméniens ottomans d’Asie mineure sont morts, victimes d’une politique dirigée contre eux. De 1913 à 1918, un gouvernement dictatorial jeune-turc est à la tête de l’empire ottoman, qui, au cours de la première guerre mondiale, tient à préserver et à agrandir ce grand empire chancelant. En parallèle, ce gouvernement mène une politique démographique et économique nationale et social-révolutionnaire, qui, en accord avec la nouvelle idéologie du « turquisme », a pour but de créer en Asie mineure un foyer national sûr et une souveraineté illimitée pour les Turcs. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la seconde guerre mondiale et le conditionnement stratégique de la guerre froide, qui a également eu ses effets sur la science universitaire, ont fait passer au second rang les violences de masse de la première guerre mondiale. La « question orientale » Premiers grands massacres Aux côtés de l’Allemagne Ceux qui ont refusé les ordres
Aghet | Aghet, 1915 le génocide arménien Le génocide arménien avait débuté un 24 avril, son 95e anniversaire a été commémoré en 2010. Pour les historiens, ce fut la première extermination méthodique d’un peuple au XXe siècle. Ce massacre n’a pas attendu le roman de Franz Werfel, Les quarante jours du Musa Dagh (1933) pour se graver dans la conscience historique occidentale. Mais sa dimension, tant par la durée que le nombre des victimes, est largement méconnue d'un bon nombre d'Européens. Et elle est passée sous silence, notamment par un grand nombre de responsables politiques turcs. Diffusion :MERCREDI 20 AVRIL 2011 À 20H35etMARDI 26 AVRIL 2011 À 3H05. Avant de commencer un film, tout réalisateur se demande quelle histoire il veut raconter et si elle en vaut la peine. Faire découvrir l'Histoire à un large public Depuis longtemps déjà, il aurait fallu parler en ces termes du génocide arménien, l'un des crimes qui a fait le plus de victimes au XXe siècle. Un sujet fort, un documentaire qui l’est aussi Par Thomas Schreiber
Guerre arméno-turque Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Contexte[modifier | modifier le code] Déroulement[modifier | modifier le code] L'assaut est donné sur l'ordre de Mustafa Kemal le 23 septembre 1920. Après une bataille à Kars, la ville passe aux mains des Turcs le 30 octobre[2]. Les armées kémalistes font signer un armistice à Ohadjanian mais les Arméniens ripostent une dernière fois et tentent vainement une contre-attaque. Réactions internationales et traité d'Alexandropol[modifier | modifier le code] Les pointillés représentent les frontières établies par le traité de Kars en 1921. En cette fin d'année 1920, l'Arménie, encore indépendante, mais proche des Russes, connaît une période difficile et le traité de Sèvres semble bien loin. Finalement, le 2 décembre 1920, après des négociations entre l'Arménie et la Turquie, le traité d'Alexandropol est signé et un accord entre Arméniens et Soviétiques définit l'Arménie comme une « république socialiste soviétique ».
Le grand mal, Medz Yeghern, une BD sur le génocide arménien Ceux qui pensent que la BD est un art mineur, réservée essentiellement aux enfants, je vous invite à lire ce livre, de Paolo Cossi. En effet, pour ce type de support, le génocide arménien. Bien sûr, le dossier spécial de d'avril dernier, la pétition sur Internet émanant de Turcs demandant pardon au peuple arménien, les travaux d'historiens turcs décrivant ce génocide (Fuat Dündar, Taner Akçam) semblent contribuer à faire sortir progressivement de l'oubli ce génocide encore méconnu du grand public. Il n'en demeure pas moins que le sujet reste encore très sensible pour les autorités turques (plus particulièrement ches les nationalistes). Surtout quand l'Assemblée nationale de la France a reconnu officiellement le génocide arménien par une loi dite mémorielle (octobre 2006). la réalité de cet "épisode" de la 1ère GM. L'histoire raconte comment une jeune arménien du nom d'Aram, soldat de l'armée turque est éloigné du front pour être exécuté avec d'autres jeunes arméniens. JC Diedrich
Génocide grec pontique L’expression génocide grec pontique[2],[3],[4], bien que controversée, reste celle utilisée pour définir l’histoire des Grecs pontiques pendant et après la Première Guerre mondiale. Le fait qu’il y ait eu ou non génocide fait encore débat entre la Turquie et la Grèce ; l'ONU n'a pas tranché. On fait aussi allusion à la Tragédie pontique[5], l’Extermination pontique[6] et aux Atrocités commises par les Turcs dans le Pont et l’Asie Mineure[7]. Ces termes se réfèrent aux persécutions, aux massacres, aux expulsions ainsi qu’aux migrations forcées infligées par le gouvernement jeune-turc aux Grecs pontiques au début du XXe siècle ; ces massacres, suivant ceux des Arméniens et des Assyriens, répondent à la définition de génocide proposée par un juriste français durant le procès de Nuremberg[8],[9],[10]. Le gouvernement turc rejette le terme de génocide. Contexte[modifier | modifier le code] Article publié par le journal The Scotsman le 25 juillet 1915. Conséquences[modifier | modifier le code]