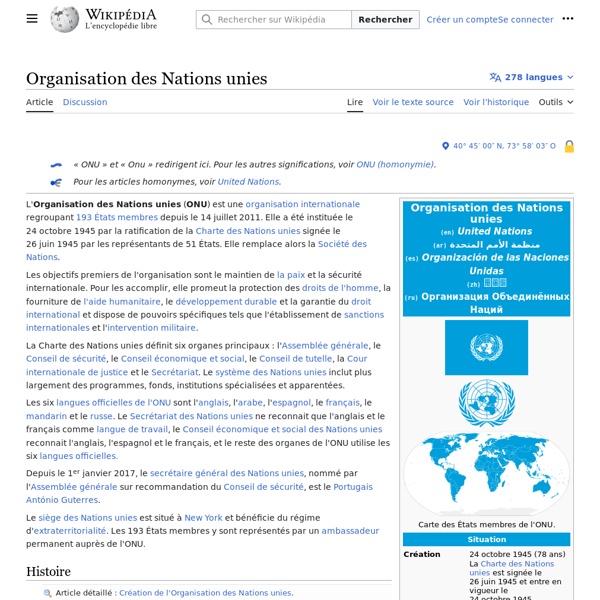Société des Nations
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir SDN. Les objectifs de la SdN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l’amélioration globale de la qualité de vie. Le principal promoteur de la SdN fut le président des États-Unis Woodrow Wilson. Après de nombreux succès notables et quelques échecs particuliers dans les années 1920, la Société des Nations fut totalement incapable de prévenir les agressions successives des pays de l’Axe dans les années 1930. La SdN est considérée comme un échec en ne parvenant pas à enrayer la guerre civile espagnole et la montée en puissance du nazisme à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Survol historiographique[modifier | modifier le code] La Grande Guerre[modifier | modifier le code] La Société des Nations est étroitement liée au contexte de sa création. Dans son article Guerre et Droit.
Cour européenne des droits de l'homme
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, CrEDH ou CourEDH)[n 1] est une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe ayant pour mission d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles additionnels[n 2]. La Cour peut être saisie d’une requête par un État ou « par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime d'une violation » de ses droits ou libertés, garantis par la Convention[n 3]. La Cour européenne des droits de l'homme fonctionne en permanence et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg (France) dans un bâtiment conçu par l'architecte italo-britannique Richard Rogers. La Convention garantit notamment : Elle interdit notamment : 26 juillet 2005, Siliadin c.
Convention européenne des droits de l'homme
Convention européenne des droits de l'homme Pays ayant ratifié la Convention Lire en ligne Texte sur Wikisource La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, ou ConvEDH afin de ne pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui en contrôle l'application et qui possède le même sigle), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe[1] le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. La Convention comprend cinq sections principales. Article 6 - Droit à un procès équitable
Organisation internationale du travail
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir OIT. En 2012, l'Organisation regroupe 183 États membres. Son siège est situé à Genève, en Suisse, et son directeur général est le Britannique Guy Ryder depuis le . L'organisation est distinguée en 1969 par l'attribution du prix Nobel de la paix . Histoire[modifier | modifier le code] En 1919, les États signataires du traité de Versailles créent l'Organisation internationale du travail (OIT). La nouvelle organisation s'installe au Centre William Rappard, à Genève en 1926. Le 10 mai 1944, La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à Philadelphie, adopte la déclaration de Philadelphie. Dotée d'une structure tripartite unique, elle réunit sur un pied d'égalité les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour débattre des questions relatives au travail et à la politique sociale. Observatoire et publications[modifier | modifier le code]
Organisation mondiale du commerce
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Depuis 2001, le cycle de négociation mené par l'OMC est le Cycle de Doha[3]. Bien que l'OMC ne soit pas une agence spécialisée de l'ONU, elle entretient des liens avec cette dernière[4]. Histoire[modifier | modifier le code] L'OMC est née le 1er janvier 1995[5], mais le système commercial qu'elle représente a presque un demi-siècle de plus. Le sommet de Cancún de 2003 a été marqué par une alliance entre certains pays du tiers-monde contre les projets de libéralisation des services qui étaient sur la table des négociations. Champ d'application[modifier | modifier le code] Il existe des accords dit « plurilatéraux » dans des domaines plus spécifiques et qui ne concernent qu'un nombre limité de pays. Fonctionnement et organisation[modifier | modifier le code] L’OMC est avant tout un cadre de négociation, un lieu où les gouvernements membres se rendent pour essayer de résoudre les problèmes commerciaux qui existent entre eux.
Cour permanente de justice internationale
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La Cour permanente de justice internationale (CPJI) est créée en 1922 à la suite de la Première Guerre mondiale, tout comme la Société des Nations à laquelle elle était affiliée. C'est la deuxième instance de recours international existante, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye ayant été créée en 1899. Elle est remplacée en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, par la Cour internationale de justice (CIJ), un organe de l'ONU[1]. Mission et fonctionnement de la Cour permanente de justice internationale[modifier | modifier le code] La création d'une juridiction internationale était prévue par l'article 415 du traité de Versailles et par l'article 14 du pacte de la Société des Nations qui chargeait le Conseil de la SDN « de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Personnel[modifier | modifier le code] Bilan[modifier | modifier le code]