


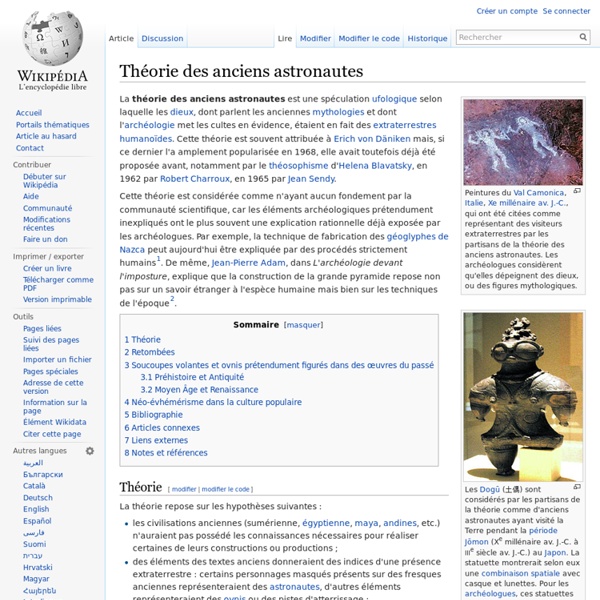
Vidéo : Les anciens astronautes Les anciens astronautes - Vu 42489 fois. Ce documentaire, produit par le très prestigieux groupe « National Geographic » aborde à première vue un thème bien éloigné des préoccupations de ses médias : l'hypothèse d'une « influence extérieure » lors de l'essor de civilisations anciennes. Cette théorie, impliquant des extraterrestres ayant le rôle de tuteurs qui auraient enseigné une partie de leur savoir aux premiers hommes, a été popularisée notamment par l'auteur Erich Von Däniken dans son roman « chariots of the gods ». Cette nouvelle conception de notre Histoire a fait de nombreux adeptes car elle met en avant les incohérences entre certains vestiges historiques et les époques durant lesquelles ils ont été conçus. Certains de ces indices d'une aide extraterrestre sont mondialement connus, comme Stonehenge en Angleterre, les pyramides de Gizeh en Égypte, les lignes de Nazca au Pérou. La théorie « des anciens astronautes » a également de nombreux détracteurs. Complément : Nazca
Habitabilité d'une planète Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Déterminer l'habitabilité d'une planète correspond en partie à extrapoler les conditions terrestres, car c'est la seule planète sur laquelle l'existence de la vie est connue. L'habitabilité d'une planète est la mesure de la capacité d'un corps astronomique à développer et accueillir la vie. Cette notion peut donc être notamment utilisée à la fois pour les planètes et leurs satellites naturels. D'après les connaissances acquises par l'étude de la biologie terrestre, les éléments nécessaires au maintien de la vie sont une source d'énergie couplée à de la matière mobilisable, sachant que différents modèles sont proposés à l'appui de l'origine de la vie. Cependant, la notion d'habitabilité comme « possibilité d'accueillir la vie » est intrinsèquement limitée par la comparaison aux conditions biologiques terrestres, ce qui implique que plusieurs autres critères d'ordre géophysique, géochimique et astrophysique soient respectés.
How Incomprehensible Could Extraterrestrials Be? A few days ago Paul Gilster, the author of Centauri Dreams: Imagining and Planning Interstellar Exploration and the curator of Centauri Dreams , posted a thoughtful discussion of a blog entry I wrote (titled What's The Connection Between Deafness and SETI? ) His discussion and the resulting comments were fascinating, and in this post I want to carry on that conversation. I think the answer is no. In one of the comments, Christopher Phoenix argued that aliens could be so different from us as to be incomprehensible. "How can we expect to use extraterrestrials as a mirror for human behavior? Excellent point. Okay. Still, it’s fair to ask if an alien species might be so different from us that even our science wouldn’t be able to get a grip on it. I don’t think biology in itself would create that kind of radical incomprehensibility. Technology presents us with a more difficult problem. What this means is, you can’t understand a society without understanding its technology. Well, so what?
Chariots of the Gods Sci Fi USA développe une mini série de 6 épisodes sur le best-seller de Erich von Daniken : Chariots of the Gods. Ce roman avait pour thème une théorie selon laquelle la Terre a été visitée par des extra terrestres depuis des millénaires. L’histoire serait un mix entre le Da Vinci Code et Les aventuriers de l’Arche Perdue. Source Movieweb Les séries TV sont Copyright © leurs ayants droits Tous droits réservés. Vie extraterrestre La vie extraterrestre (extra, au sens du latin « au-dehors, à l'extérieur ») désigne toute forme de vie présente ailleurs que sur la planète Terre. Un raisonnement statistique basé sur des constats comme l'abondance des étoiles dans l'univers (400 milliards dans la seule Voie Lactée), l'ancienneté de notre galaxie (plus de 10 milliards d'années), le rythme fulgurant des progrès techniques sur Terre au cours des deux derniers siècles et des hypothèses telles que le principe de non anthropocentrisme (le système solaire a une configuration "banale", l'apparition de la vie puis de la vie intelligente résultent de processus fréquemment rencontrés) débouche sur la conclusion que la vie intelligente dans l'univers devrait être répandue, ancienne et donc visible. Or à ce jour aucun élément observationnel de vie extraterrestre n'a été identifié par la communauté scientifique. La vie extra-terrestre : une hypothèse envisagée dès l'Antiquité[modifier | modifier le code] . . . Richard B. où : avec :
Équation de Drake L'équation de Drake, ou formule de Drake[a], est une proposition mathématique qui estime le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer en contact. Le principal objet de cette équation pour les scientifiques est de déterminer ses facteurs, afin de connaître le nombre probable de ces civilisations. Cette formule a été suggérée par l'astronome américain Frank Drake en 1961 et concerne les sciences telles que l'exobiologie, la futurobiologie, l'astrosociologie, ainsi que le projet SETI. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'estimation de la plupart des paramètres de la formule reste très incertaine, si bien qu'en fonction des choix adoptés, le résultat peut être bien inférieur à un (auquel cas nous serions probablement les seuls êtres technologiquement avancés dans la Galaxie), ou au contraire atteindre plusieurs centaines ou milliers voire davantage. où : Si , nous ne sommes probablement pas seuls. En 1964, Stephen H. avec :
Le paradoxe de Fermi Accueil » Les planètes et la vie » Le paradoxe de Fermi Le manque de succès de la recherche de signaux extraterrestres intelligents nous amène à un paradoxe, déjà posé par le physicien Enrico Fermi en 1950, lorsqu’il s’interrogeait sur l’absence de visiteurs extraterrestres sur notre planète. Le paradoxe de Fermi Il est évidemment difficile d’imaginer à quoi ressemblerait une civilisation extraterrestre. Un fait qui semble néanmoins s’imposer est qu’une telle civilisation finirait inévitablement par chercher à se répandre au-delà de sa planète d’origine. On peut citer au moins trois raisons pour lesquelles cet objectif semble naturel : l’exploration, la colonisation et la survie. L’exploration serait un premier pas, une mission vers d’autres étoiles, motivée soit par la curiosité intellectuelle, soit par des raisons de prestige. Quelques réponses au paradoxe de Fermi La solution la plus simple au paradoxe de Fermi consiste à dire que nous n’avons rien vu parce qu’il n’y a rien à voir.
Exobiologie Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Rover martien de la NASA L’exobiologie (aussi appelée astrobiologie par les Anglo-Saxons) est une science interdisciplinaire qui a pour objet l'étude des facteurs et processus, notamment géochimiques et biochimiques, pouvant mener à l'apparition de la vie, d'une manière générale, et à son évolution[1]. Ceci s’applique aussi bien à l'émergence de la vie sur Terre, il y a 3 à 4 milliards d'années, qu'à la possibilité de vie ailleurs dans le Système solaire, voire sur d'éventuelles planètes extrasolaires ou autre. Elle s'attache à rechercher d'éventuels processus présidant à l’évolution de la matière organique simple (biomolécules : chaînes peptidiques, nucléiques ou lipidiques) vers des structures plus complexes (premières cellules, premiers systèmes génétiques, etc.) autant que d'éventuelles traces ou possibilité de vie sur d'autres astres connaissant des environnements radicalement différents du nôtre. Sur Terre[modifier | modifier le code]
Hypothèse de la Terre rare Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les planètes pouvant abriter la vie comme la Terre sont-elles rares ? En astronomie planétaire et en astrobiologie, l'hypothèse de la Terre rare soutient que l'émergence d'une vie multicellulaire complexe (metazoa) sur Terre a exigé une combinaison improbable d'évènements et de circonstances astrophysiques et géologiques. Le terme Terre rare provient de Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe (2000), un livre écrit par le géologue et paléontologiste Peter Ward, et l'astronome et astrobiologiste Donald E. L'hypothèse de la Terre rare s'oppose au principe de médiocrité (appelé aussi principe copernicien) soutenu par Carl Sagan et Frank Drake, entre autres[1]. L'hypothèse de la Terre rare, en concluant que la vie complexe n'est pas commune, est une solution possible du paradoxe de Fermi : « Si les extra-terrestres sont courants, pourquoi ne les voit-on pas ? Les zones galactiques habitables[modifier | modifier le code]