


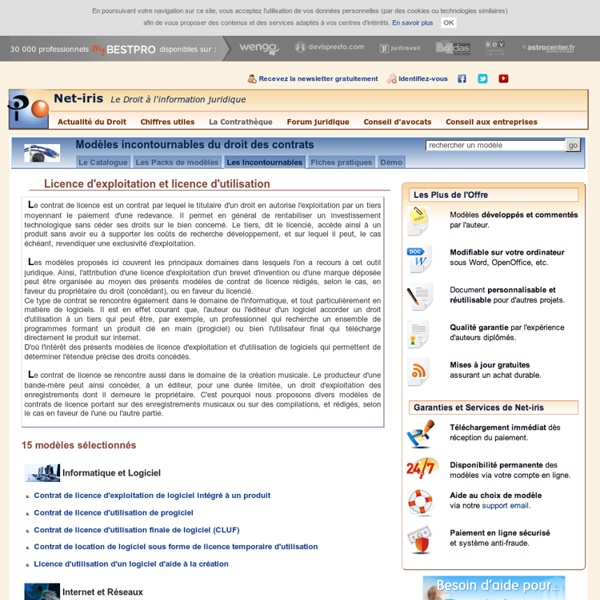
Logiciels libres et propriétaires | Halpanet Il existe deux sortes de logiciels : les logiciels libres et les logiciels propriétaires. Pour comprendre ce qu'est un logiciel libre, nous allons déjà voir ce que la plupart des gens utilisent en général : les logiciels propriétaires. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un logiciel ? Un logiciel est un programme qui exécute une tâche. Pour bien comprendre, comparons avec une recette de cuisine : Le code source est comme une recette. Les logiciels propriétaires Un logiciel propriétaire est écrit, la plupart du temps, par une entreprise. On peut donc simplement dire que ces entreprises ont tous les pouvoirs sur ses utilisateurs qui eux, sont impuissants. source au format SVG Je vous imagine déjà penser : "De toutes façons je ne sais pas programmer, je n'y connais rien", alors comparons avec une voiture. Les logiciels libres Un logiciel libre se définit par 4 libertés (rédigées par FSF) : Plusieurs licences protègent ces 4 libertés dont la plus connue est la licence GPL. source au format SVG
Qu'est-ce qu'une licence logicielle ? Dans la quasi-totalité des cas, on achète, non pas un logiciel, mais un droit limité d'utilisation de ce logiciel : limité à la société acheteuse (donc non cessible en cas de vente d'actifs d'une société à une autre)limité à une seule machine, dans le cas des licences OEM (logiciel vendu avec la machine). Définition du droit de licence Chaque licence constitue un contrat de droit commercial dans lequel l'éditeur intègre ses conditions. L'acheteur est censé les accepter dès lors qu'il installe le logiciel. Chez un même éditeur les formes de licences sont nombreuses et évoluent rapidement dans le temps. Il est donc primordial de simplifier la situation en définissant des règles communes d'achat de licences pour l'ensemble de l'entreprise et de signer des contrats d'achat cadre avec les fournisseurs. Matérialisation du droit de licence : Création d'une base de données des licences. Licences OEM : Ajoutons qu'il est difficile d'acheter un PC sans sa licence Windows OEM. Licences de groupes
Logiciels libres et open source (Culture libre) Vous avez sûrement déjà entendu parler de logiciels libres et d'open source. Mais qu'est ce que c'est en fait ? Et quelles sont les différences entre les deux ? Cette publication est avant tout destinée aux profanes, mais aussi aux utilisateurs dépendants du titanèsque GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui vendent les données confidentielles des utilisateurs. Pour Framasoft, association qui promeut la culture libre, il s'agirait de "dégoogliser" Internet (voir plus bas) et de rendre libre le partage de savoirs et connaissances, mais surtout de nous donner une indépendance. _Le logiciel libre (free software) Quand on dit qu’un logiciel est « libre », on entend par là qu’il respecte les libertés essentielles de l’utilisateur : la liberté de l’utiliser, de l’étudier, de le modifier et d’en redistribuer des copies, modifiées ou non. (Richerd Stallman, GNU, voir article complet) _L’open source Voir aussi : Autre article sur les technologie : Fonctionnement global de NORSE.
« Mais d'où viennent ces licences de logiciels de seconde main ? » - Le Parisien Le coût des logiciels représente 35 % du budget informatique des entreprises, selon une étude réalisée en 2014 par le cabinet Forrester. C'est pourquoi certains, des PME comme des grands comptes, se tournent vers l'achat d'occasion. Longtemps prohibée, la revente de licences de logiciels d'occasion est légale depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de juillet 2012, précisant même que les clauses interdisant cette pratique sont sans valeur. Si, dans certains pays comme l'Allemagne, les responsables informatiques se sont rués sur cette possibilité de faire des économies, la France fait preuve de davantage de prudence, sans doute parce que la décision n'a pas encore été retranscrite dans le droit national. 25 % des licences concernées Mais d'où viennent ces licences de logiciels de seconde main ? Des conditions d'achat strictes L'achat de logiciels d'occasion autorisé, quelques règles doivent cependant être respectées. Maintenance et mise à jour non incluses
Les logiciels propriétaires : cadre juridique et licences associées jeudi 11 février 2016 Les logiciels propriétaires occupent aujourd’hui une place essentielle dans la vie des entreprises, des institutions, et des particuliers. Par opposition aux logiciels libres qui supposent une certaine liberté, une gratuité, une égalité et un partage, ils impliquent d’avantage d’obligations aux licenciés. Le monde de l’informatique vit dans un état de progrès constant : les licences de logiciels propriétaires sont l’un des exemples de cette mouvance et de ce dynamisme. Un livre simple et pratique, à découvrir pour disposer d’un éclairage unique. Véronique-Déborah Cohen est avocate et Docteur en droit privé.
Logiciel : Adobe tire un trait sur ses audits de licence Adobe a arrêté de pratiquer des audits de licences dans la plupart des régions du monde, selon Stephen White, directeur de la recherche de Gartner. Dans un billet de blog, le consultant explique : « Ces programmes ont été arrêtés en Amérique du Nord, au Japon et en Amérique Latine dès novembre 2015. La fermeture du programme européen est en cours. L’éditeur assure qu’il ne maintiendra son système d’audit et de conformité que sur certains marchés de la zone Asie/Pacifique. » Jusqu’à récemment, Adobe faisait partie des 5 éditeurs les plus actifs en matière d’audits de licences, selon les études de Gartner. Rappelons que ces audits visent à vérifier que les déploiements de logiciels au sein des entreprises utilisatrices sont bien conformes aux termes des contrats passés par ces dernières avec les éditeurs. Etre monitoré plutôt qu’audité Interrogé par nos confrères de The Register, Adobe s’est refusé à confirmer l’arrêt du programme d’audit. Ne pas baisser la garde sur le SAM A lire aussi :
Quelle protection juridique des logiciels? | Propriété intellectuelle | Juridique et fiscalité Parmi les nombreuses questions que soulève l’utilisation des NTIC, à la frontière d’Internet, de l’informatique et de l’audiovisuel, la protection juridique des logiciels fait l’objet de débats passionnés. Une mise au point semble opportune. Le logiciel présente la particularité d’être constitué d’un ensemble d’instructions établies selon un langage spécifique destiné à traiter des informations. Schématiquement, ces informations sont soit utilisées telles quelles (calcul, visualisation…), soit destinées à commander le fonctionnement d’appareils ou de machines. A l’époque de l’apparition des premiers logiciels, on s’est interrogé quant au droit de propriété industrielle ou intellectuelle approprié pour leur protection : brevet ou droit d’auteur ? En fait, chacun a raison, et chacun a tort. Donc, le logiciel est protégeable par le droit d’auteur sous réserve de répondre à la condition d’originalité, et étant entendu que la protection est limitée à la forme d’expression du logiciel.
Créer son appli : 6 points clés à connaître en matière de droits d’auteur Une application ("appli") peut être une œuvre de l’esprit à laquelle sont attachés des droits d’auteur. Qu’est-ce qui est protégeable ? Qui en est titulaire ? Quelles en sont les conséquences dans les relations avec les plates-formes de mise en ligne ? Voici 6 points clés pour mieux appréhender et comprendre le patrimoine intellectuel attaché à cette création. 1/ Un concept, même excellent, n’est pas protégeable en soi Selon l’expression consacrée, les idées sont de libre parcours. 2/ La protection d’une appli n’est pas unitaire Le droit d’auteur ne protège pas une appli dans son ensemble mais protège chaque partie de l’œuvre, pourvu que chacune d’entre elles présente une forme originale. 3/ Il n’est pas nécessaire d’ "enregistrer" ses droits d’auteur Il faut noter que contrairement aux marques ou brevets, le droit d’auteur n’a pas à être enregistré pour être reconnu. 4/ Par principe, l’œuvre appartient à celui qui l’a créée
INFOGRAPHIES. Droit à l'oubli : un an après, le formulaire de Google est-il efficace ? Par Marie-Violette Bernard Mis à jour le , publié le Il s'apprête à souffler sa première bougie. Le formulaire de "droit à l'oubli" de Google, qui permet aux internautes européens de demander au moteur de recherche de désindexer certaines pages potentiellement nuisibles à leur image, a été largement utilisé depuis sa mise en place, le 29 mai 2014, révèle une agence spécialisée dans la e-réputation, mercredi 13 mai. Mais ce formulaire de Google permet-il vraiment de faire disparaître les liens gênants que vous voudriez oublier ? Une atteinte à la vie privée dans 6 demandes sur 10 Selon l'étude du cabinet Réputation VIP, Google a reçu au total 249 509 demandes de suppression d'URL de son moteur de recherche, entre le 29 mai 2014 et le 5 mai 2015. Toujours d'après Réputation VIP, 58,7% des demandes de déréférencement envoyées à Google concernent une atteinte à la vie privée. Les réseaux sociaux particulièrement visés Un temps de traitement de plus en plus court
La réforme du droit d’auteur bute sur la responsabilité des plateformes en ligne – EURACTIV.fr Une liste d’une centaine d’amendements déposés par les eurodéputés sur la révision de la directive sur le droit d’auteur de la Commission laisse entrevoir les querelles sur les plateformes en ligne et l’exploration des données. Plus de 80 des amendements appellent à des changements sur l’un des articles du projet de loi sur les droits d’auteur. La Commission a publié sa proposition en septembre dernier, déclenchant immédiatement un lobbying intense sur son impact sur les plateformes en ligne comme YouTube et sur les industries audiovisuelle, musicale ou autres industries créatives. Violations du droit d’auteur La plupart des inquiétudes des eurodéputés se concentrent sur l’article 13 de la proposition de la Commission, qui énonce dans quelles circonstances les plateformes en ligne peuvent se voir obligées de supprimer ce que leurs utilisateurs publient, y compris des violations du droit d’auteur.
LA PROTECTION JURIDIQUE DU LOGICIEL - Le Clust'R Numérique - Digital & Software in Rhône-Alpes I – Le régime juridique du logiciel Le LOGICIEL est, en droit, un bien meuble incorporel. C’est un « objet juridique atypique » qui bouleverse les classifications auparavant établies en matière de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle en France englobe deux matières hétérogènes : d’une part la propriété industrielle et commerciale et d’autre part, la propriété littéraire et artistique. En dépit du fait que les logiciels soient souvent le fruit de programmes de Recherche et Développement destinés à la commercialisation, ainsi que d’autres de leurs caractéristiques qui les rapprocheraient des créations industrielles utilitaires, les logiciels relèvent selon un principe strict bien établi, du domaine de la propriété littéraire et artistique, comme beaucoup d’autres « œuvres de l’esprit » (voir en annexe les articles L 112-1 et L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). II- La protection du logiciel 1 / La protection traditionnelle (iii) Droit des brevets : Auteurs :
La protection du logiciel et son régime juridique - Cours de droit Le logiciel : son particularisme : On sait qu’un logiciel est un programme adressé à un ordinateur en vue de traiter une information. Le principe retenu par les législateurs français et européen est celui de la protection des logiciels par le droit d'auteur. Mais le logiciel doit être original pour que le logiciel soit protégé par le droit d'auteur. § 1 : La protection du logiciel : Alors qu’autrefois on se demandait s’il ne fallait pas protéger le logiciel par les brevets il n’est plus contesté aujourd’hui que le logiciel soit couvert par le droit d’auteur : son particularisme a été consacré par une loi du 10 mai 1994, qui a transposé en droit interne une directive européenne. En fait, dès l’arrêt Pachot (Assemblée plénière 7 mars 1986, D 1986, 405), il était admis que le logiciel soit protégé par le droit d’auteur. Cela étant tous les programmes ne sont pas protégés. §2 Le régime juridique du logiciel : a) Le droit d’exploitation : b) L’épuisement des droits : Attention ! b) Rémunération :