


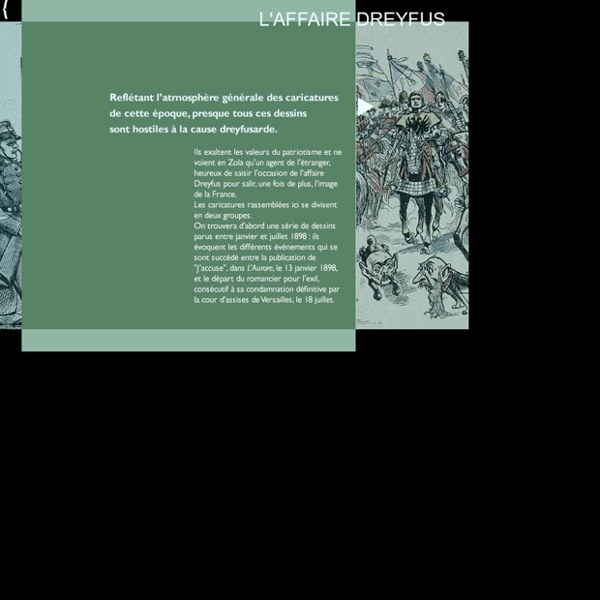
L'affaire Dreyfus : au fond de la corbeille (1) : épisode 1/2 du podcast L'Affaire Dreyfus L'affaire Dreyfus, maître-étalon de l’horreur judiciaire quand elle est complot. L’affaire Dreyfus, qui non seulement a bouleversé le pays mais redessiné le paysage politique français pour longtemps et même présidé à la création de l’Etat d’Israël. L’Affaire Dreyfus comme millième donc, mais en deux épisodes. 1889 : voilà un siècle que la France est entrée de force dans un nouveau monde, celui de la République, celui de la démocratie. La IIIème République célèbre en immenses pompes le centenaire de la Révolution et ce qu’elle appelle les “immortels principes de 1789” : la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Et pourtant, en cette fin de XIXème siècle, la République est fragile. Ce bâtiment, c’est l’antre de la France contre-révolutionnaire. En partenariat avec RetroNews. Un récit documentaire de Romain Weber Invité : VIncent Duclert, professeur à l’EHESS, est l’auteur de L'Affaire Dreyfus (La Découverte, 4e éd. 2018) et de Alfred Dreyfus. Discographie : Léonard COHEN : Who by fire (1974)
La mobilisation des dreyfusards Les rebondissements de l’Affaire L’arrestation et la condamnation d’un officier juif français, Alfred Dreyfus, en décembre 1894, suite à la découverte d’un bordereau anonyme renfermant des informations secrètes destinées à l’Allemagne, parurent clore cette banale histoire d’espionnage. Cependant, celle-ci devait connaître de nouveaux rebondissements lorsque le lieutenant-colonel Picquart établit l’identité du véritable traître, le commandant Esterházy, en mars 1896 et que ce dernier fut acquitté par le conseil de guerre le 11 janvier 1898, au terme d’un procès inique. La mobilisation des dreyfusards La publication du manifeste de Zola, « J’accuse… ! Les deux France La présence de slogans tels que « Vive la France !
Voyages en Résistances Archive exceptionnelle : écoutez la voix d'Alfred Dreyfus lui-même, en 1912 "Le 20 juillet 1906 fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée." Ce sont les mots d'Alfred Dreyfus. Non seulement ceux qu'il a écrits dans ses Mémoires, mais ceux qu'il prononce face à l'enregistreur Pathé tendu par le linguiste Ferdinand Brunot dans une petite salle de la Sorbonne, en mars 1912. Écoutez dans ce document exceptionnel le commandant réhabilité revenir sur l'ampleur de la fameuse "affaire" qui porte désormais son nom. Un document unique C’est un trésor des Archives de la parole : la voix d'Alfred Dreyfus lui-même. Commandant Alfred Dreyfus, mars 1912 "Mon affaire était terminée. Et même s'ils parurent oublier qu'ils ne furent pas les plus mal partagés car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dont le monde ait été témoin. Les Archives de la parole à découvrir sur Gallica
Emile Zola, le parcours d'un écrivain engagé du 02 juillet 2013 Rediffusion Il y a 110 ans mourait Emile Zola , le 29 septembre 1902. Il venait de mettre un point final à son dernier livre, Vérité , un récit prophétique, très inspiré par l'affaire Dreyfus. La recherche de la vérité fut en effet la plus grande passion du journaliste et romancier, son seul et unique combat. Aujourd'hui, premier volet de deux émissions consacrées à cet écrivain magistral... Nous allons découvrir comment Zola est devenu Zola, l'auteur de la saga mythique des Rougon-Macquart ... Avant de devenir le chef de file de l'école naturaliste, il est l'auteur de poèmes romantiques et de nombreuses nouvelles... Avec des extraits de : Vérité , éd. "Lettre à Paul Cézanne", 9 février 1860, extrait de sa Correspondance , ed. "Celle qui m'aime", extrait de Les Contes à Ninon (1864), éd. Article à propos de Gustave Doré, publié initialement dans Le Salut public en 1865, extrait du recueil Mes Haines (1866), éd.
Si je reviens un jour : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky (web doc, Seconde guerre mondiale) I. Des lettres oubliées dans une armoire II. Un lien très fort entre l’élève et son professeur III. IV. V. VI. Alfred Dreyfus, le combat de la République : un podcast à écouter en ligne | France Inter Les faits. En octobre 1894, Alfred Dreyfus, jeune capitaine d'artillerie, citoyen français et juif alsacien, est accusé à tort par son état-major de haute trahison au profit de l'Allemagne, le pays ennemi. Condamné à la dégradation militaire, puis à la déportation dans une enceinte fortifiée, Alfred Dreyfus est transféré en Guyane sur l'île du Diable. L'affaire Dreyfus est un tournant majeur dans l'histoire politique française, car l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards en garde a engendré des clivages idéologiques qui ont perduré tout au long du XXᵉ siècle, à savoir l'Université contre l'Armée, l'École contre l'Église, la Presse contre l'État, la Raison contre les passions tristes ou encore la vérité contre le complot. Par ailleurs, à la fin du XIXᵉ siècle, la lutte pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus a redessiné toute la société française. 130 ans plus tard, il faut se souvenir du calvaire enduré par l'innocent Alfred Dreyfus. Intervenants et bibliographie Équipe
5 janvier 1895 - Dégradation du capitaine Dreyfus Le 5 janvier 1895, le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement dégradé dans la cour de l'École Militaire, à Paris. Il a été condamné au bagne à vie pour haute trahison et espionnage au profit de l'Allemagne. « Dreyfus n'a exprimé aucun regret, fait aucun aveu, malgré les preuves irrécusables de sa trahison. Il doit en conséquence être traité comme un malfaiteur endurci tout à fait indigne de pitié » peut-on lire dans le compte-rendu du Matin. L'« Affaire » proprement dite commence un an plus tard avec la découverte de faits nouveaux par le lieutenant-colonel Picquart. Il apparaît à ce dernier que le capitaine a été accusé à la place d'un autre. L'erreur judiciaire est manifeste. Une condamnation sans histoire L'affaire Dreyfus débute comme une banale affaire d'espionnage par la découverte en septembre 1894 d'un bordereau contenant des secrets militaires et adressé à l'ambassade allemande. Tout se corse en mars 1896. Le patriotisme contre les principes Le dénouement