


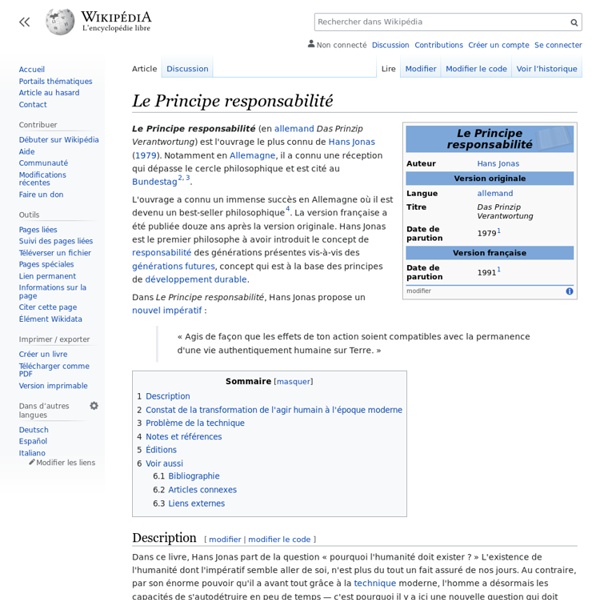
Mémoire consacré à Hans Jonas : introduction | Djaphil Les thèses défendues par Hans Jonas dans Le principe responsabilité le placent à l’écart de la pensée actuelle. Sa conception moniste et finaliste du vivant, l’objectivité du bien, le recours à la métaphysique et les conséquences politiques de sa pensée font que celle-ci semble ne pas pouvoir s’insérer dans la panorama actuel de la philosophie. Cependant, les problèmes abordés par le philosophe se révèlent être d’actualité. Abordant le libéralisme par le biais des technologies, Jonas pénètre au cœur de l’utopie technologique qui anime l’homme moderne et qui risque de se transformer en menace pour l’humanité toute entière. Nous consacrons notre étude à la responsabilité telle que la conceptualise Hans Jonas, c’est-à-dire la prise de conscience et les changements de comportements qu’exigent de nous les conséquences à la fois écologiques et humanitaires de l’utopie technologique et du système économique mondial qui la nourrit. Enfin, la responsabilité est une obligation, c’est un devoir.
Oh, Toulouse… (Philippe LABBE, 19 mars 2012) - Mission. Insertion (Philippe Labbe Weblog. II) Edwy Plenel, directeur de Mediapart, vient de publier un article « Contre la haine, nos fraternités ». Cela n’a a priori pas grand chose à voir avec l’insertion… quoique une société de l’individualisme poussé à l’excès et dont la seule boussole semble être en fin de journée l’évolution du CAC 40 ne devrait pas s’étonner de ce type de basculement. Il y a, parmi les causes de l’exclusion, la déqualification (écart entre les compétences disponibles et celles exigées), le destin (ces jeunes dont on comprend rapidement qu’ils arrivent avec des années de passif familial dans le rapport au travail), l’accident de vie (du temps de Durkheim, le suicide concernait les vieux, désormais ce sont les jeunes) et enfin le basculement imprévisible. Voilà un exemple, tragique, d’une société frappée d’anomie, de panique morale. Le « Oh » de Toulouse n’est pas exactement le même que celui du regretté Nougaro. «Contre la haine, nos fraternités » A ce stade, nous n’en savons rien. C’est dit.
Jonas Hans Hans Jonas, né en 1903 en Allemagne, élève de Husserl, Heidegger et Bultmann (thèse de doctorat sur la gnose en 1928), a été professeur à Jérusalem (1935), au Canada (1949), à New York (de 1955 à 1976) et à Munich (1982-1983). Il est lauréat du prix de la paix des libraires allemands (1987). «Hans Jonas est né en 1903 d’une famille juive allemande. Il a étudié auprès de somités du monde philosophique et théologique tels que Husserl, Heidegger et Bultmann. Pour des raisons évidentes, il a dû émigrer en Palestine en 1933 — année de l’accession de Hitler au poste de chancelier —, et de nouveau au Canada en 1939, pour enfin s’établir à New York de 1955 à 1976. Durant l’année académique 1982-1983, il fut professeur invité à Münich, époque où l’auteur de cet article a eu l’occasion de l’entendre lors d’une conférence à Francfort sur les nouvelles valeurs à définir. LAURENT GIROUX, «Hans Jonas (1903-1993) : le Principe Responsabilité», L’Agora, vol. 7, no 2, janvier-février 2000. H.
Individualisme "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique Définition de l'individualisme Etymologie : dérivé de individu, issu du latin individuus, indivisible, inséparable, lui-même composé du préfixe privatif in- et de dividuus, divisible, divisé, partagé, séparé. Le terme individualisme sert à désigner toute théorie, doctrine ou attitude qui consiste à privilégier les intérêts, les droits et les valeurs de l'individu par rapport à tous les groupes sociaux, que ce soit la famille, le clan, la corporation, la communauté, la société, etc. L'intérêt individuel est considéré comme supérieur à l'intérêt général. L'individualisme repose sur deux principes : la liberté individuelle : la priorité est donnée à la condition des individus avant celle de la société elle-même, l'autonomie morale : les opinions de chacun doivent résulter d'une réflexion individuelle qui ne soit pas dictée par un quelconque groupe social, y compris par les religions. >>> Terme connexe : Libéralisme >>> Terme antinomique : Holisme
Hans Jonas Hans Jonas, né en 1903 et mort en 1993, est un philosophe allemand surtout connu pour son éthique adaptée à l'âge technologique (problèmes environnementaux, questions du génie génétique, etc). La thèse liminaire de ce livre est que la promesse de la technique moderne s’est inversée en menace, ou bien que celle-ci s’est indissolublement alliée à celle-là.
Comportement prosocial Le comportement prosocial humain désigne les comportements de souci de l'autre, et notamment d'aide, dirigés vers des personnes inconnues ou en difficulté. L'aide à un sans-abri, un comportement prosocial. L'étude de ce comportement remonte à la philosophie antique. Comprendre les comportements prosociaux demande de répondre à trois questions sur l'altruisme : « Quand, comment et pourquoi aide-t-on les autres ? ». Origine du comportement prosocial[modifier | modifier le code] Le terme comportement prosocial est l'antonyme du comportement antisocial[3],[4]. De nombreux chercheurs se sont posé la question du caractère inné (instinct fondamental d'aider inscrit dans les gènes) et/ou acquis (appris dès le plus jeune âge) des comportements prosociaux. Inscription dans le contexte psychologique[modifier | modifier le code] Des philosophes comme Aristote, Hobbes, Nietzsche ou des psychanalystes comme Sigmund Freud s'interrogent déjà sur la nature de l'homme et ses comportements. Quand aide-t-on ?
Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique: Amazon.fr: Hans Jonas: Livres Prolégomènes de l’engagement (Philippe LABBE, octobre 2012) - Mission. Insertion (Philippe Labbe Weblog. II) Deux hypothèses sous-tendent cette contribution mise au débat. - Tout d’abord, l’engagement est au cœur d’un paradoxe. D’un côté, l’engagement est mis à mal sous l’effet de l’individualisme massif qui marque la modernité, qui plus est accentué par la rétraction sinon le sauve-qui-peut que provoque la crise ; d’un autre côté, l’engagement est une nécessité incorporée et, pourrait-on dire, d’autant plus impérative que, précisément, il s’étiole : l’homme, animal social, ne parvient pas à se satisfaire du retrait. - Seconde idée, issue de quarante années de fréquentation des travailleurs et intervenants sociaux. Nota bene. On peut s’entendre, à ce stade, sur le fait que l'engagement social est un lien durable qui existe entre l'individu et ses actes. S’engager n’est pas sans risque. Il existe deux risques majeurs dans l’engagement, eux-mêmes inconvénients de deux postures, la distinction et l’enfermement. souvent cette exceptionnalité ne soit pas perçue par les autres. La suite ICI
Günther Anders Günther Anders a traité du statut de philosophe, de la Shoah, de la menace nucléaire et de l'impact des médias de masse sur notre rapport au monde, jusqu'à vouloir être considéré comme un « semeur de panique » : selon lui, « la tâche morale la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s’inquiéter et qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime »[N 1]. Il a été récompensé de nombreux prix au cours de sa vie pour son travail, dont le Deutscher Kritikerpreis de 1967 et le prix Theodor-W.-Adorno de 1983. Biographie[modifier | modifier le code] Enfance et formation[modifier | modifier le code] Günther Anders est né le 12 juillet 1902 à Breslau, actuellement Wrocław, en Pologne. Anders obtient son doctorat en 1924 sous la direction d'Edmund Husserl, et étudie ensuite durant les années 1920 avec le philosophe Martin Heidegger[2]. Cet échec l'empêchant d'entrer dans la carrière universitaire, il se tourne vers le journalisme[4],[5].
Vaisseau spatial Terre ! Le magazine bimestriel belge Imagine, demain le monde m’avait confié il y a deux ans une chronique. Mon billet pour le prochain numéro été refusé aujourd’hui même. J’ai rappelé à sa rédaction qu’un tel refus équivalait à une rupture de contrat. Voici le billet incriminé. Deux questions se posaient à moi au moment d’entreprendre la rédaction de Le dernier qui s’en va éteint la lumière : fallait-il, premièrement, tenter de prouver que la menace d’extinction était réelle ou bien considérer que le lecteur savait déjà que tel était le cas ? fallait-il ensuite galvaniser le lecteur sur le mode chanson scoute : « Retroussons nos manches, hardi ! Mais il y avait un présupposé à ma manière de voir les choses qui m’était passé inaperçu : il s’agissait du « nous » sous-entendu dans « retroussons nos manches » et il m’a été révélé le 23 mars lorsque je me suis retrouvé face à la sociologue française Dominique Méda dans un débat organisé à Paris par la revue Kaizen, sur la question du travail.
Hans Jonas Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Hans Jonas Philosophe allemand Époque contemporaine Hans Jonas (1903 - 1993) est un historien du gnosticisme et un philosophe allemand. Vie et pensée[modifier | modifier le code] Il fut élève de Husserl, Heidegger et Bultmann avec Hannah Arendt. En apprenant que sa mère est morte à Auschwitz, Jonas refuse la proposition de l’éditeur allemand, qui en avait conservé les épreuves, d’imprimer le second tome de son livre sur la gnose. Dans la philosophie qu'il énonce vers la fin de sa vie, Hans Jonas veut apporter une réponse aux problèmes que pose la civilisation technicisée, à savoir les problèmes environnementaux, les questions du génie génétique, etc. La « responsabilité » jonassienne n'a rien à voir avec la responsabilité qui naît de la propriété, ou de l'obligation de réparer le tort fait à autrui, que l'humanité reconnaît depuis des millénaires comme un principe de justice naturelle. Postérité et critiques[modifier | modifier le code]
La Société des individus La Société des individus (en allemand Die Gesellschaft der Individuen) est un ouvrage du sociologue allemand Norbert Elias, paru en allemand en 1987 puis en français en 1991 (avec un avant-propos de Roger Chartier). Description[modifier | modifier le code] Le livre est constitué de trois textes : La société des individus, écrit en 1939, initialement destiné à constituer la conclusion de l'ouvrage Sur le processus de civilisation.Conscience de soi et image de l'homme, écrit dans les années 1940-1950.Les transformations de l'équilibre "nous-je", écrit en 1987. La société des individus[modifier | modifier le code] Dans ce texte, Norbert Elias tâche d'éclaircir le lien entre individu et société. Conscience de soi et image de l'homme[modifier | modifier le code] Le propos de Norbert Elias dans ce texte est de comprendre, et de démonter intellectuellement, la séparation entre deux visions du lien individu-société, au contenu fortement passionnel[2] : Citation[modifier | modifier le code]
Gunther Anders BRISEUR DE MACHINES ? Günther Anders 1987BRISEUR DE MACHINES ? Günther Anders 1987 LA FIN DU PACIFISME (Interview imaginaire) Günther Anders 1987 LA FIN DU PACIFISME (Interview imaginaire) Günther Anders 1987 UNE CONTESTATION NON-VIOLENTE EST-ELLE SUFFISANTE ? Dix thèses pour Tchernobyl. L’obsolescence du sens par Günther Anders (1972) L’obsolescence du sens par Günther Anders (1972) Günther Anders et les travailleurs à domicile (fable de saison) 1956 Günther Anders et les travailleurs à domicile (fable de saison) 1956 Extrait de l'obsolescence de l'homme de GUNTHER ANDERS le conditionnement collectif Extrait de l'obsolescence de l'homme de GUNTHER ANDERS le conditionnement collectif Il faut présenter de façon outrancière les objets dont l’importance est minimisée Günther Anders (1956) Il faut présenter de façon outrancière les objets dont l’importance est minimisée Günther Anders (1956) Anthropologie des chômeurs Günther Stern 1933 Anthropologie des chômeurs Günther Stern 1933